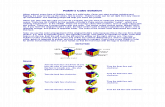article_pumus_1164-5385_1992_num_2_1_1015
-
Upload
angelikvas -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of article_pumus_1164-5385_1992_num_2_1_1015

Jean-Michel Tobelem
De l'approche marketing dans les muséesIn: Publics et Musées. N°2, 1992. Regards sur l'évolution des musées (sous la direction de Jean Davallon) pp. 49-70.
AbstractThe aim of this article is to present research undertaken in the field of museum marketing, within the context of the evolution ofmuseums and of marketing today.Are therefore examined the conditions under which marketing made its appearance in the muséum world and the specificproblems and risks that an uncontrolled application of these methods could bring about.Finally, marketing is analysed as an instrument to serve muséums but which does not, and cannot, answer ail the questionsraised by the transformations of these institutions.
ResumenEl objetivo de este artículo es el de presentar ciertas investigaciones realizadas en el campo del marketing de los museos, ycentradas en el contexto de la evolución de los mismos y del marketing en sí.Las condiciones de la aparicion del marketing en los museos son examinadas, así como sus especificaciones y los riesgos deuna aplicación difïcilmente contrólable de sus métodos.Finalmente, el marketing es analizado como un instrumente que debe estar al servicio de los museos pero que no puederesponder a todas las interrogantes que surgen debido a las transformaciones de estas instituciones.
RésuméCet article a pour but de présenter certaines des recherches réalisées dans le domaine du marketing des musées, replacéesdans le contexte de ces institutions et du marketing lui-même.Sont donc examinées les conditions de l'apparition du marketing dans les musées, ses spécificités et les risques d'uneapplication non contrôlée de ses méthodes. Finalement le marketing est analysé comme un outil qui doit rester au service desmusées mais qui ne peut répondre à toutes les interrogations soulevées par les transformations de ces institutions.
Citer ce document / Cite this document :
Tobelem Jean-Michel. De l'approche marketing dans les musées. In: Publics et Musées. N°2, 1992. Regards sur l'évolution desmusées (sous la direction de Jean Davallon) pp. 49-70.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1992_num_2_1_1015

Jean-Michel Tobelem
DE L'APPROCHE MARKETING DANS LES MUSÉES
L, les musées sont entres dans un monde qui leur était le plus éloigné a priori, celui de l'économie. Ils sont non seulement justifiables d'une analyse économique (Mercillon, 1977 ; Pommerehne et Frey, 1980 ; Aykaç, 1989), mais peuvent également faire l'objet d'une description en termes financiers : budget de fonctionnement, personnel, résultats commerciaux, chiffres de fréquentation, valeur des achats d'oeuvres...
De fait, on parle aujourd'hui des musées comme des « entreprises culturelles » ; on tend à assimiler les conservateurs à des chefs d'entreprise ; et l'on observe une insertion croissante des musées dans des mécanismes de marché, accompagnée de nouvelles modalités de gestion issues des changements de leur environnement et de la complexité des phénomènes rencontrés (montage d'expositions, recherche de fonds, programmation architecturale, informatisation, etc.).
Les musées, de même que la sphère culturelle dans son ensemble, sont donc influencés progressivement par des préoccupations de coût, de financement, d'évaluation, de développement, de rentabilité. L'économie, dont l'objet est théorique, et la gestion, à visée opérationnelle, ont ainsi acquis progressivement une légitimité dans un domaine dont ils paraissaient devoir être exclus, celui de la culture. Ces disciplines y ont apporté leurs outils traditionnels d'analyse, et en particulier une utilisation des instruments statistiques et des modèles.
C'est dans ce contexte qu'un concept jadis inconnu des musées, celui de marketing, tend à y faire son apparition, alors même qu'une grande confusion règne sur ses objectifs et sur ses instruments. Il s'agira donc de définir plus précisément le marketing, d'établir les raisons de son apparition, d'observer comment il peut être appliqué au monde des musées, de noter ses spécificités dans ce cadre particulier, puis d'examiner les risques que peut faire naître une utilisation non contrôlée par les responsables des musées.
49 De l'approche marketing
publics & musées n

Notre point de vue, qui s'appuie sur une présentation des travaux de recherche sur le sujet, consistera à présenter l'évolution de l'approche marketing dans les musées, en cherchant à faire apparaître l'intérêt de cette discipline à côté d'autres méthodes d'analyse, mais en soulignant également qu'il n'est pas une solution à toutes les questions que se posent les musées et que ses conditions d'application requièrent un certain nombre de précautions.
QU'EST-CE QUE LE MARKETING ?
p JL our beaucoup, le marketing est traditionnellement assimilé aux moyens employés par une entreprise pour vendre aux consommateurs ses produits (automobile, détergent) ou ses services (banque, informatique), principalement par le biais de la publicité. Cette opinion sommaire tient en partie au fait que le marketing lui-même a connu une double transformation, dont n'ont pas toujours conscience ceux qui utilisent ce vocable : le consommateur a été placé au centre du dispositif marketing, d'une part, et le concept a été étendu au monde des institutions à but non lucratif, d'autre part.
L'ÉVOLUTION DU MARKETING : DU PRODUIT VERS LE CONSOMMATEUR
À l'origine, c'est le produit proposé sur le marché qui était au centre des efforts des responsables du marketing dans les entreprises. Il s'agissait avant tout d'améliorer ce produit pour le vendre au plus grand nombre de consommateurs. Dans une seconde phase, l'accent a été mis sur la rationalisation du processus de production. Grâce à une amélioration concomitante des circuits de distribution, les sociétés développées entrèrent dans l'ère de la consommation de masse, marquée par la diffusion du modèle de production de Ford. La période suivante, marquée par la récession des années trente, plaça au premier rang des préoccupations des entreprises l'impératif de vente, en utilisant toute la panoplie des moyens publicitaires visant à influencer l'acte d'achat du consommateur. C'est l'importance accordée à ce dernier, à l'analyse de ses besoins, de ses caractéristiques, de ses perceptions et de ses souhaits, qui caractérise la situation actuelle du marketing et qui fait qu'il diffère assez profondément de sa conception d'origine (Kotler et Andreasen, 1987).
Il s'agit là d'un renversement complet de perspective qui nécessite une analyse minutieuse des préférences et des préoccupations de consommateurs plus avertis et plus sophistiqués ; ce changement fait passer d'un marketing de l'offre à un marketing centré sur la demande. Etudes et enquêtes doivent donc conduire l'institution à proposer des produits toujours mieux adaptés aux besoins des consommateurs. On peut essayer de transposer le schéma d'analyse précédent au monde des musées.
50 De l'approche marketing
publics & musées n

Dans le premier cas, reflet d'une situation qui tend à disparaître, l'attention des responsables porte uniquement sur les collections, indépendamment des souhaits du public. Globalement satisfait de ce qu'il présente ou de la façon dont il le présente, le conservateur tend à rendre l'ignorance ou l'indifférence des visiteurs responsable d'une faible fréquentation.
Dans le second cas, il s'efforcera d'améliorer l'efficacité du musée afin d'augmenter la qualité de la visite ou d'accroître la fréquentation. Le musée présentera plus d'expositions, créera de nouveaux programmes, offrira de nouveaux services, sans nécessairement cerner avec précision la demande des visiteurs (et les souhaits des non-visiteurs) et sans pouvoir évaluer avec précision leur degré de satisfaction. Néanmoins, ces dernières années ont vu une multiplication des études portant sur les visiteurs, signe d'une volonté des musées de mieux connaître les attentes des différents types de public.
La troisième phase consistera pour un musée à utiliser la communication et les relations publiques afin d'augmenter sa notoriété. L'assimilation abusive du marketing à la publicité en est le symbole, lorsque cette politique est considérée comme une fin en soi. Cette démarche suppose en effet qu'il suffirait de mieux informer le visiteur potentiel pour que celui-ci décide de fréquenter le musée. Là encore, de nombreux musées ont engagé des réflexions sur la nécessité de mieux communiquer avec le public et ont mis en place des politiques allant dans ce sens.
Dans le dernier cas, l'institution tout entière est à l'écoute du visiteur. Le degré de consistance de cette écoute permet de classer les organisations selon qu'elles répondent aux réclamations, qu'elles réalisent des enquêtes de satisfaction, qu'elles s'informent des besoins et des préférences des visiteurs, qu'elles choisissent et forment leur personnel en fonction de ce critère, et qu'elles cherchent ou pas à améliorer le service offert. L'institution doit pour cela être prête à s'adapter, dans le respect des normes professionnelles, scientifiques ou artistiques (Kotler et Andreasen, 1987). Bien que de façon souvent dispersée, des éléments de cette politique se retrouvent à des degrés divers dans les musées qui, il faut le souligner, ne peuvent tous rentrer dans une même grille d'analyse du fait de leur extrême diversité.
Ce schéma sommaire semble indiquer que de nombreux musées, ceux qui ignorent le marketing ou en ont une conception erronée, se situent à l'un des trois premiers stades et ne sont donc pas à même d'utiliser le marketing pour ce qu'il est aujourd'hui : un outil d'analyse et un moyen d'action devant permettre à une organisation, qu'elle soit marchande ou non marchande, d'atteindre ses objectifs. Dans le cas d'une entreprise privée, il s'agira de parvenir au profit le plus élevé, alors qu'un musée pourra se fixer comme but l'éducation du visiteur, ou sa sensibilisation aux domaines de l'histoire, de la science ou de l'art (Kotler et Andreasen, 1987) et non pas seulement un objectif de rentabilité.
Dans cette optique, les musées s'efforcent de former le personnel à l'idée qu'il est au service du public et doivent améliorer sans cesse la qualité des services offerts. Néanmoins, les personnes qui travaillent dans un
51 De l'approche marketing
publics & musées n

musée, y compris dans les départements de communication, sont parfois mal placées pour apprécier la manière dont le public perçoit leur établissement. Ainsi, les responsables d'un musée de Virginie aux Etats-Unis furent fort étonnés d'apprendre que les non-visiteurs imaginaient que le musée était payant, alors qu'il est entièrement gratuit ; et percevaient le musée comme un endroit froid, renfermé et où il ne se passait pas grand- chose, alors que chaque semaine, sinon chaque jour, apporte un nouveau programme et alors qu'une nouvelle aile venait d'être inaugurée... Cette perception par le public est fondamentale, puisque c'est elle qui détermine les comportements de visite, quelle que soit la réalité des phénomènes perçus (Fronville, 1985).
L'extension du marketing hors de la sphère marchande
Par ailleurs, on a assisté dans les trente dernières années à l'élargissement du marketing à des organisations à but non lucratif: les causes sociales, les universités, ou encore les institutions culturelles (Kotler et Levy, 1969 ; Lovelock et Weinberg, 1984 ; Mokwa, Dawson et Prieve, 1984 ; Mayaux, 1987). Afin de transposer les concepts du marketing hors du monde des organisations dont le but est le profit, c'est la notion d'échange qui a été utilisée pour caractériser la nature de la relation qui s'établit entre le consommateur et l'institution. Dans le processus ainsi défini, le premier abandonne une chose à laquelle il tient (temps, argent, énergie, valeurs, habitudes) en échange d'un élément bénéfique (économique, social ou psychologique) offert par l'institution. Ainsi, les visiteurs de musée acquittent un droit d'entrée ou font le sacrifice d'une partie de leur temps pour bénéficier de la fréquentation de ses collections, assister à une activité éducative ou suivre une conférence. En dépit de certaines oppositions théoriques (Luck, 1969 ; Rados, 1981), un consensus semble s'être établi pour accepter cette extension du concept de marketing en dehors de la sphère marchande (Bigley, 1987).
La difficile tâche des responsables du marketing consiste à conjuguer deux éléments : les objectifs à atteindre, d'une part, et la satisfaction des consommateurs, d'autre part, et cela en agissant sur le niveau, le rythme et la nature de la demande de la population ciblée de telle sorte qu'elle permette à l'institution de remplir sa mission. Kotler et Andreasen distinguent six états principaux de la demande :
— l'absence de demande: les consommateurs ne sont pas intéressés ou sont indifférents à l'égard du produit ; ainsi, un certain nombre de personnes déclarent qu'elles ne sont pas intéressées par l'art moderne et ne fréquentent pas les musées de ce type.
- une demande latente-, des consommateurs ressentent un besoin qui n'est satisfait par aucun des produits existants ; le rôle du marketing est de mesurer la taille de ce marché potentiel et de développer des produits et des services de nature à satisfaire la demande ; ainsi, un grand nombre de personnes s'intéressent à l'archéologie, mais ne sont pas satisfaites par la manière dont est présentée cette discipline dans les musées.
52 De l'approche marketing
publics & musées n

À ce sujet, rappelons que le record de fréquentation détenu par une exposition en France reste l'exposition Toutankhamon de 1961...
- une demande fléchissante : l'institution est confrontée de manière cyclique à une baisse de la demande pour l'un ou plusieurs de ses produits. Il est du ressort des responsables du marketing d'analyser les causes de ce déclin et de chercher à y remédier par une modification de ses produits, par la recherche de nouveaux marchés ou par un effort de communication. Pour ce qui est des musées, la programmation d'expositions temporaires, une nouvelle aile, la présentation de nouvelles collections ou la recherche d'un nouveau public peuvent répondre à cette préoccupation et sont de nature à favoriser le succès d'un établissement par rapport à un autre qui resterait figé.
- une demande irrégulière: la plupart des institutions connaissent une variation de la demande selon les saisons, les jours ou les heures ; ainsi, les musées sont confrontés à une augmentation de la demande pendant les fins de semaine et les périodes de vacances dans les zones touristiques ; ils sont en revanche moins fréquentés en semaine. Les responsables du musée pourront proposer des interventions visant à mieux répartir la fréquentation.
- une demande satisfaisante : l'institution est satisfaite du niveau de la demande pour ses produits. Les responsables du marketing doivent s'efforcer de la maintenir, en prévision d'un changement de la demande ou bien de l'apparition d'une concurrence renforcée ; ils peuvent, par ailleurs, contrôler de façon régulière le niveau de satisfaction du consommateur. L'émergence de nombreux nouveaux musées impose ainsi aux anciennes institutions d'augmenter la qualité de leurs prestations pour maintenir leur « part de marché », au-delà d'une nécessaire collaboration.
- une demande excessive: certaines organisations sont confrontées à une demande supérieure à celle qu'elles peuvent satisfaire dans des conditions acceptables. Dans les musées, les expositions temporaires prestigieuses et populaires créent des phénomènes de files d'attente qui nuisent à la qualité de la visite. Les services du marketing doivent s'efforcer de réduire la demande de manière temporaire ou permanente, de façon sélective ou non. L'introduction de réservations obligatoires pour l'exposition Toulouse-Lautrec à Paris en 1992 cherchait à devancer ces phénomènes d'attente et d'encombrement excessifs.
POURQUOI INTRODUIRE LE MARKETING DANS LES MUSÉES?
L apparition du marketing dans les musées peut être attribuée à quatre facteurs, dont l'importance respective dépend des différents pays et de la nature de chacun des établissements : la croissance des musées, la question du financement, la situation de concurrence et la nécessité de mieux connaître les visiteurs.
53 De l'approche marketing
publics & musées n

La croissance des musées
Ce sont aujourd'hui des organisations complexes, dont l'offre est diversifiée (expositions temporaires, recherche, programmes éducatifs, collecte de fonds, publications, services culturels, activités commerciales), disposant de budgets importants et d'un personnel nombreux (Peterson, 1986 ; Balle, 1987b ; Labouret et de Narp, 1990). En France, la modernisation des musées s'accompagne généralement d'une augmentation sensible du nombre de personnes employées et des services offerts. De même, aux Etats-Unis, les musées et les sociétés historiques ont vu leurs budgets, leurs personnels et leurs programmes augmenter de façon considérable dans les dernières décennies, sans que les ressources financières traditionnelles soient en mesure de suivre ces nouveaux besoins (Bryan, 1989). Or, il existe dans certains musées des gisements de ressources qui demeurent inexploités, qu'il s'agisse de la faiblesse des services destinés aux visiteurs, de l'insuffisance des efforts de communication ou d'une exploitation limitée des «retombées» économiques et touristiques (Greffe, 1990). À l'inverse, l'exemple de certains musées indique que la mise en œuvre d'une politique de développement peut avoir des résultats positifs, comme nous le montrerons par la suite.
La question du financement
Le poids grandissant des contraintes financières, par suite d'un retrait de la puissance publique et/ou en raison de besoins de financement nouveaux destinés à accompagner la croissance des musées, impose de trouver des moyens de capter des ressources supplémentaires et de mettre en place des moyens de mieux communiquer en direction des différentes cibles visées. Comme le montrent les exemples étrangers, l'apparition des préoccupations de marketing coïncide généralement avec les difficultés financières rencontrées dans les musées : récession et restrictions budgétaires au début des années quatre-vingt aux Etats-Unis, thatchérisme en Grande-Bretagne, nouveaux besoins financiers des musées nés de leur modernisation au Canada. À l'inverse, la probabilité d'une préoccupation de marketing diminue généralement à mesure que l'on s'oriente vers un système de financement entièrement pris en charge par le secteur public (Pommerehne et Frey, 1980 ; Rosenthal, 1982 ; Balle, 1987a ; Mercillon, 1988). Ce qui n'a cependant pas empêché les responsables des musées publics de se préoccuper de l'analyse des visiteurs, comme en témoigne le grand nombre d'études réalisées sur ce sujet.
En ce qui concerne les Etats-Unis, sous l'effet de la réduction des subventions publiques, du ralentissement de l'économie, de dispositions fiscales moins avantageuses que par le passé et de l'accroissement des dépenses, les responsables des musées ont introduit de nouvelles modalités de gestion dans les domaines du marketing, de la collecte de fonds et des politiques commerciales. De ce fait, les forces du marché ont eu une influence de plus en plus notable sur les musées américains dans les der-
54 De l'approche marketing
publics & musées n

nières années, ce qui s'est traduit par l'accroissement des budgets de communication, par un intérêt croissant pour les études de public, par le souci d'augmenter la fréquentation grâce à la présentation de grandes expositions temporaires et par l'extension des pratiques de parrainage (Tobelem, 1990).
Parallèlement, ces musées ont été confrontés à la nécessité d'accroître leurs ressources propres telles que les revenus tirés des dotations financières en capital ou les droits d'entrée et d'abonnement qui alimentent une intense activité de programmation (le Metropolitan Muséum de New York et l'Art Institute de Chicago ont aujourd'hui plus de 90.000 adhérents). Enfin, les recettes tirées du développement des boutiques de musées ont connu une forte expansion ces dernières années. À titre d'exemple, les revenus commerciaux du Metropolitan Muséum sont de l'ordre de 50 millions de dollars par an (avec un important programme de vente par correspondance) et ceux de la Smithsonian Institution sont d'environ 40 millions de dollars. De ce fait, un certain nombre de directeurs de musées ont désormais une double formation, scientifique (art, histoire, sciences ou éducation) et de gestion. L'ancien directeur de la National Gallery de Washington a pu être désigné comme l'un des meilleurs gestionnaires d'une institution non marchande par le magazine Business Week; quant à son successeur, ses qualités reconnues de gestionnaire ont pesé lourd dans sa désignation (cf. Newsweek, 11 mai 1992).
La situation de concurrence dans laquelle la multiplication des institutions CULTURELLES ET L'EXTENSION DES POSSIBILITÉS DE LOISIRS ONT PLACÉ LES MUSÉES
Ainsi, le fait que les musées ne sont pas des institutions marchandes ne signifie pas qu'ils ne se situent pas sur un marché (DiMaggio, 1985 ; Birobent, 1987). Toutefois, les conservateurs de musées n'ont pas toujours pleinement conscience de la situation de concurrence de fait dans laquelle se trouvent leurs établissements ; les « produits » des institutions culturelles sont considérés comme totalement différents les uns des autres. « Un musée des sciences ne voit pas un musée d'art ou un musée pour enfants comme un concurrent direct. La réalité est souvent différente, puisque le temps dont disposent les individus est par définition limité et qu'un grand nombre de tentations diverses leur sont offertes : aller voir un spectacle, visiter une exposition, se rendre dans un restaurant, assister à une compétition sportive. . . » (Kotler et Andreasen, 1987).
De même, une ville d'une certaine importance offre de nombreuses possibilités de visites de musées et chacun d'entre eux s'efforce, consciemment ou non, d'attirer le maximum de visiteurs. Sans compter que l'émergence de nombreuses institutions culturelles ou muséales les met directement en concurrence dans la captation des ressources financières limitées des financeurs publics ou des donateurs privés. Cette vision du phénomène de la concurrence est enrichie par la reconnaissance du fait que, pour un établissement, la concurrence est celle qui est
55 De l'approche marketing
publics & musées n

perçue comme telle par le visiteur, et ne se limite pas à celle des institutions similaires. Si le consommateur pense qu'une visite au musée entre en concurrence avec l'activité de jardinage ou l'organisation d'une réception pour des amis, alors, selon Kotler, ces activités deviennent les « concurrents » du musée.
La nécessité de mieux connaître les visiteurs
II s'agit d'aider le musée à mieux remplir sa mission en ajustant sa communication, voire de mieux comprendre les perceptions et les attentes des non-visiteurs pour pouvoir intéresser une partie d'entre eux (Braverman, 1988 ; Fronville, 1985). De fait, dans beaucoup de musées, ce qui est présenté l'est souvent en fonction d'un visiteur théorique et s'adresse en définitive à un public éduqué, sans rechercher suffisamment le moyen d'adapter le message aux attentes, aux motivations et aux habitudes respectives des divers groupes (ou segments) de visiteurs (Beaulac, Colbert et Duhaime, 1991). Dans la panoplie des études et des outils de recherche d'inspiration qualitative ou quantitative, qui se sont développés dans le secteur des musées, l'analyse de marché visera en particulier « à définir les groupes de clientèles susceptibles de fréquenter le musée, à évaluer l'impact de cette fréquentation sur les objectifs qu'il s'est assigné et les ressources dont il dispose et à déterminer les groupes qui seront privilégiés dans la mise en œuvre des programmes» (Trottier, 1987).
Dans les institutions où le marketing tient une place marginale, les recherches sur les consommateurs sont délaissées. Selon Kotler, « que les difficultés de l'organisation ne proviennent pas toujours de l'ignorance ou du manque de motivation des consommateurs peut être mis en évidence à partir d'enquêtes ». En revanche, dans les musées qui ont adopté une orientation marketing, les services du marketing s'efforcent non seulement de réagir aux changements dans les besoins, les désirs et les perceptions du consommateur, mais tentent également de les anticiper (voir, plus loin, des exemples allant dans ce sens). La recherche portant sur le « marché » de l'institution permet d'avoir une vue complète des consommateurs et de pouvoir tester les décisions sur un échantillon ciblé pour s'assurer de leur efficacité (Kotler et Andreasen, 1987).
L'APPLICATION DU MARKETING DANS LES MUSÉES
L introduction du marketing dans les musées, lorsqu'il est uniquement perçu, de façon restrictive, comme une technique de vente au service des entreprises privées, se heurte à de légitimes résistances, de la part du personnel scientifique notamment. Le frein principal provient d'une vision du marketing comme étant essentiellement une technique visant à augmenter les recettes commerciales et le nombre
56 De l'approche marketing
publics & musées n

des visiteurs, sans se préoccuper de la mission scientifique et éducative du musée. Introduire une philosophie marketing dans le musée reviendrait à gérer le musée en fonction des souhaits des visiteurs et à abandonner les objectifs de recherche et de conservation (Curry, 1982 ; Bigley, 1987 ; Van Kote, 1989).
De fait, la majorité des musées ne disposant pas d'un département ou d'une personne chargée du marketing, il s'agit, pour l'essentiel, d'une action de communication et de relations publiques, si l'on met à part les activités commerciales (mais il est vrai que les équipes des musées sont parfois très réduites) ; par ailleurs, c'est la motivation financière qui suscite principalement l'utilisation du marketing, plus que l'étude du public et la prise en compte de ses souhaits, de ses attentes, de ses motivations et de ses besoins. Cependant, l'absence de ressources suffisantes est souvent en elle-même un frein au développement d'une politique de marketing, en particulier dans le domaine de la segmentation de la communication et des services, qui demande des moyens importants (Beaulac, Colbert et Duhaime, 1991).
Dans plusieurs pays (France, Angleterre, Etats-Unis), l'administration a encouragé les musées à développer leurs ressources propres et à susciter, avec des attentes exagérées parfois, des actions de mécénat. S'il est vrai qu'en France l'essentiel du financement provient de ressources publiques (il est partagé de façon sensiblement égale entre l'Etat et les collectivités locales), il n'en demeure pas moins que la tendance est à une évolution vers une part croissante de fonds privés. Le parrainage d'expositions y est apparu depuis une dizaine d'années, sous l'influence de sociétés italiennes ou américaines.
Selon PADMICAL, le musée « apparaît depuis dix ans comme le lieu privilégié de l'expression culturelle du monde économique ». C'est ainsi que près de la moitié des conservateurs de musées auraient connu l'expérience du mécénat. Signalons les exemples de la Fondation Paribas, dans le domaine de l'édition de catalogues, de la Fondation du Crédit coopératif, qui a choisi d'aider les écomusées, ou du groupe Casino, associé au musée d'Art contemporain de Saint-Etienne (ADMICAL, 1990). Quant à l'UAP, elle a établi un partenariat avec la nouvelle Galerie du Jeu de Paume, qui permet à cette dernière de recevoir cinq millions de francs par an, sans compter une aide dans le domaine de la communication ; signe de l'implication de cette entreprise, qui reflète le souci des sociétés d'ancrer davantage leurs actions dans la durée et de concentrer leurs moyens sur un nombre réduit d'opérations, son PDG est le président du conseil d'administration du Jeu de Paume.
Mais les musées français ne pratiquent pas systématiquement une politique active de recherche de fonds privés et n'ont que rarement un interlocuteur pour les actions de mécénat. En ce qui concerne les musées nationaux, le mécénat d'une trentaine d'entreprises a néanmoins représenté un apport de plusieurs dizaines de millions de francs depuis 1985. La participation des entreprises à l'activité des musées devrait donc se développer à l'avenir. Signalons en outre l'existence de la procédure de cofinancement du Conseil Supérieur du Mécénat, inspirée des « matching
57 De l'approche marketing
publics & musées n

grants » américains ; associant fonds privés et concours publics, le Conseil peut accorder une aide à des opérations culturelles qui ont obtenu des contributions de mécénat.
La Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette a largement développé le partenariat avec les entreprises, sous des formes qui ne peuvent être réduites au mécénat. Les collaborations sont de plusieurs types : des coproductions, dans les espaces permanents et à l'occasion d'expositions temporaires (Philips, UTA, Elf- Aquitaine, Hermès, Matra, Renault, Rhône- Poulenc, Bull, Hewlett-Packard, CGE, Gaz de France, Michelin, Institut Mérieux...); des expositions réalisées par les entreprises elles-mêmes pour présenter leurs produits et leurs recherches (SNECMA, Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) ; des actions de parrainage pour les grands projets de la Cité, tels que celui de la Cité des Enfants ; la participation aux projets « jeunesse et formation » en direction des écoles et des enseignants (accueil dans les entreprises des classes Villette, conférences lors des entretiens Villette) ; la collaboration au plan international (Rhône-Poulenc a ainsi présenté une exposition à travers les Etats-Unis) ; les opérations spéciales, comme la journée portes ouvertes Gaz de France en 1990, par exemple ; les locations de la Géode et de salles du Centre de Congrès pour des assemblées générales, des conventions, etc.
Les musées français ont également été incités à augmenter leurs ressources propres à travers la création de boutiques, de restaurants, de programmes payants ou de locations de salles. Encouragés par la demande du public, qui suscite une professionnalisation accrue des prestations et des services offerts, ils se dotent peu à peu des services qui leur faisaient défaut et se donnent les moyens d'un certain autofinancement. La création d'infrastructures d'accueil, l'organisation de manifestations temporaires et le développement d'une approche marketing sont, en effet, de nature à diversifier les sources de financement des musées, qui doivent veiller toutefois à la préservation de leurs missions traditionnelles de conservation des œuvres, d'étude des collections et d'éducation du public.
Citons, à titre d'exemple, le cas du musée de l'Impression sur Etoffes de Mulhouse, qui possède plusieurs millions d'échantillons et 50.000 tissus. Son service d'utilisation des documents (S.U.D.) lui permet d'assurer des prestations de services en faveur des industriels du textile, aussi bien français qu'étrangers, et d'en retirer des revenus pour son fonctionnement. Cent cinquante entreprises peuvent être considérées comme des clients réguliers, dont la moitié est constituée d'entreprises étrangères, surtout anglaises et américaines. Le suivi des clients est assuré par des moyens informatiques. Le musée développe également une activité commerciale à travers une boutique spécialisée, une opération de vente par correspondance et des points de vente situés chez des revendeurs qui diffusent l'image du musée à l'extérieur de Mulhouse et augmentent sa notoriété ; enfin, le musée réédite des produits à partir des échantillons provenant de ses collections. Le S.U.D et l'activité commerciale assurent chacun environ un tiers du budget du musée.
58 De l'approche marketing
publics & musées n

L'exemple des musées de société est également là pour prouver qu'un musée peut couvrir 50% de ses frais de fonctionnement par l'autofinancement, voire plus, comme c'est le cas des écomusées de Haute- Alsace, de Chazelle-sur-Lyon ou du Quercy. Du reste, des formules de gestion inédites se mettent en place pour remplacer la formule de la gestion en régie municipale directe, jugée trop contraignante, sous forme d'association, de société d'économie mixte ou même de société anonyme (pour les activités commerciales) afin d'aller vers une plus grande autonomie de gestion des musées. En effet, les contraintes d'organisation et d'administration sont souvent un frein au développement de politiques novatrices dans les musées, tandis que la lourdeur des procédures ne favorise pas la recherche d'une certaine souplesse de gestion (les grands musées nationaux français bénéficient toutefois d'une plus grande autonomie par la déconcentration de certains crédits).
Pourtant, les responsables d'établissements ne sont pas toujours conscients de l'intérêt d'une politique commerciale que leur musée pourrait développer même s'il convient, comme dans d'autres domaines, de tenir compte de la taille du musée et de ses effectifs ; un certain nombre de grands musées n'ont pas encore de comptoir de vente attractif et donc capable de créer des revenus. Par ailleurs, l'inadéquation de la gamme de produits proposés et l'absence de stratégie commerciale de beaucoup de musées français incite à penser que leur potentiel commercial est aujourd'hui sous-exploité. À l'inverse, la Réunion des Musées nationaux, l'organisme qui gère les activités commerciales des musées nationaux, a connu une importante croissance de son chiffre d'affaires, supérieur à 250 millions de francs (réalisé principalement au Louvre, à Orsay et à Versailles) et s'est même ouvert avec succès à la vente par correspondance. Quant au Centre Georges Pompidou, il a vendu 75.000 exemplaires du catalogue de l'exposition sur Vienne (1986) et 80.000 exemplaires du catalogue Dali (1979)-..
La gestion des boutiques devient dans certains musées une entreprise efficace et dont l'objet est la rentabilité financière ; par ailleurs, leur localisation à l'intérieur du musée dépend désormais de la prise en compte des flux de visiteurs. D'autre part, les ventes sont aujourd'hui davantage dépendantes des phénomènes de modes ou d'opinion, que les responsables des musées doivent s'efforcer de suivre ou d'anticiper, ainsi que du phénomène des grandes expositions temporaires qui s'accompagnent de plus en plus systématiquement d'un « merchandising » ciblé sur le contenu de l'exposition (Morin, 1987 ; Rudman, 1989 ; Tobelem, 1990). Mais pour la plupart des musées, les recettes commerciales sont surtout un moyen de créer des revenus qui permettront à l'institution de remplir sa fonction éducative et de mettre en place des programmes à destination du public. La différence avec les entreprises privées tient dans l'utilisation des revenus commerciaux, qui ne sont pas attribués aux dirigeants ou aux actionnaires, mais qui sont reversés dans le budget du musée, pour autant toutefois qu'il dispose d'une autonomie financière.
Certains musées seront conduits de plus en plus à se placer dans une perspective de développement de leur fréquentation par le biais du tou-
59 De l'approche marketing
publics & musées n°2

risme culturel, ce qui nécessite une révolution des mentalités passant par une nouvelle politique d'accueil, de communication et de développement de programmes. Cet aspect est particulièrement flagrant lorsque l'on sait qu'une part déterminante de la fréquentation de certains musées est le fait de touristes étrangers. Les musées qui sauront capter cette manne par une approche professionnelle seront en mesure de développer leurs ressources propres ; en prouvant qu'ils peuvent constituer un moteur du développement local, ils seront également à même d'attirer de nouveaux partenaires. Ainsi, aux Pays-Bas, les organisations touristiques nationales « souhaitent avoir encore plus d'événements touristiques de qualité comme les expositions Van Gogh et Rembrandt qui sont faciles à vendre à un public international. L'exposition Van Gogh en 1990 avec 900.000 visiteurs (dont 55% étaient des visiteurs étrangers) et un revenu pour l'industrie touristique de 525 millions de florins (1,6 milliard de francs) met en appétit tous les professionnels. » (Vels Heijn, 1992).
Dans les musées, le marketing peut donc être utilisé pour rationaliser une logique de développement de ressources propres, passant par la création ou l'accélération des programmes commerciaux (boutiques, restaurants, locations d'espaces), par l'intensification des programmes de collecte de fonds auprès des particuliers ou des entreprises ainsi que par le développement des programmes d'abonnements, mais également pour permettre au musée d'atteindre plus efficacement ses objectifs culturels. Cet outil de gestion offre, en effet, aux musées un cadre d'analyse et d'intervention dans plusieurs domaines (Fronville, 1985) :
-pour les programmes éducatifs: l'analyse marketing aidera à mettre en place l'ensemble des activités proposées par le musée en direction des différents publics préalablement identifiés (visites de classes, conférences, visites guidées, films, livres...) ;
-pour les programmes d'adhésion et de collecte de fonds : l'approche marketing sera utilisée pour augmenter le nombre des adhérents du musée et proposer des programmes de partenariat aux entreprises ;
-pour augmenter les ressources propres : qu'il s'agisse de boutiques de musée, de programmes commerciaux associés à des expositions temporaires, de locations de salles, de licences ou de concessions ;
- dans le domaine des relations publiques: leur objet sera de mettre en valeur de façon cohérente chacun des programmes précédents à travers les différents supports média, la publicité et les outils de communication des sponsors.
Ces différents aspects de la politique de marketing peuvent être présents dans les musées mais ils sont rarement articulés entre eux dans une démarche cohérente, coordonnée et rigoureuse, celle que permet de définir une stratégie de marketing qui découle des objectifs de l'institution. En général, « le marketing n'est pas intégré dans un processus mana- gérial global basé sur la réalisation de la mission de l'institution ». (Beaulac, Colbert et Duhaime, 1991). De fait, peu d'institutions disposent d'un véritable plan marketing.
60 De l'approche marketing
publics & musées n

LA SPECIFICITE DU MARKETING DES MUSÉES
u ne étude d'Allen et Schewe examinant la manière dont des directeurs de musées considèrent le marketing montre que, comparés aux praticiens du marketing, les professionnels des musées sont moins portés à chercher à obtenir des informations sur ce que les visiteurs aimeraient trouver dans le musée ; ils considèrent volontiers que leur « produit » est destiné à satisfaire chacun plutôt que destiné à des consommateurs particuliers ; ils sont moins intéressés par des modifications de prix ; ils sont moins désireux de changer leur stratégie de distribution ; enfin, ils sont moins portés à vouloir modifier à l'avenir la nature des produits et des services offerts aux consommateurs (étude citée par Kotler et Andreasen, 1987).
Cela signifie-t-il que les responsables d'institutions culturelles doivent se plier aux exigences du public et concevoir leurs programmes uniquement en fonction de ses désirs ? Ce serait mal comprendre l'utilité du marketing : il s'agit en réalité de partir des préoccupations du visiteur, de ses besoins, de ses souhaits et de les interpréter. Ainsi, dans le cas où des enquêtes viendraient souligner que le public imagine que le musée est réservé à une élite intellectuelle et sociale, ce dernier pourra s'efforcer de mettre en place des programmes destinés à un public peu familiarisé avec les musées, créer une atmosphère détendue et informelle, et prévoir des événements susceptibles d'amener les non-visiteurs à découvrir ce qu'est réellement le musée. L'un des résultats de cette philosophie est le haut degré de satisfaction dont font état les visiteurs, qui deviennent dès lors les meilleurs avocats de l'institution et accroissent sa réputation par la vertu du bouche-à-oreille.
À l'inverse, certains responsables de musées ne se soucient pas suffisamment d'être intéressants pour le public ou de répondre aux préoccupations des visiteurs dans les espaces d'exposition, même si tout porte à croire que ces derniers ne sont pas satisfaits de ce qui leur est proposé, quand il ne s'agit pas tout simplement d'un manque de ressources humaines ou financières (Helleu, 1991).
Considérant que certaines organisations pensent sincèrement être orientées vers le consommateur ou bien souhaiteraient le devenir, Kotler et Andreasen définissent plusieurs critères permettant de déterminer si elles le sont réellement :
- La nature du produit offert conduit les responsables du musée à en avoir une très haute opinion qui s'accommode mal de phénomènes de refus ou d'indifférence. Ainsi certains conservateurs sont-ils sincèrement perplexes devant le manque de réussite d'une exposition auprès du public, en dépit de la qualité des objets présentés.
- L'ignorance du consommateur ou son absence de motivation sont rendus responsables du manque de succès de l'institution. Un directeur de musée peut penser qu'il suffit d'accentuer les efforts de communication ou de trouver des incitations nouvelles pour attirer les visiteurs dans son musée en brisant leur inertie « naturelle ».
61 De l'approche marketing
publics & musées n

- Le marketing est assimilé à la promotion : les questions d'image, de matériel de communication, de communiqués de presse, de publicité... accapareront l'attention des responsables au détriment des autres éléments du marketing que sont la fixation des prix, la définition des produits et leur distribution.
- Plutôt que d'engager un spécialiste du marketing, on choisira de préférence quelqu'un qui connaît le monde des musées ou qui peut être un ancien employé de l'institution ; ou bien alors une personne dont la spécialité est la communication. Ce n'est pas tant la maîtrise d'une technique, le marketing, que la connaissance d'un produit particulier ou un talent pour la communication qui seront valorisés dans ce cas, ce qui est conforme à une logique de lutte contre l'ignorance et le manque d'intérêt des visiteurs potentiels.
- La méconnaissance du marché amène à une vue simpliste, ce qui conduit à la recherche d'une ou deux stratégies destinées aux segments les plus évidents et à la méfiance envers les innovations et la prise de risque. Ainsi, le public du musée sera assimilé à un bloc monolithique, ne laissant pas place à des stratégies alternatives ou complémentaires.
De fait, le praticien du marketing accorde une importance particulière à la segmentation, qui découle du fait que le marché apparaît comme une combinaison de nombreux sous-segments qui relèvent de programmes marketing séparés. On appelle segmentation «l'action de regrouper les unités composant un marché en sous-groupes, de sorte que chaque groupe soit caractérisé par des besoins homogènes et que les différents groupes s'opposent entre eux par des besoins hétérogènes » (Beaulac, Colbert et Duhaime, 1991). Ainsi, les visiteurs de musées sont composés du public local, des professionnels, des groupes scolaires, des touristes français, des touristes étrangers, etc. De même, les programmes éducatifs peuvent être destinés au public scolaire ou universitaire, aux adultes, aux personnes âgées, aux handicapés... Cette approche plus sophistiquée conduira à la mise en place de stratégies différenciées (positionnement), utilisant des voies de communication distinctes et s'adres- sant à des cibles différentes (ciblage). Dans le cas contraire, certaines stratégies efficaces pour un segment de la population pourraient fort bien repousser un autre groupe de consommateurs dont les motivations seraient à l'opposé de celles du premier ensemble.
Supposons que l'on isole un segment d'amateurs avertis, qui souhaitent des expositions de haut niveau faisant appel à des artistes nouveaux ; la stratégie de communication qui consisterait à mettre en avant le programme des expositions et la découverte de nouveaux talents risque de rebuter une clientèle plus intéressée par l'aspect de sortie familiale de la visite au musée et qui peut être intimidée par l'absence de familiarité avec le monde de l'art. De façon schématique, ce sont bien deux stratégies de communication distinctes qui devraient être mises en œuvre en cherchant à éviter le chevauchement des campagnes (Kotler et Andreasen, 1987). En revanche, l'objectif premier des responsables de musée doit être de définir un projet global qui découle de la mission de l'institution, qui sera exprimé par un concept fort et qui tiendra compte des aspirations des
62 De l'approche marketing
publics & musées n

visiteurs (voir ci-après les développements consacrés à la notion de mission du musée).
Il reste que l'application du marketing aux musées, comme aux institutions à but non lucratif en général, se heurte à une difficulté, celle de mesurer les « performances » de l'institution, ce qui peut conduire à une surestimation des critères quantitatifs qui se prêtent le plus facilement à une évaluation. Ainsi, note Kotler, comment mesurer que le contenu d'une visite de musée est devenu plus éducatif ou que le musée a conduit à une augmentation de la qualité de la vie ? Le danger réside dans la tentation de chercher à atteindre en priorité ce qu'il est possible de quantifier : la taille d'un budget, le nombre de visiteurs, les bénéfices commerciaux (Ames, 1989).
LES RISQUES D'UNE APPLICATION NON CONTRÔLÉE
L question centrale que se posent tous les directeurs de musées inquiets des perspectives offertes par le marketing est la suivante : leurs critères professionnels, l'intégrité de l'institution, ses programmes scientifiques, historiques ou artistiques ne risquent-ils pas d'être mis en péril par l'introduction de cette technique ? S'agira-t-il désormais de chercher à plaire au plus grand nombre, d'abaisser la qualité de l'institution ?
À cela, les théoriciens du marketing répondent que le marketing n'est pas un but en lui-même ; il ne saurait être qu'un moyen au service de l'organisation, destiné à lui permettre d'atteindre efficacement ses objectifs. Le marketing est donc une branche de l'administration parmi d'autres et il est de la responsabilité des dirigeants de l'institution de déterminer son champ d'application. La direction peut ainsi décider d'ignorer les préoccupations de marketing au profit d'autres critères jugés plus importants (Kotler et Andreasen, 1987).
Le programme des expositions d'un musée pourra faire appel complètement, en partie ou pas du tout aux considérations de marketing. On constate que certains musées réalisent un équilibre dans l'établissement de leur calendrier d'expositions entre des expositions « populaires » et des expositions plus confidentielles mais répondant à des motifs artistiques plus élevés. Néanmoins, une fois le programme fixé, il importe au service du marketing de contribuer à sa réussite dans les limites déterminées, mais en partant des caractéristiques du visiteur. De même, il appartient aux responsables du marketing d'établir la description, la présentation, le prix et la distribution des programmes du musée, sans en modifier toutefois le contenu, en fonction de ce qu'indiquent les recherches effectuées sur les visiteurs.
Le seul garde-fou permettant d'assurer que la politique de marketing du musée sera mise en œuvre pour lui permettre d'atteindre ses objectifs consiste dans la détermination et la conscience de la mission du musée.
63 De l'approche marketing
publics & musées n

En effet, si cette mission n'est pas clairement définie et assimilée par l'ensemble du personnel, une direction marketing forte n'aura guère de difficultés à imposer ses propres critères de jugement et d'appréciation (Ames, 1989)- Les risques de dérive sont notables et abondamment soulignés par les observateurs les plus critiques : le programme des expositions tendra à suivre les goûts les plus traditionnels du public au détriment d'expositions plus ambitieuses et moins assurées d'un succès populaire ; les fonctions de recherche et de conservation des collections passeront au second plan ; enfin, les objectifs éducatifs seront considérés comme moins importants que les résultats financiers du musée (Ames, 1989; Bryan, 1989 ; Tobelem, 1990).
Parmi ces risques de dérive, on peut souligner ceux qui se rapportent à la programmation des expositions et aux actions de mécénat. Les responsables de musées ont été progressivement amenés à tirer les conséquences des bienfaits des grandes expositions sur leur compte d'exploitation et à mesurer leur impact sur le mécénat et les autres sources de financement, qu'il s'agisse de la croissance spectaculaire des recettes d'entrées, de l'augmentation sensible du nombre d'adhérents, de l'accroissement des revenus commerciaux ou de l'amélioration de la notoriété du musée. Le directeur du Metropolitan Muséum de New York, Philippe de Montebello, s'est déclaré inquiet de la dépendance des grands musées à l'égard des expositions temporaires, qui a eu, selon lui, une influence indéniable sur le fonctionnement de ces institutions. En effet, ces grandes expositions (« blockbusters ») deviennent des instruments de développement et un moyen de. combler le déficit du musée ; dès lors, le programme d'expositions du musée tend à être considéré par les gestionnaires du musée comme étant au service du budget du musée et non l'inverse... (Montebello, 1984).
En ce qui concerne le mécénat, on sait que certaines expositions permettront difficilement d'intéresser une entreprise, quelle que soit la qualité et l'ambition du projet. Les responsables du musée doivent donc veiller à ne pas se laisser entraîner vers une programmation influencée par la recherche de partenaires financiers. On peut, du reste, noter une multiplication de ces expositions dont le contenu novateur et scientifique n'est pas toujours évident, mais dont la popularité assurée offre toutes les garanties de retombées médiatiques positives pour le sponsor. Il est également nécessaire pour les musées de déterminer le type de relations pouvant s'établir avec les entreprises pour éviter de céder à des exigences jugées excessives de ces dernières.
Associé hier au monde des entreprises privées et à la recherche du profit, puis étendu au secteur des organisations sans but lucratif avant d'être appliqué au monde de la culture, le marketing élargit donc aujourd'hui son champ d'action en direction des musées. L'entrée de cette technique de gestion peut y trouver sa justification dans l'orientation financière actuelle des musées (revenus commerciaux, mécénat, collecte de fonds) ainsi que dans les nécessités de la communication contemporaine (publicité, relations publiques, marketing direct, création d'événements).
64 De l'approche marketing
publics & musées n

Mais au-delà de cette approche guidée par le souci d'une meilleure efficacité de gestion, le marketing fournit également les outils théoriques et pratiques d'une analyse du public (et du non-public) des musées, qui procède d'une démarche cruciale pour la réalisation des objectifs de cette institution et pour l'accomplissement de sa mission. Or, seule la connaissance des attentes et des perceptions des visiteurs peut permettre aux musées d'y parvenir efficacement (Garfield, 1992), comme le confirment les nombreuses initiatives conduites dans ce domaine à la demande des conservateurs (débats, recherches, études et réflexions sur les différents catégories de visiteurs, les attentes du public, l'éducation dans les musées, l'évaluation des expositions, etc.).
Pour réconcilier dans la pratique ces deux orientations (gérer efficacement et répondre aux objectifs de l'institution), il est de la responsabilité de la direction du musée d'établir un projet fort et de définir une stratégie qui découle de la mission éducative, scientifique et culturelle du musée, au service duquel la politique de marketing sera mise en œuvre. Si cette mission est précisément définie et les priorités clairement affichées, les risques de dérive qui peuvent naître d'une application non contrôlée des techniques de marketing seront probablement maîtrisés et le marketing demeurera un outil au service du musée.
J-M. T. Consultant
(Auteur de Musées et Culture: le financement à l'américaine)
REMERCIEMENTS Nous souhaitons remercier Jeanne-Michèle Cresté pour ses suggestions ainsi que pour la relecture attentive de cet article.
65 De l'approche marketing
publics & musées n

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
A.D.M.I.C.A.L. 1990. Répertoire 1989- 1990 du Mécénat culturel. Paris : Association pour le Développement du Mécénat industriel et commercial.
Ames (P.). 1989. «Marketing in Muséums : Means or Master of the Mission ? », Curator, 32.
Aykaç (A.). 1989- «Eléments d'une analyse économique des musées », Muséum , 2.
Balle (C). 1987a. Le Changement institutionnel dans les musées français et américains. Paris : Département des Etudes et de la Prospective. Ministère de la Culture.
Balle (C). 1987b. « Les nouveaux musées, une incidence institutionnelle de l'évolution culturelle», Brises,10, p. 13-16.
Bayard (D.), Benghozi (P.J.). 1992. Diversification et activités commerciales dans les musées: une comparaison internationale. Paris : Ecole polytechnique, Centre de ressources de gestion.
Beaulac (M.), Colbert (F.), Duhaime (C). 1991. Le Marketing en milieu muséal .- une recherche exploratoire. Montréal : Groupe de recherche et de formation en gestion des arts, Ecole des Hautes Etudes commerciales de Montréal.
Bigley 0- D.). 1987. « Marketing in Muséums : Background and Theo- retical Foundations », Muséum Studies fournal, vol. 3 (1).
Birobent (F.). 1987. Communication, marketing et muséologie ; étude sur les musées d'histoire naturelle de province. Paris : Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.
Braverman (B. E.). 1988. « Empowering Visitors : Focus Group Interviews for Art Muséums », Curator, 31 (1).
Bryan (C. F., Jr.). 1989. ■■ How Far Hâve We Corne, How Far Do We Go ? », History News, July-August.
Curry (D. J.). 1982. « Marketing Research and Management Décisions », The fournal of Arts Management and Law, vol. 12 (1).
DiMaggio (P.). 1985. «When the «Profit» Is Quality ; Cultural Institutions in the Marketplace », Muséum News, June, p. 28-35.
Fronville (C. L.). 1985. «Marketing for Muséums : For-profit Techniques in the Non-profit World», Curator, 28 (3).
Garfield (D.). 1992. «Frances Hesselbein : Managing for the Mission », Muséum News, March-April, p. 66-67.
Greffe (Xavier). 1990. La Valeur économique du patrimoine. Paris : Anthropos-Economica .
Helleu (E.). 1991. «Musées : le 'livre noir' des visiteurs », L'Evénement du Jeudi, 18-24 juillet, p. 98-101.
Kotler (P.), Andreasen (A. R.). 1987. Stratégie Marketing for Non-profit Organizations. Englewood Cliffs : Prentice-Hall.
Kotler (P.), Levy (S. J.). 1969. «Broadening the Concept of Marketing », fournal of marketing. 33 (January), p. 10-15.
Labouret (Claude), de Narp (Olga). 1990. Le Nouveau Visage des musées ; la vocation culturelle et le service du public. Paris : Institut La Boétie.
Lovelock (C. H.), Weinberg (C. B.). 1984. Marketing for Public and Non-profit managers. New York : John Wiley and Sons.
Luck (D. J.). 1969. « Broadening the Concept of Marketing Too Far », fournal of marketing, 33 (July).
Mayaux (F.). 1987. « Le marketing au service de la culture », Revue française du marketing, N°113.
Mercillon (H.). 1977. « Les musées, institutions à but non lucratif dans l'économie marchande », Revue d'économie politique, T. LXXXVII (4).
Mercillon (H.). 1988. « Les musées britanniques à l'heure de Margaret Thatcher », Connaissance des arts, AAO (octobre), p. 125-130.
Mokwa (M. P.), Dawson (W. M.), Prieve (E. A.). 1984. Marketing the Arts. New York : Praeger.
Montebello (P. de). 1984. « The High Cost of Quality », Muséum News, August, p.46-49.
Morin (F.). 1987. « Un musée peut-il être rentable ? », Science & Vie Economie, 25 (février).
Peterson (R. A.). 1986. « De l'imprésario à l'administrateur, le rôle du contrôle de gestion dans l'évolution de l'administration des arts ». Colloque internatio-
66 De l'approche marketing
publics & musées n

nal de Marseille, sous la direction de R. Moulin. Paris : La Documentation française.
Pommerehne (W. W.), Frey (B. S.)- 1980. « Les musées dans une perspective économique », Revue internationale des Sciences sociales, vol. XXXII, n°2, p 345-362.
Rados (D. L.). 1981. Marketing for Non- profit Organizations. Boston : Auburn House.
Rosenthal (A.). 1982. « Muséums Jump Into the Marketing Game », Advertising Age, September 27.
Rudman (Anita). 1989. « Les musées ouvrent boutique », Le Monde Affaires, 1er avril.
Tobelem (J.-M.). 1990. Musées et culture, le financement à l'américaine. Mâcon : Ed. W/MNES.
Trottier (L.). 1987. Les Etudes de marché dans quelques établissements muséolo- giques du Canada, in Presse de l'Université du Québec, vol. 10 (1), p. 103-119.
Van Kote (Fabrice). 1989. Critique d'un marketing des musées : vers un échange réciproque. Paris : Maîtrise d'information et de communication, CELSA, Université de Paris IV.
Vels Heijn (Anne-Marie). 1992. « L'art au service du tourisme ? », La Lettre des musées et des expositions, n°42.
67 De l'approche marketing
publics & musées n

RESUMES
c «et article a pour but de présenter certaines des recherches réalisées dans le domaine du marketing des musées, replacées dans le contexte de ces institutions et du marketing lui-même.
Sont donc examinées les conditions de l'apparition du marketing dans les musées, ses spécificités et les risques d'une application non contrôlée de ses méthodes. Finalement le marketing est analysé comme un outil qui doit rester au service des musées mais qui ne peut répondre à toutes les interrogations soulevées par les transformations de ces institutions.
T 1 hi he aim of this article is to présent research undertaken in the field of muséum marketing, within the context ofthe évolution of muséums and of marketing today.
Are therefore examined the conditions under which marketing made its appearance in the muséum world and the spécifie problems and risks that an uncontrolled application of thèse methods could bring about.
Finally, marketing is analysed as an instrument to serve muséums but which does not, and cannot, answer ail the questions raised by the transformations of thèse institutions.
E /l objetivo de este artïculo es el de presentar ciertas investigaciones realizadas en el campo del marketing de los museos, y centradas en el contexto de la evoluciôn de los mismos y del marketing en si.
Las condiciones de la aparicion del marketing en los museos son examinadas, asï como sus especificaciones y los riesgos de una aplica- ciôn difïcilmente contrôlable de sus métodos.
Finalmente, el marketing es analizado como un instrumente que debe estar al servicio de los museos pero que no puede responder a todas las interrogantes que surgen debido a las transformaciones de estas instituciones.
69 De l'approche marketing
publics & musées n

Illustration non autorisée à la diffusion