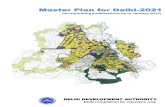19_mtartafe.pdf
-
Upload
rose-sanchez -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
Transcript of 19_mtartafe.pdf
-
CNUCED
MULTILATRALISME ET RGIONALISME: La nouvelle interface
NATIONS UNIES
-
CONFRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DVELOPPEMENT
MULTILATRALISME ET RGIONALISME:
La nouvelle interface
NATIONS UNIES
-
CONFRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DVELOPPEMENT
MMUULLTTIILLAATTEERRAALLIISSMMEE EETT RREEGGIIOONNAALLIISSMMEE
LLAA NNOOUUVVEELLLLEE IINNTTEERRFFAACCEE
Publication mise au point par
Mina Mashayekhi et Taisuke Ito
Nations Unies New York et Genve, 2005
-
NOTE
Les cotes des documents de lOrganisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention dune cote dans le texte signifie quil sagit dun document de lOrganisation.
_____________________________________________________________________ Les opinions exprimes dans le prsent volume sont celles des auteurs et ne refltent
pas ncessairement celles du Secrtariat des Nations Unies. Les appellations employes dans la prsente publication et la prsentation des donnes qui y figurent nimpliquent de la part du Secrtariat de lOrganisation des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorits, ni quant au trac de leurs frontires ou limites.
_____________________________________________________________________ Le texte de la prsente publication peut tre cit ou reproduit sans autorisation, sous
rserve quil en soit dment fait mention. Un exemplaire de la publication renfermant la citation ou la reproduction doit tre adress au secrtariat de la CNUCED: Palais des Nations, CH-1211 Genve 10, Suisse.
_____________________________________________________________________
UNCTAD/DITC/TNCD/2004/7
-
AVANT-PROPOS
On assiste une rsurgence du rgionalisme dans le systme de commerce international. Les accords commerciaux rgionaux se sont multiplis dans le monde; presque tous les pays sont membres dau moins un accord et beaucoup sont parties de multiples accords. Les accords existants sont revigors et tendus alors que de nouveaux accords sont en cours de ngociation ou dlaboration. Des mesures dintgration ont tendu leur porte, au-del du libre-change des marchandises traditionnel, un certain nombre de domaines de rglementation concernant les services, linvestissement et les droits de proprit intellectuelle, afin de renforcer lintgration au sein des pays partenaires. Le rgionalisme a retrouv son dynamisme et il ne fait pas de doute quil va demeurer un lment du systme de commerce au sens large.
Les pays en dveloppement participent activement ce mouvement. Ils considrent lintgration rgionale comme un moyen essentiel de croissance conomique, de dveloppement et de lutte contre la pauvret. Le principal problme de fond pour chaque pays en dveloppement est de savoir comment faire en sorte que lintgration rgionale contribue efficacement son dveloppement conomique.
Cette renaissance du rgionalisme concide avec lvolution du systme commercial multilatral travers les ngociations commerciales multilatrales, y compris dans le cadre du Programme de travail de Doha. lintrieur de ce systme couches multiples complexe et en pleine volution, les avantages tirs du commerce dpendent de plus en plus de la manire de grer efficacement les processus dintgration rgionale; inversement, les effets positifs que ces derniers peuvent avoir dpendent de la manire dont les ngociations commerciales multilatrales sont conduites et conclues. Il faut, pour cela, que les deux processus soient pris en compte de manire approprie pour chaque ngociation commerciale. Mener des ngociations parallles aux niveaux multilatral et rgional reprsente une tche herculenne pour les dcideurs et les ngociateurs qui doivent dfinir quels doivent tre les intrts de leur dveloppement national et les objectifs des ngociations.
Comment les pays en dveloppement peuvent-ils tirer le meilleur parti possible pour leur dveloppement de lensemble des accords et des ngociations commerciaux multilatraux, interrgionaux et rgionaux? Comment faire de linterface entre le multilatralisme et le rgionalisme un instrument efficace pour le dveloppement? Quels sont les effets sur le dveloppement des accords commerciaux rgionaux entre les pays dvelopps et les pays en dveloppement (les accords Nord-Sud) ainsi que de ceux qui sont conclus entre pays en dveloppement (les accords Sud-Sud), et comment faire pour porter un niveau aussi lev que possible leurs effets bnfiques? Voil quelques-unes des questions qui sont poses dans le prsent volume. Le principal dfi pour laction gouvernementale des pays en dveloppement est dassurer une cohrence et de mettre au point une interface constructive entre multilatralisme et rgionalisme au profit du dveloppement et de la lutte contre la pauvret.
Toutes ces questions sont complexes et ncessitent des recherches approfondies ainsi quune rflexion collective et une concertation. Cest partir de ces considrations qua t mis au point lordre du jour de la onzime session de la CNUCED qui sest tenue So Paulo (Brsil) du 13 au 18 juin 2004. Le thme gnral de la Confrence (Renforcer la cohrence entre les stratgies nationales de dveloppement et les processus conomiques mondiaux en faveur de la croissance conomique et du dveloppement, en particulier pour les pays en dveloppement), ainsi que son thme subsidiaire sur le commerce (Contribution effective du commerce international et des ngociations commerciales au dveloppement) entendaient attirer lattention des dcideurs sur les enjeux lis la cohrence entre les politiques nationales de dveloppement dune part et
iii
-
les ngociations commerciales sous-rgionales, rgionales, interrgionales et multilatrales dautre part, et permettre de parvenir une meilleure comprhension de ces enjeux ainsi qu un consensus leur sujet.
Les pays membres de la CNUCED ont relev le dfi et convenu, dans le cadre du Consensus de So Paulo, dexaminer et surveiller les liens entre le systme commercial multilatral et les accords commerciaux rgionaux, et de soutenir lintgration rgionale et la promotion du commerce Sud-Sud. La prsente publication est une premire contribution lexamen et lvaluation, dans loptique du dveloppement, de linterface entre le systme commercial multilatral et les accords commerciaux rgionaux.
En tant quorgane centralisateur des Nations Unies pour le traitement intgr des questions relatives au commerce et au dveloppement et celles qui leur sont apparentes, et conformment la mission qui lui a t dvolue la onzime session de la CNUCED, cette dernire continuera appuyer une intgration utile et quitable des pays en dveloppement au sein du systme commercial international et de lconomie mondiale. Nous esprons que cette publication contribuera faire comprendre la nouvelle interface en pleine volution entre le multilatralisme et le rgionalisme, et suscitera une rflexion collective sur les moyens de faire en sorte que ces deux composantes essentielles du systme commercial mondial soient profitables au dveloppement.
Le Secrtaire gnral adjoint charg de la CNUCED
Carlos Fortin
iv
-
REMERCIEMENTS
Le prsent volume comporte des communications faites au forum pralable la onzime session de la CNUCED sur Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface, qui a t organis le 8 juin 2004 la BNDES de Rio de Janeiro (Brsil), au cours de la Semaine commerciale de Rio, sous la responsabilit de Lakshmi Puri, Directrice de la Division du commerce international des biens et services, et des produits de base, par une quipe dirige par Mina Mashayekhi, Chef du Service des ngociations et de la diplomatie commerciales. Cette quipe tait compose de Bonapas Onguglo, Luis Abugattas et Taisuke Ito. Il a galement t fait appel aux importants travaux en cours de la CNUCED.
Ce volume a t prpar pour la publication par Mina Mashayekhi et Taisuke Ito.
Les principaux collaborateurs sont les auteurs des diffrents chapitres. La collaboration des participants au forum susmentionn na pas t moins importante, notamment celle de Carlos Fortin (Secrtaire gnral adjoint charg de la CNUCED), Francisco Thompson-Flres (Directeur gnral adjoint de lOMC) et Mario Mugnaini Jr. (Secrtaire excutif de la Chambre de commerce extrieur du Brsil). Une liste complte des participants figure en annexe 3 ci-aprs.
Mark Bloch a assur la prparation et le formatage du texte et Diego Oyarzun a conu la couverture.
v
-
TABLE DES MATIRES
Page
AVANT-PROPOS ................................................................................................................ iii
REMERCIEMENTS ............................................................................................................. v
NOTES SUR LES AUTEURS.............................................................................................. viii
ABRVIATIONS ................................................................................................................. x
I. MULTILATRALISME ET RGIONALISME: LA NOUVELLE INTERFACE .................................................................................. 1 Mina Mashayekhi, Lakshmi Puri et Taisuke Ito
II. REMARQUES DE M. FRANCISCO THOMPSON-FLRES.................................. 27
III. OBSERVATIONS SUR LE DYNAMISME DANS LINTERFACE ENTRE LE SYSTME COMMERCIAL MULTILATRAL ET LES ACCORDS COMMERCIAUX RGIONAUX: PERSPECTIVE DAPRS CANCN .............. 31 Nathan Irumba
IV. PROBLMES CONCERNANT LA NOTIFICATION LOMC DUN ACCORD COMMERCIAL RGIONAL .................................................................. 37 Bonapas Onguglo
V. LES RGLES DORIGINE: NOUVEAUX FILTRES DU COMMERCE MONDIAL.................................................................................................................. 57 Antoni Estevadeordal et Kati Suominen
VI. GARDER LE MULTILATRALISME ET LE DVELOPPEMENT PRSENTS LESPRIT: PROPOSITIONS POUR UN NOUVEAU MODLE DACCORDS NORD-SUD ...................................................................... 89 Ramn Torrent et Martn Molinuevo
VII. LE TRAITEMENT SPCIAL ET DIFFRENCI DANS LE CADRE DES ACCORDS COMMERCIAUX NORD-SUD .................................................... 107 Piragibe dos Santos Tarrag
VIII. RFLEXIONS SUR LINTERFACE ENTRE LOMC ET LES NGOCIATIONS DANS LA ZLEA ET ENTRE LA ZLEA ET LES ACCORDS DE LIBRE-CHANGE RCENTS DANS LHMISPHRE OCCIDENTAL ....... 109 Rosine M. Plank-Brumback
IX. INTGRATION ET COOPRATION SUD-SUD LATINO-AMRICAINES: DANS LA PERSPECTIVE DES BIENS DINTRT PUBLIC RGIONAUX...... 117 Mikio Kuwayama
vi
-
TABLE DES MATIRES (suite)
Page
X. RSOUDRE LES PROBLMES POSS PAR LACCS AUX MARCHS ET LES OBSTACLES LENTRE DES PRODUITS GRCE LINTGRATION RGIONALE POUR MAXIMISER LES GAINS DU DVELOPPEMENT: LEXPRIENCE DE LA CARICOM ............................. 153 Fay Housty
XI. ACCORD DE COOPRATION RGIONALE ET POLITIQUE DE LA CONCURRENCE LE CAS DE LA COMMUNAUT ANDINE.................... 161 Richard Moss Ferreira
XII. COOPRATION EN MATIRE DE CONCURRENCE DANS LES ACCORDS DINTGRATION RGIONALE, LEXEMPLE DE LUDAA........................................................................................ 167 James H. Mathis
XIII. RSOUDRE LES PROBLMES DACCS AUX MARCHS ET DES OBSTACLES LENTRE GRCE LINTGRATION RGIONALE: LEXPRIENCE DU COMESA ....................................................... 189 Mark Pearson
Annexe I: PROGRAMME DE LA RUNION................................................................. 197
Annexe II: RAPPORT DU FORUM SUR LE MULTILATRALISME ET LE RGIONALISME: LA NOUVELLE INTERFACE........................................ 203
Annexe III: LISTE DES PARTICIPANTS.......................................................................... 211
vii
-
NOTES SUR LES AUTEURS
M. Antoni Estevadeordal, principal conomiste et coordonnateur de la recherche, et Mme Kati Suominen, consultante la Division de lintgration du commerce et des questions continentales du Dpartement de lintgration et des programmes rgionaux, Banque interamricaine de dveloppement; auteurs du chapitre V, Les rgles dorigine: le nouveau filtre du commerce mondial.
Mme Fay Housty est Directrice des relations extrieures et communautaires au Secrtariat de la CARICOM. Elle est lauteur du chapitre X, Lever les obstacles laccs aux marchs et lentre des produits grce lintgration rgionale pour maximiser les gains en matire de dveloppement: lexprience de la CARICOM.
Ambassadeur Nathan Irumba est ex-Ambassadeur de lOuganda lOMC. Il est lauteur du chapitre III, Observations sur le dynamisme dans linterface entre le systme commercial multilatral et les accords commerciaux rgionaux: perspective daprs Cancn.
M. Mikio Kuwayama est administrateur charg de la Division du commerce international, Commission conomique pour lAmrique latine et les Carabes (CEPALC). Il est lauteur du chapitre IX, Intgration et coopration Sud-Sud latino-amricaines: dans la perspective des biens dintrt public rgionaux.
Mme Mina Mashayekhi est Chef du Service des ngociations et de la diplomatie commerciales de la CNUCED; Mme Lakshmi Puri est Directrice de la Division du commerce international des biens et services, et des produits de base de la CNUCED; M. Taisuke Ito est expert au Service des ngociations et de la diplomatie commerciales de la CNUCED. Ils sont coauteurs du chapitre I, Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface.
M. James H. Mathis, Dpartement de droit international lUniversit dAmsterdam, est lauteur du chapitre XII, Coopration en matire de concurrence dans les accords dintgration rgionale, un exemple de lUDAA.
M. Richard Moss Ferreira est Directeur gnral du Secrtariat gnral de la Communaut andine. Il est lauteur du chapitre XI, Accord de coopration rgionale et politique de la concurrence le cas de la Communaut andine.
M. Bonapas Onguglo est conomiste la Division du commerce international des biens et services, et des produits de base du secrtariat de la CNUCED. Il est lauteur du chapitre IV, Problmes concernant la notification lOMC dun accord commercial rgional.
M. Mark Pearson est Conseiller de lintgration rgionale au Secrtariat du March commun de lAfrique orientale et australe (COMESA). Il est lauteur du chapitre XIII, Lever les obstacles laccs aux marchs et lentre des produits grce lintgration rgionale: lexprience du COMESA.
Mme Rosine M. Plank-Brumback est spcialiste en commerce au Secrtariat gnral de lOrganisation des tats amricains. Elle est lauteur du chapitre VIII, Rflexions sur linterface entre lOMC et les ngociations relatives la ZLEA et entre la ZLEA et FTAA et les accords de libre-change rcents dans lhmisphre occidental.
viii
-
M. Piragibe dos Santos Tarrag est Chef de la Division des questions conomiques multilatrales au Ministre des relations extrieures du Brsil. Il est lauteur du chapitre VII, Le traitement spcial et diffrenci dans le cadre des accords commerciaux Nord-Sud.
M. Francisco Thompson-Flres est Directeur gnral adjoint de lOrganisation mondiale du commerce. Il est lauteur du chapitre II, Remarques de M. Francisco Thompson-Flres, Directeur gnral adjoint de lOMC.
Le professeur Ramn Torrent est Directeur de lObservatoire de la mondialisation lUniversit de Barcelone. M. Martn Molinuevo est membre de lObservatoire de la mondialisation et consultant au secrtariat de la CNUCED. Ils sont coauteurs du chapitre VI, Garder le multilatralisme et le dveloppement prsents lesprit: propositions pour un nouveau modle daccords Nord-Sud.
ix
-
ABRVIATIONS
ACP Groupe des tats dAfrique, des Carabes et du Pacifique ACR accords commerciaux rgionaux ADPIC (Conseil des) aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au
commerce AELE Association europenne de libre-change AFTA Zone de libre-change de lANASE AGCS Accord gnral sur le commerce et les services ALADI Association latino-amricaine dintgration ALALE Association latino-amricaine de libre-change ALE accord de libre-change ALENA Accord de libre-change nord-amricain ANASE Association des nations de lAsie du Sud-Est ANZCERTA Accord commercial entre lAustralie et la Nouvelle-Zlande dans le cadre de
relations conomiques troites ARI accords rgionaux dintgration ASACR Association sud-asiatique de coopration rgionale CACR Comit des accords commerciaux rgionaux CAE Communaut de lAfrique de lEst CAFTA Zone de libre-change dAmrique centrale CARICOM Communaut des Carabes CCG Conseil de coopration des tats arabes du Golfe CDAA Communaut de dveloppement de lAfrique australe CEAP Coopration conomique Asie-Pacifique CEDEAO Communaut conomique des tats de lAfrique de lOuest CEEAC Communaut conomique des tats dAfrique centrale CEMAC Communaut conomique et montaire de lAfrique centrale CEPALC Commission conomique pour lAmrique latine et les Carabes CNUCED Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement COI Commission pour locan Indien COMESA March commun de lAfrique orientale et australe UD union douanire DPI droits de proprit intellectuelle EEE Espace conomique europen FTA zone de libre-change GATT Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce MCA March commun andin MCCA March commun centramricain Mercosur March commun du Sud NCM ngociations commerciales multilatrales NPF nation la plus favorise OCE Organisation de coopration conomique OMC Organisation mondiale du commerce OMD Organisation mondiale des douanes OTC obstacles techniques au commerce PACE Programme daction pour la coopration conomique PACER Accord sur le renforcement conomique des pays du Pacifique PICTA Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique PMA pays les moins avancs SAFTA accord de libre-change dAsie du Sud
x
-
SCM systme commercial multilatral SGP systme gnralis de prfrences SGPC systme global de prfrences commerciales entre pays en dveloppement SPARTECA Accord de coopration commerciale et conomique pour la rgion du
Pacifique Sud SPS mesures sanitaires et phytosanitaires TEC tarif extrieur commun TSD traitement spcial et diffrenci UDAA Union douanire dAfrique australe UE Union europenne UEMOA Union conomique et montaire ouest-africaine UMA Union du Maghreb arabe ZLEA Zone de libre-change des Amriques
xi
-
Chapitre I
MULTILATRALISME ET RGIONALISME: LA NOUVELLE INTERFACE
Mina Mashayekhi, Lakshmi Puri et Taisuke Ito1
Introduction
Lordre du jour de la onzime Confrence de la CNUCED (CNUCED XI) a t centr sur la cohrence entre les stratgies nationales de dveloppement et les processus conomiques mondiaux pour favoriser la croissance conomique et le dveloppement, notamment dans les pays en dveloppement2. Le commerce international et les ngociations commerciales la fois au niveau multilatral dans le cadre de lOMC, et au niveau rgional (y compris les niveaux bilatral, sous-rgional et interrgional) constituent un aspect important de cet ordre du jour. Linterface entre les deux processus a de srieuses incidences sur le commerce et les perspectives de dveloppement des pays en dveloppement. Ils peuvent tre complmentaires et cohrents avec le systme commercial multilatral (SCM), facilitant ainsi le commerce international tout en amliorant les perspectives de dveloppement, ou bien ils peuvent diverger et saper, par l, les efforts collectifs et nationaux dploys pour faire du commerce international le moteur de la croissance et du dveloppement. La cohrence entre le multilatralisme et le rgionalisme devient un moyen et un dfi relever pour permettre aux pays (dans le cadre de leurs accords commerciaux) et lOMC de sadapter un systme commercial international en pleine volution afin de maximiser leurs avantages potentiels et de rduire au minimum leurs effets nfastes potentiels.
Pour que linterface entre les initiatives rgionales et multilatrales puisse tre gre efficacement, il faut que la synergie soit plus importante entre les objectifs nationaux de dveloppement et les engagements extrieurs. Au cur de ce dfi que doivent relever les pays en dveloppement, on trouve la ncessit de concevoir et de mettre en uvre par tapes adquates et selon un rythme appropri un processus de libralisation aux plans national, rgional et multilatral, de manire maximiser les gains en termes de dveloppement obtenus grce ces processus de libralisation du commerce et ces engagements en matire de rglementation, en faisant en sorte que les processus rgionaux et la libralisation multilatrale soient complmentaires et cohrents. Lun des dfis consiste en ce que la participation simultane de pays un ensemble daccords commerciaux rgionaux (ACR) tout en sengageant galement dans le systme commercial multilatral en pleine volution, les calendriers de ces deux derniers prsentant des chevauchements, a des effets de plus en plus importants sur les politiques de dveloppement sensibles et pse par trop sur les capacits de ngociation des pays en dveloppement. Pour ngocier et profiter des ACR, il faut bnficier dimportantes ressources et infrastructures humaines et institutionnelles et remdier aux asymtries structurelles, y compris en raison de la taille du pays et des conditions conomiques. Cette nouvelle interface entre le multilatralisme et le rgionalisme en termes de cohrence et de compatibilit mrite que les dcideurs lui accordent une attention particulire et ncessite un examen mticuleux et approfondi.
1 Les auteurs souhaitent remercier M. James Mathis de lUniversit dAmsterdam et M. Bonapas Onguglo du secrtariat de la CNUCED pour leurs observations judicieuses sur une version prliminaire du prsent chapitre. Les auteurs se portent responsables de toute erreur pouvant subsister. Les opinions exprimes dans le prsent chapitre sont celles des auteurs et ne reprsentent pas celles du secrtariat de la CNUCED. 2 TD/L.368, 17 mai 2004.
1
-
Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
Le prsent chapitre prsente quelques ides initiales sur la nouvelle interface entre le multilatralisme conscutif la cration de lOMC, en volution constante, et le rgionalisme de nouvelle gnration qui est en expansion; il sagit de dfinir des moyens pour rpondre aux exigences importantes des politiques dcoulant de linterface qui volue entre les deux processus, et de faire de cette dernire un lment positif et durable permettant aux pays en dveloppement de raliser des avances en matire de dveloppement grce au commerce international et aux ngociations commerciales avec les pays trangers; cela concourra permettre datteindre les objectifs du Millnaire pour le dveloppement. La section I prsente un aperu de lvolution rcente des politiques lintrieur du systme commercial international, ainsi que des initiatives et des processus dintgration rgionaux. Dans la section II on trouvera un bilan des effets de la libralisation des changes au plan rgional par rapport au plan multilatral, ainsi quune rflexion sur les avantages et les inconvnients du second par rapport au premier et sur leur complmentarit. La section III est consacre la question de politique gnrale qui consiste savoir comment les pays en dveloppement pourraient grer paralllement les ngociations menes aux plans rgional et multilatral dans le cadre des rgles de lOMC sur les ACR, en ce qui concerne les problmes daccs aux marchs (des produits agricoles et non agricoles, ainsi que des services), les obstacles non tarifaires et les questions de rglementation. La section IV est centre sur une forme particulire dACR, les accords Nord-Sud, alors que la section V traite du potentiel de la coopration et de lintgration commerciales Sud-Sud. La section VI conclut le chapitre en prsentant quelques recommandations.
I. Le systme commercial multilatral en pleine volution et les accords commerciaux rgionaux de nouvelle gnration
Les conclusions des ngociations multilatrales du Cycle dUruguay, en 1994, et la cration en 1995 de lOMC destine apporter un appui institutionnel aux accords commerciaux multilatraux, ont constitu un tournant important dans lvolution du systme commercial multilatral. En vertu du principe de lengagement unique, tous les membres de lOMC taient tenus par les rsultats de ces ngociations (exception faite des accords plurilatraux), ce qui renforait le principe fondamental du traitement de la nation la plus favorise (NPF). La conclusion du Cycle dUruguay et le renforcement du systme commercial multilatral laissaient penser que des exceptions au multilatralisme, telles que les accords commerciaux rgionaux, bien qutant couvertes par lOMC dans certaines conditions, perdraient une partie de leur intrt en tant qualternative de politique pour les pays, ou bien devraient tre adaptes et gres de manire tre orientes vers lextrieur plutt que linverse et contribueraient ainsi construire le nouveau multilatralisme introduit par lOMC.
Cet objectif a t constamment soulign dans les dclarations ministrielles de lOMC qui raffirment la foi de cette organisation dans la suprmatie du multilatralisme, tout en reconnaissant le rle important que peuvent jouer les ACR. Cela apparat dans le paragraphe 4 de la Dclaration de Doha, o les membres de lOMC soulignent leur attachement lOMC en tant quenceinte unique pour llaboration de rgles commerciales et la libralisation des changes au niveau mondial, tout en reconnaissant galement que les accords commerciaux rgionaux peuvent jouer un rle important pour ce qui est de promouvoir la libralisation et lexpansion des changes et de favoriser le dveloppement. Dans le programme de travail adopt Doha, les membres de lOMC ont galement convenu dorganiser des ngociations visant clarifier et amliorer les dispositions existantes de lOMC concernant les ACR tout en tenant compte de leurs aspects relatifs au dveloppement (par. 29). Ces derniers sont lexpression concrte de laccent plus large mis, dans le Programme de travail de Doha, sur les questions concernant le dveloppement, y compris celles qui ont trait aux problmes et aux proccupations lis la mise en uvre, au traitement spcial et diffrenci et lassistance technique.
2
-
I: Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
Ainsi quil a t reconnu dans ces dclarations, la croissance, lexpansion et le renforcement des accords commerciaux rgionaux ont t remarquables. Quelque 285 ACR avaient t notifis lOMC en 2003, dont 215 sont actuellement en vigueur, et il y en aura plus de 300 en 2007 si 60 autres, actuellement en cours de ngociation et 30, qui en sont au stade de la proposition, sont conclus3. Presque tous les pays du monde et la quasi-totalit des membres de lOMC ( lexception de la Mongolie) sont aujourdhui parties au moins un ACR ou sont en ngociation pour le devenir. Ainsi, le rgionalisme est devenu une option politique pour la plupart des pays et est un lment permanent de lenvironnement commercial international pour les annes venir.
La rcente monte du rgionalisme prsente un caractre notable, savoir que les pays qui ont t traditionnellement favorables lapproche multilatrale de la libralisation des changes, y compris lAustralie, la Nouvelle-Zlande, le Japon, Singapour, lInde et la Rpublique de Core, ont rejoint le groupe des partisans des ACR. Les tats-Unis ont aussi veill davantage conclure des accords de ce genre. On a vu apparatre un type diffrent dACR prsentant un largissement de lventail de pays viss qui va au-del de la zone rgionale traditionnelle. Ce qui est significatif, cest que des ACR ont t conclus entre des pays et des entits de diffrentes rgions ou de diffrents continents (par exemple Union europenne-Mexique, Union europenne-Afrique du Sud, tats-Unis-Isral, Jordanie, Maroc, Chili). Dans la plupart des cas, ces accords sont bilatraux, cest--dire conclus par deux pays ou entits; il peut sagir aussi daccords de libre-change ngocis et conclus entre deux ACR distincts (par exemple laccord entre lUnion europenne et le Mercosur qui est en cours de ngociation).
Tableau 1 volution des exportations intrargionales de lUE, de lALENA et de la ZLEA
et part de ces exportations dans les exportations mondiales (1990-2003, en millions de dollars et en pourcentage)
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
Monde 3 491 451 5 137 956 5 667 125 6 364 080 6 121 807 6 396 697 7 443 692
Union europenne (25) 1 022 932 1 385 805 1 587 418 1 618 929 1 623 480 1 732 227 2 063 450
ALENA 226 273 394 472 581 161 676 441 639 137 626 985 651 213
ZLEA 300 700 525 346 734 848 857 839 814 620 797 612 841 264
Part (%)
Union europenne (25) 29,3 27,0 28,0 25,4 26,5 27,1 27,7
ALENA 6,5 7,7 10,3 10,6 10,4 9,8 8,7
ZLEA 8,6 10,2 13,0 13,5 13,3 12,5 11,3
Source: Manuel de statistiques de la CNUCED 2004.
3 OMC, Les accords commerciaux rgionaux: un paysage mouvant, communication prpare pour le sminaire sur les accords commerciaux rgionaux et lOMC qui sest tenu Genve le 14 novembre 2003.
3
-
Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
Lexpansion, llargissement et le renforcement des ACR a cr une situation dans laquelle les changes internes aux ACR ont reprsent quelque 40 % des changes mondiaux (importations de marchandises) en 2000 et atteindront plus de 50 % en 20054. La forte proportion dchanges commerciaux mondiaux intra-ACR sexpliquerait par la vaste couverture des ACR actuels, y compris lUnion europenne, lALENA et, finalement, la ZLEA. En 2003, les exportations intrargionales de la seule Union europenne ont reprsent quelque 28 % des exportations mondiales de marchandises, contre 9 % pour les exportations intrargionales de lALENA (voir le tableau 1).
Tableau 2 volution de la part des exportations intrargionales dans lensemble
des exportations de lUE, de lALENA et de la ZLEA (1990-2003, en pourcentage)
1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003
Union europenne (25) 67 66 68 67 67 67 67
ALENA 41 46 55 56 56 57 56
ZLEA 47 53 60 61 61 61 60
Source: Manuel de statistiques de la CNUCED 2004.
En outre, les changes intra-ACR ont t importants, ou se sont intensifis pour leurs membres. Ceux de lUnion europenne, par exemple, reprsentent 66 68 % de lensemble de ses changes au niveau mondial, alors quau sein de lALENA, la part des changes intrargionaux est passe de 41 % en 1990 56 % en 2003 (voir le tableau 2). Les changes commerciaux entre les membres de la ZLEA telle quelle est projete reprsenteront plus de 60 % de lensemble de leurs changes. Ainsi, les courants dchanges internationaux se concentrent de plus en plus au sein de regroupements rgionaux constitus par de grandes nations commerciales.
Le volet qualit des ACR, en ce qui concerne les domaines dapplication, a galement volu. Les ACR rcents de nouvelle gnration concernent de plus en plus non seulement les biens, mais galement dautres domaines de rglementation extrieurs, dont les changes de services, linvestissement, la politique de la concurrence, les droits de proprit intellectuelle, les marchs publics, le travail, lenvironnement et la coopration pour le dveloppement, allant ainsi au-del des disciplines multilatrales et des engagements de libralisation (dits OMC-plus). Tout cela fait partie intgrante defforts dploys en faveur dune intgration plus pousse.
Les pays en dveloppement ne font pas exception au processus dexpansion et de renforcement des ACR5. Ils ont particip activement la conclusion daccords commerciaux rgionaux entre eux (Sud-Sud) et avec des pays dvelopps (Nord-Sud). En Afrique, 14 ACR sont actuellement en vigueur, dont lUnion du Maghreb arabe en Afrique du Nord et la CEMAC, le COMESA, la CAE, la COI, la CEEAC, la CEDEAO, lUEMOA, lUDAA et la CDAA en Afrique subsaharienne. Ces groupements sous-rgionaux devraient constituer un march commun lchelle du continent africain sous les auspices de lUnion africaine dici 2028. Dans la rgion
4 Statistiques fondes sur 113 ACR concernant le commerce des biens notifis lOMC et en vigueur en juillet 2000 utilisant les donnes relatives au commerce de 1999. OMC, Rapport sur le commerce mondial 2003, Genve, 2003. 5 Nations Unies, Bilatralisme et rgionalisme aprs Cancn: restaurer la primaut du multilatralisme, note de synthse fonde sur des communications rgionales prpares par la CEA, la CEE, la CEPALC, la CESAP et la CESAO, pour la Table ronde des Secrtaires excutifs des Nations Unies: Commissions rgionales de CNUCED XI, So Paulo, 15 juin 2004.
4
-
I: Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
Asie-Pacifique, 10 ACR sont actuellement en vigueur, dont lANASE, lASACR, lOCE en Asie continentale, et le MSG (Groupe du fer de lance mlansien), laccord de commerce entre les pays des les du Pacifique (PICTA)/laccord sur le renforcement conomique des pays du Pacifique (PACER) dans le Pacifique. LANASE est le prcurseur des ACR de la rgion et a permis la cration de la Zone de libre-change entre les pays de lANASE (AFTA) avec comme objectif de parvenir une libralisation complte des changes dici 2020. Les membres de lASACR (accord de libre-change de lAsie du Sud-Est) ont rcemment convenu de convertir cette entit en Zone de libre-change en Asie du Sud (SAFTA), tandis que ceux de lOCE ont mis sur pied laccord commercial de lOCE (ECOTA). LAccord de Bangkok est un accord commercial prfrentiel qui runit lInde, la Rpublique de Core et la Chine. Pour le continent amricain, il y a le Mercosur, la Communaut andine, la CARICOM et le MCCA, et des ngociations panamricaines sont en cours pour que la ZLEA soit dfinitivement mise au point dici 2005. Au Moyen-Orient, les pays du CCG envisagent dtablir une union conomique dici 2010. Des ngociations ont t lances pour crer, dici 2008, la zone panarabe de libre-change (GAFTA). Quatre pays du bassin mditerranen6 ont sign lAccord dAgadir qui constitue une premire tape en direction de la mise en place dune zone de libre-change euromditerranenne dici 2010.
Outre ces accords sous-rgionaux, divers accords commerciaux prfrentiels bilatraux ont t lancs entre des pays en dveloppement ou impliquant des pays en dveloppement, souvent sur une base interrgionale. En font partie les initiatives rcentes en matire daccords prfrentiels et de renforcement de la coopration dans le cadre du Forum de concertation Inde-Brsil-Afrique du Sud (IBSA)7, laccord de libre-change entre la Communaut europenne et le BIMST8, et des initiatives bilatrales en cours dexamen et lances par lANASE avec ses partenaires extrieurs (la Chine, le Japon, la Rpublique de Core et lInde). Dautres initiatives bilatrales runissent Singapour et le Japon, Singapour et la Nouvelle-Zlande, la Thalande et la Chine, la Thalande et lInde et lInde et Sri Lanka. Dans lhmisphre occidental, les accords concerns sont les suivants: Chili-Mexique, Costa Rica-Mexique, Mexique-Nicaragua, Bolivie-Mexique, CARICOM-Rpublique dominicaine et CARICOM-Costa Rica. Le Mercosur conserve des accords bilatraux de libre-change avec le Chili, la Bolivie et le Prou. Les tats-Unis ont acclr les ngociations et la conclusion daccords bilatraux avec six pays dAmrique centrale9, le Chili, Bahren, Singapour, le Maroc, lUDAA et la Jordanie.
II. Incidences systmiques de la nouvelle interface entre le multilatralisme et le rgionalisme
Le dbat sur les liens rciproques entre le systme commercial multilatral et les ACR est un vieux dbat bien connu10. Il concerne essentiellement les deux grandes questions suivantes: i) les effets relativement favorables en termes de prosprit de la libralisation non prfrentielle et pour tous les secteurs (clause NPF) par rapport la libralisation prfrentielle; et ii) les incidences en matire dconomie politique des ACR sur le systme commercial multilatral, ainsi que celles du systme commercial multilatral sur les ACR11. Tandis que la question pose par le premier
6 Lgypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. 7 Pour une tude de cas relative la coopration Sud-Sud, voir CNUCED, Regionalism and South-South cooperation: The case of Mercosur and India, note du secrtariat de la CNUCED, mise au point pour un forum prliminaire CNUCED XI portant le mme titre, 9 juin 2004, Rio de Janeiro (Brsil). 8 Bangladesh, Inde, Myanmar, Sri Lanka, Thalande, Bhoutan et Npal. 9 Costa Rica, Rpublique dominicaine, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala. 10 Pour une tude documentaire sur ce dbat, voir, par exemple, Arvind Panagaria, The regionalism debate: An overview, The World Economy, vol. 22, no 4, juin 1999, p. 477 512. 11 Ce dernier aspect de la question les incidences du systme commercial multilatral sur les ACR est trait plus largement dans la section III.
5
-
Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
point est de savoir quelles sont les meilleures approches, en termes de gains pour les changes et la prosprit, mettre en uvre dans les pays membres dACR, les pays tiers et le monde en gnral, celle qui est pose par le second est de savoir quelles sont les incidences systmiques des ACR sur le systme commercial multilatral dans les ngociations commerciales gnrales et multilatrales en particulier, cest--dire si lintgration rgionale est un lment favorable ou dfavorable pour la libralisation du commerce multilatral et un systme commercial multilatral plus ouvert et plus libral.
Dans les publications conomiques, il est bien tabli que lintgration rgionale gnrerait un progrs statique et dynamique12. Selon un modle simple dquilibre partiel dans le cadre dune concurrence parfaite, un ACR peut permettre daccrotre les changes entre les membres au dtriment de producteurs nationaux moins efficaces (cration dchanges) ou de pays tiers qui le sont plus (dtournements de flux commerciaux). Leffet net dun ACR sur la prosprit est donc tributaire de limportance relative de ces deux effets. Cela dpend dun ensemble divers dhypothses et de conditions, y compris des complmentarits de structure de production chez les partenaires au sein des ACR et du niveau initial des obstacles au commerce, et ne peut tre dtermin a priori. Les effets dynamiques dcoulant dune intgration rgionale sont des effets de concurrence et des effets dchelle. Ils constituent une des principales raisons dtre de la conclusion dACR rcents, y compris ceux qui sont dus des flux dinvestissements trangers directs (IED), au renforcement de la protection des droits de proprit intellectuelle, ou la prvisibilit du rgime commercial, de la cration dinstitutions et de la gouvernance. Ces effets dynamiques des ACR ont t observs le plus clairement au sein de lUE et de lALENA, qui ont augment non seulement leurs exportations intrargionales, mais galement leurs changes avec le reste du monde.
En ce qui concerne les incidences en matire dconomie politique des ACR sur le systme commercial multilatral, divers arguments ont t avancs pour et contre le rgionalisme. Du ct pour, les ACR permettent aux pays membres daller plus loin et plus vite vers des changes plus libres avec des disciplines plus fortes concernant un ventail de biens et services plus important quil naurait t possible au niveau multilatral. Les ACR pourraient galement servir de laboratoires pour exprimenter certaines approches des nouveaux problmes, et lexprience pratique quils permettent dacqurir peut constituer une base en vue de futures ngociations commerciales multilatrales destines llaboration de rgles devant tre appliques au niveau multilatral. De cette manire, les ACR pourraient tre des solutions intermdiaires ou des lments constitutifs pour un systme commercial multilatral plus ouvert et plus libral. En ce qui concerne la suprmatie de lOMC sur les ACR, les traits instituant beaucoup dACR de nouvelle gnration indiquent clairement que ces accords doivent tre conformes aux rgles de lOMC, ce qui laisse penser que cette dernire constituerait la base des futurs ACR, lesquels sefforceraient de rester compatibles avec ses disciplines. Cela laisse prvoir une interface constructive et dynamique entre la libralisation et les disciplines des changes rgionaux, dune part, et la libralisation et les disciplines multilatrales, dautre part. Bien entendu, pour que ces intentions se concrtisent, toutes les dispositions des ACR doivent tre compatibles avec lOMC.
Pour les pays en dveloppement, notamment, les ACR tendent constituer le noyau dun processus dintgration conomique rgionale plus large qui fait partie intgrante des stratgies de dveloppement national. Il en est ainsi, en particulier, parce que les pays en dveloppement disposent dun nombre limit de possibilits daction pour maintenir et augmenter leurs parts de march dans le commerce mondial des biens et services, promouvoir une croissance et un 12 Les travaux novateurs de Jacob Viner en 1950 (The Customs Union Issue, New York: Carnegie Endowment for International Peace) ont ouvert la voie lunion douanire et dautres thoriciens du commerce, comme J. E. Meade, R. G. Lipsey et H. G. Johnson, qui ont permis de lamliorer.
6
-
I: Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
dveloppement conomiques soutenus, et amliorer leur intgration conomique dans lconomie mondiale. Llargissement de lespace commercial rgional grce la libralisation des changes rgionaux nest pas peru comme tant une fin en soi, mais comme une tape vers un regroupement unique caractre conomique, social et culturel de plusieurs pays. Les pays dvelopps (exception faite de lUE), au contraire, tendent insister sur le mcanisme des accords de libre-change qui permet, au-del des biens, de couvrir les services, les investissements et dautres aspects des relations commerciales (comme la politique de la concurrence). Cela apparat clairement dans les nombreuses initiatives relatives des zones de libre-change lances surtout par des pays dvelopps, alors que dans les accords auxquels les pays en dveloppement sont parties, on a tendance inclure des accords plus larges de partenariat pour le dveloppement dans le genre de ceux qui existent entre les tats ACP et lUE. Le rgionalisme pourrait servir de mcanisme unique pour les rformes politiques et conomiques nationales dans les pays en dveloppement membres dACR. Il conviendrait dtudier plus avant les consquences dun systme unique de ce genre.
Du ct contre, les ACR peuvent produire des entits commerciales replies sur elles-mmes, discriminatrices et protectionnistes, luttant pour gagner des zones dinfluence et devenant des forteresses autonomes. En particulier, les grands ACR ceux dont lensemble des membres sattribuent une part importante des changes mondiaux sont susceptibles davoir des effets nfastes pour les pays qui nen font pas partie, conduisant un net dtournement dchanges plutt qu une nette cration de courants commerciaux. Cela dpend beaucoup des politiques et des disciplines des ACR en ce qui concerne les importations provenant de pays tiers, qui doivent venir, autant que possible, en soutien et en complment lACR, de manire renforcer sa crdibilit.
En outre, en permettant une intgration plus rapide et plus forte, les ACR de nouvelle gnration peuvent saper la motivation des pays pour soutenir une approche multilatrale de la libralisation des changes. En particulier, concernant laccs aux marchs et ltablissement des normes dans les nouveaux secteurs (DPI, investissement ou politique de la concurrence), ces ACR de type dit OMC-plus (ou OMC-moins dans la mesure o les pays en dveloppement bnficient de moins de flexibilit et dune plus faible marge de manuvre dans le cadre de ces ACR que dans celui de lOMC) peuvent jouer le rle dinstances de ngociation se substituant virtuellement lOMC, entranant par l une recherche de linstance la plus avantageuse, et faisant peser un risque systmique sur la viabilit du systme commercial multilatral. La prolifration des ACR, un nombre croissant de pays tant parties plusieurs accords la fois, pourrait avoir pour consquence la cration de blocs concurrents, et peut-tre antagonistes, qui seraient susceptibles de nuire la viabilit du systme commercial multilatral. Ce chevauchement des appartenances pourrait galement se rvler tre un fardeau administratif extrmement lourd pour les petits pays dots de capacits de ngociation et de capacits institutionnelles limites13. Le champ dapplication des ACR et lvolution des disciplines commerciales prsentent le risque dentraner une incompatibilit avec les rgles multilatrales.
La conclusion rcente dACR Nord-Nord lchelle interrgionale ou continentale peut avoir dimportantes incidences sur le systme commercial multilatral, ainsi que sur les changes des pays en dveloppement (par exemple llargissement de lUE, la Zone de libre-change tats-Unis-Australie). Ainsi, les pays peuvent tre moins motivs pour ngocier, au sein des instances multilatrales, des amliorations de leurs possibilits daccs aux marchs avec dautres pays dvelopps. tant donn que, dans beaucoup de pays dvelopps, les droits de douane de la 13 Par exemple, lapplication des rgles dorigine prfrentielles au sein dun ACR ayant un nombre donn de participants (P) ncessiterait la gestion dun nombre P*(P-1) de relations bilatrales. Ainsi, la ZLEA, avec ses 34 membres, entranerait la cration de 1 122 relations bilatrales aux fins des activits douanires.
7
-
Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
NPF sappliquent presque exclusivement dautres pays dvelopps (en raison de lexistence de diffrents taux prfrentiels applicables aux pays en dveloppement), la rduction des tarifs de la NPF nest dj devenue pertinente que pour les pays dvelopps et quelques pays en dveloppement, ainsi que certains pays conomie en transition, qui doivent sacquitter des droits de douane de la NPF14. Ainsi, les nouvelles perspectives de voir saccrotre le nombre dACR Nord-Nord peuvent continuer dissuader les pays dvelopps de choisir lOMC pour mener des ngociations tarifaires15.
Il dcoule de cela une proccupation concernant la spcialisation de forums qui rendent possible la recherche de linstance la plus avantageuse entre les ACR et le systme commercial multilatral, ce dernier tant progressivement relgu au rang dinstance de rglementation dans un nombre de plus en plus limit de politiques commerciales, surtout pour ce qui est des aides financires lagriculture et du rglement des diffrends commerciaux, alors que les ACR prvalent de plus en plus dans le cas de laccs aux marchs des biens et services, ainsi que des dispositions rglementaires et de ltablissement des normes au plan rgional dans un grand nombre de secteurs daction. Les subventions agricoles sont souvent rserves des discussions multilatrales dans le cadre de diverses ngociations Nord-Sud en dpit de la demande exprime par certains pays en dveloppement (par exemple la ZLEA, les ngociations daccords de partenariat conomique entre les tats ACP et lUE), mais on peut faire valoir quil ny a aucune raison a priori pour que laide lagriculture ne puisse faire lobjet de ngociations rgionales. Un risque important se fait jour que les ACR servent de plus en plus de vraies instances de ngociation16.
Pour ce qui est des pays en dveloppement, une intgration plus pousse dans le cadre de lOMC, et surtout dans celui dACR, peut limiter leur aptitude poursuivre des stratgies nergiques de dveloppement national concernant leurs capacits doffre. Ces instruments de politique comprennent les subventions, lincitation linvestissement et lexigence de performance, la prfrence nationale dans le cadre des marchs publics et dautres politiques industrielles permettant de relever des dfis en matires de dveloppement dont les objets sont lamlioration de la comptitivit, le dveloppement des entreprises, la diversification de la production, le dveloppement rural et la rduction de la pauvret. Les disciplines de lOMC limitent dj lutilisation de certains de ces instruments tout en procurant, il est vrai, une certaine flexibilit, ou une certaine marge de manuvre, y compris dans la forme du traitement spcial et diffrenci. cet gard, des engagements plus contraignants avec un ventail plus large de
14 titre dexemple, les droits de douane de la NPF ne sappliquent qu neuf pays dans le cadre de la liste tarifaire de lUE. 15 Il apparat que la rduction tarifaire des NPF dans le cadre de lOMC ne reste valide que dans la mesure o les pays de la Quadrilatrale ne concluent pas des ACR prfrentiels entre eux. Ainsi, on peut soutenir que les ACR interrgionaux Nord-Nord entre les principaux pays dvelopps peuvent tre un facteur de risques systmiques importants pour la viabilit du systme commercial multilatral. 16 La raison pour laquelle laide lagriculture ne peut pas tre ngocie dans le cadre rgional semble tre due au fait que les subventions agricoles, internes ou subordonnes lexportation, affectent les changes de tous les pays, et ne sont donc pas limites aux partenaires des ACR. Toutefois, tant donn que certaines dispositions rglementaires et certaines normes, comme le rgime de protection des DPI, font dj lobjet de ngociations dans le cadre des ACR et sont appliques multilatralement tous les pays en ce qui concerne non seulement les droits de proprit intellectuelle des citoyens des partenaires des ACR mais aussi aux citoyens de pays tiers dtenteurs de ces droits, il semble quil ny ait aucune raison a priori pour que laide lagriculture ne relve pas des ACR. Certains pays paraissent prfrer que les ngociations relatives aux subventions agricoles soient menes dans un cadre multilatral pour des raisons relevant plutt de lconomie politique, comme dans le cas des ngociations tarifaires, au cours desquelles les producteurs nationaux doivent tre persuads, titre de rciprocit, de sengager pratiquer des rductions, par dautres partenaires commerciaux (trs importants et qui accordent des subventions), lesquels ne sont souvent pas leurs partenaires au sein dACR.
8
-
I: Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
secteurs daction dans le cadre dACR peuvent prvaloir sur cette flexibilit confre par le systme commercial multilatral.
De plus, dans le contexte des ngociations commerciales multilatrales Nord-Sud, les ACR peuvent servir de moyen de pression dans les ngociations. Des ACR bilatraux ngocis et conclus alors que des ngociations commerciales multilatrales sont en cours peuvent peser sur la solidarit entre des pays en dveloppement et porter atteinte leur capacit dagir collectivement au niveau multilatral, affaiblissant ainsi leur position dans lesdites ngociations. ce sujet, il a t suggr que, pendant la dure de ngociations commerciales multilatrales, un moratoire soit impos sur le lancement et la poursuite des ngociations commerciales bilatrales et rgionales, puisquelles sont susceptibles de porter prjudice la conduite de ngociations multilatrales.
Afin dtre ouverts et tourns vers lextrieur, et par consquent de servir les intrts du systme commercial multilatral, les ACR doivent faire en sorte que les obstacles opposs aux pays qui ne sont pas parties ces accords soient rduits en mme temps que se renforce la libralisation au sein des accords commerciaux rgionaux. Il a t suggr, par exemple, quafin de rduire au minimum le risque de dtournement des changes, les ACR prvoient une rduction programme des droits de douane de la nation la plus favorise selon un calendrier prcis. Par ailleurs, les grands ACR devraient assumer une responsabilit particulire en raison de leurs rpercussions sur des partenaires commerciaux plus faibles, notamment les pays qui ne sont pas parties aux accords. Il faut que ces ACR vitent autant que possible les consquences nfastes sur les conditions daccs aux marchs pour les pays en dveloppement, par exemple au cours de ladmission de nouveaux membres, et quils aident les pays en dveloppement comprendre leurs programmes commerciaux et sadapter aux nouvelles conditions des changes sur le march rgional.
III. Le dynamisme dans linterface entre le rgionalisme et le multilatralisme: perspective daprs Cancn
Dans le cadre des ngociations parallles aux niveaux multilatral, interrgional, rgional et sous-rgional, les liens rciproques entre le systme commercial multilatral et les ACR sont pertinents, surtout dans le contexte des ngociations commerciales multilatrales du Programme de travail daprs Cancn. Les dconvenues de la cinquime Confrence ministrielle de lOMC ont suscit des proccupations au sujet de la primaut pouvant tre accorde par les pays la voie rgionale de la libralisation sur la voie multinationale, ce qui affaiblit la dynamique en faveur des ngociations commerciales multilatrales et, en fin de compte, le systme commercial multilatral lui-mme.
Concrtement, linterface entre le systme commercial multilatral et les ACR fonctionne trois niveaux17. Au premier niveau, on trouve les rgles de lOMC rgissant le fonctionnement des ACR. Elles dfinissent des conditions spcifiques dans lesquelles les ACR peuvent tre conclus et peuvent fonctionner au sein du systme commercial multilatral. Les rgles de lOMC rgissant les ACR comprennent larticle XXIV du GATT sur les changes de biens, larticle V du GATT sur les changes de services, et la Clause dhabilitation sur les accords (prfrentiels) Sud-Sud. Au deuxime niveau, les engagements en matire daccs aux marchs des biens ou des services, pris sur la base du systme commercial multilatral la suite des sessions successives de ngociations commerciales multilatrales, dfinissent le degr de prfrence accord aux membres des ACR, et, partir de l, les limites de la libralisation prfrentielle entre ces membres. Au troisime niveau, les disciplines multilatrales constituent un plancher, soit un plus petit 17 Luis Abugattas Majluf, Swimming in the Spaghetti Bowl: Challenges for Developing Countries under the New Regionalism, Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No 27, CNUCED (2004).
9
-
Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
dnominateur commun, pour les disciplines de politique commerciale (ou lie au commerce) qui relvent de lOMC, y compris les obstacles non tarifaires et les questions de rglementation interne. Ces disciplines engagent tous les membres de lOMC et prsident la conduite dune politique commerciale qui doit tre respecte galement par les parties aux ACR. Cependant, les ACR peuvent conduire des engagements un niveau plus lev que celui qui est dfini par les rglements de lOMC18 .
i) Rgles de lOMC relatives aux ACR
Les ACR sont rgis par larticle XXIV du GATT 1994, larticle V de lAGCS et la Clause dhabilitation. Toutes les dispositions permettent aux membres de lOMC de scarter du principe fondamental de la NPF dans certaines conditions, et dtablir les exigences devant tre respectes par les parties aux ACR pour tre compatibles avec lOMC. Les prescriptions de larticle XXIV du GATT, qui sappliquent aux zones de libre-change, aux unions douanires et larrangement provisoire dbouchant sur ltablissement dune zone de libre-change ou dune union douanire, disposent essentiellement que les droits de douane et autres rglements commerciaux doivent tre supprims pour lessentiel des changes commerciaux entre les membres des ACR, et que les obstacles opposs aux pays tiers sous forme de droits de douane et autres ne devraient pas tre dans lensemble plus levs ni plus restrictifs. Ces prescriptions ne sont pas applicables dans le cadre de la Clause dhabilitation (voir le tableau 3). Cette dernire prvoit que la clause de larticle I.1 du GATT relative la nation la plus favorise ne sapplique pas un nombre limit daccords prfrentiels, dont les arrangements rgionaux ou mondiaux conclus entre parties contractantes peu dveloppes en vue de la rduction ou de llimination de droits de douane sur une base mutuelle (par. 2 c)). Ainsi, on peut faire valoir que la Clause dhabilitation nonce des prescriptions moins draconiennes que celles de larticle XXIV du GATT. De fait, un certain nombre dACR Sud-Sud ont t notifis dans le cadre de la Clause dhabilitation19.
Lexamen des ACR notifis destin vrifier sils sont compatibles avec les rgles de lOMC est effectu par le Comit des accords commerciaux rgionaux (CACR)20. Le CACR na pas encore t en mesure dadopter les rapports finaux conscutifs son examen, cela tant d en grande partie la lenteur avec laquelle les membres de lOMC rsolvent les problmes systmiques concernant les rgles de lOMC relatives aux ACR. Ces problmes tiennent linterprtation de certains termes et rfrences des dispositions21. Par exemple, il nexiste aucun accord entre les membres de lOMC concernant le sens et la porte exacts dexpressions clefs 18 Certains ont une conception diffrente; par exemple, la Communaut europenne considre, dans les minutes du CACR, que les mesures internes restrictives entre les parties aux ACR sont des modifications lgales (Convention de Vienne sur le droit des traits, art. 41) et sont autorises dans la mesure o les droits de tierces parties ne sont pas enfreints. La thse dfendue est que les parties sont libres de modifier les rgles de lOMC par des mesures restrictives internes un ACR. 19 Les ACR Sud-Sud notifis en vertu de la Clause dhabilitation sont lALE Inde-Sri Lanka, la CAE, la CEMAC, le SAFTA, la Communaut andine, le COMESA, lOCE, le Mercosur, laccord commercial entre les pays du Groupe du fer de lance mlansien, laccord entre la Rpublique dmocratique populaire lao et la Thalande, le CCG, lAssociation latino-amricaine dintgration (ALADI), lAccord de Bangkok, le Protocole concernant les ngociations commerciales entre pays en dveloppement, le SGPC, lAccord tripartite, et lUEMOA. http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/provision_e.xls. La CARICOM a t notifie en vertu de larticle XXIV du GATT le 14 octobre 1974, trs probablement parce que la Clause dhabilitation nexistait pas cette poque. On a dit que le Protocole commercial de la SADC serait notifi conformment larticle XXIV du GATT en dpit du fait que seuls les pays en dveloppement peuvent en tre membres. 20 Le Mercosur a t notifi en vertu de la Clause dhabilitation mais il est en cours dexamen par le CACR dans le cadre, la fois, de la Clause dhabilitation et de larticle XXIV du GATT, ce qui est une situation unique dans laquelle aucun regroupement de pays en dveloppement notifi ne sest trouv depuis 1979. 21 Certaines dcisions des organes juridictionnels de lOMC ont quelque peu clarifi quelques aspects des problmes systmiques. Voir, par exemple, les rapports du Groupe spcial et de lOrgane dappel sur Turquie Restrictions limportation de produits textiles et de vtements (WT/DS34/R, DS34/AB/R).
10
-
I: Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
comme lessentiel des changes, pas plus lev ni plus restrictif dans lensemble et dautres rgles de commerce, ainsi que, en ce qui concerne le traitement des rgles dorigine prfrentielles, dautres rgles restrictives de commerce et les obligations pendant les priodes de transition. La question des rapports entre les ACR notifis conformment la Clause dhabilitation et larticle XXIV du GATT a galement t souleve. Parmi les problmes systmiques relatifs lAGCS, figure linterprtation de couvrant un nombre substantiel de secteurs et labsence ou llimination, pour lessentiel, de toute discrimination22.
Tableau 3 Comparaison des prescriptions de larticle XXIV du GATT et de la Clause dhabilitation23
ARTICLE XXIV DU GATT 1994 CLAUSE DHABILITATION
Objectif Faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non opposer des obstacles au commerce dautres parties contractantes (XXIV: 4).
Faciliter et promouvoir les changes des pays en dveloppement et non lever des obstacles ou crer des difficults au commerce de toutes autres parties contractantes (par. 3).
changes commerciaux viss
Les droits de douane et les autres rglementations commerciales restrictives doivent tre limins pour lessentiel des changes commerciaux entre les parties (XXIV: 8 a) i) et b)).
Non applicable.
Niveau des obstacles opposs aux pays tiers
Les droits de douane ne seront dans lensemble pas plus levs et les autres rglementations commerciales plus rigoureuses que ne ltaient les droits et les rglementations commerciales en vigueur avant la conclusion de laccord (XXIV: 5 a) b)).
Non applicable. (Ne pas constituer un obstacle la rduction ou la suppression des droits de douane sur la base de la NPF.)
Accords provisoires/ priode de transition
Tout accord provisoire doit comprendre un plan et un programme pour ltablissement de lunion douanire ou de la zone de libre-change, dans un dlai qui ne devrait pas dpasser 10 ans, sauf dans des cas exceptionnels (dlai raisonnable) (XXIV: 5 c) et Mmorandum daccord de 1994, par. 3).
Non applicable.
Notification Notification au Conseil du commerce des marchandises (XXIV: 7 a)). Toute modification dun accord provisoire doit tre notifie au Conseil du commerce des marchandises. Les consultations peuvent tre entreprises sur demande (XXIV: 7 c)).
Notification au Comit du commerce et du dveloppement (CCD) lorsquelle est tablie, modifie ou retire.
Examen Examen effectu par le Comit des accords commerciaux rgionaux, qui adresse un rapport au Conseil du commerce des marchandises. Ce dernier peut formuler des recommandations (XXIV: 7 a) et Mmorandum daccord de 1994, par. 7). Le Conseil du commerce des marchandises peut, sil le juge ncessaire, formuler des recommandations relatives aux accords provisoires, notamment au sujet du dlai propos et des mesures prescrites (XXIV: 7 b) c) et Mmorandum daccord de 1994, par. 8 10).
Le CCD peut crer un groupe de travail (ou renvoyer au CACR) pour examiner un ACR qui lui a t notifi.
Rapports priodiques
Des rapports biennaux sont requis sur le fonctionnement des accords commerciaux rgionaux (Mmorandum daccord de
Non applicable.
22 OMC, Inventaire des questions relatives aux accords commerciaux rgionaux, note dinformation du secrtariat (TN/RL/W/8/Rev.1), 1er aot 2002. 23 Adaptation de larticle de Bonapas Onguglo et Taisuke Ito, How to make EPAs WTO-compatible?: Reforming the rules on regional trade agreements, ECDPM Discussion Paper No 40, juillet 2003.
11
-
Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
1994, par. 11).
Lamlioration et la clarification des disciplines de lOMC influant sur les ACR revtent une grande importance en ce quelles permettent de faire en sorte que les ACR soient utiles au systme commercial multilatral en rduisant au minimum les consquences des ACR sur les pays tiers et le systme commercial multilatral. cet gard, des ngociations multilatrales ont t lances comme prvu dans la Dclaration ministrielle de Doha sur les rgles de lOMC (par. 29) qui sappliquent aux accords commerciaux rgionaux et visent clarifier et amliorer les disciplines et les procdures, tout en tenant compte de leurs aspects relatifs au dveloppement. Des ngociations sont actuellement en cours au sein du Groupe de ngociation sur les rgles. Les demandes initiales prsentes par certains membres proposent un examen global des dispositions pertinentes, permettant de clarifier les principales prescriptions de base, compte tenu des aspects des accords commerciaux rgionaux lis au dveloppement et de lamlioration de la fonction de contrle de lOMC pour ce qui est des rgles de procdure (procdures de notification, de dclaration et dexamen).
Encadr 1. Propositions pour clarifier et amliorer larticle XXIV du GATT
Les ngociations de Doha sur les rgles qui sappliquent aux ACR, conduites au sein du Groupe de ngociation sur les rgles, nont toujours pas abord pleinement les questions systmiques de fond. Deux propositions se dtachent cet gard en ce quelles concernent directement et concrtement les disciplines fondamentales de larticle XXIV du GATT.
Une proposition prsente par le Groupe ACP vise ce que le traitement spcial et diffrenci (TSD) fasse officiellement partie des conditions nonces aux paragraphes 5 8 de larticle XXIV du GATT lorsquelles sont appliques aux ACR conclus entre des pays dvelopps et des pays en dveloppement (par exemple les ACR Nord-Sud). En reconnaissant que la prescription de rciprocit figurant dans larticle XXIV du GATT prvaut sur le principe de la rciprocit partielle dans les ngociations tarifaires (une forme de TSD), la proposition du Groupe ACP prconise que lapplication dun TSD accompagne la mise en uvre des prescriptions de larticle XXIV du GATT, comme celles concernant lessentiel des changes commerciaux, quand il sagit des ACR Nord-Sud. Cest la toute premire proposition qui prconise ce TSD dans le cadre de larticle XXIV du GATT aux fins des accords Nord-Sud. Comment dfinir en termes de fonctionnement cette flexibilit accorde seulement aux pays en dveloppement en tant que forme de TSD, tel serait probablement le sujet clef de nouvelles discussions concernant la fois les incidences systmiques et la transparence24.
LAustralie, dautre part, propose de considrer que les prescriptions relatives lessentiel des changes commerciaux exigent que soient supprimes au moins 95 % des lignes tarifaires au niveau des positions six chiffres dans la classification du SH (systme harmonis). En mme temps, pour viter que soient exclus dun ACR des produits faisant lobjet dun volume important de transactions commerciales, elle propose galement dinterdire que soient exclus les produits qui reprsentent au moins 2 % des changes entre les parties. En ce qui concerne les engagements chelonns pendant la priode de transition, elle propose de prescrire llimination immdiate de
24 La Commission pour lAfrique (Commission Blair), une initiative du Premier Ministre du Royaume-Uni, a indiqu quune rvision de larticle XXIV du GATT permettant de rduire les prescriptions relatives la rciprocit et de saxer davantage sur les priorits lies au dveloppement pourrait tre utile. Commission for Africa, Our common interest: The report of the Commission for Africa, mars 2005, p. 71. Voir galement DTI/DFID, Economic Partnership Agreements: Making EPAs deliver for development, mars 2005.
12
-
I: Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
70 % des lignes tarifaires au niveau des positions six chiffres au moment de lentre en vigueur de lACR. Cette proposition rendrait probablement les disciplines de larticle XXIV du GATT plus rigoureuses quelles ne le sont actuellement.
Il faut que les pays en dveloppement soient trs attentifs faire en sorte, avant tout, que toutes les disciplines nouvelles ou modifies issues des travaux du Groupe de ngociation sur les rgles prvoient la flexibilit ncessaire aux accords Sud-Sud et lincorporation de dispositions utiles concernant le TSD dans les ACR Nord-Sud. cet gard, les tats ACP ont rcemment prsent une proposition globale (voir lencadr 1 ci-dessus)25. ce jour, les travaux ont t consacrs davantage la transparence, avec des discussions centres sur le point de savoir quand, comment et dans quelle mesure les membres devraient notifier lOMC les dispositions dun ACR, et quelle est la meilleure manire pour lOMC de les examiner. Certains pays en dveloppement sont hostiles ce que des dispositions renforces en matire de prsentation et dexamen sappliquent aux ACR notifis conformment la Clause dhabilitation, tandis que certains pays europens ont propos des ACR antrieurs avec des droits acquis les exemptant de lapplication de toute nouvelle discipline pouvant natre de ces ngociations. LAustralie a prsent une proposition dtaille visant tablir des critres quantitatifs pour la dfinition de certaines questions systmiques essentielles, dont la prescription relative lessentiel des changes26 (voir lencadr 1 ci-dessus). Les travaux sur les questions de fond, la clarification et lamlioration des rgles de lOMC concernant les ACR nont pas encore t compltement abords par le Groupe de ngociation sur les rgles.
ii) Les ACR et les ngociations sur lagriculture et laccs aux marchs des produits non agricoles
Lagriculture, laccs aux marchs des produits non agricoles et les services sont au cur du programme de ngociations sur laccs aux marchs dans le cadre du Programme de travail de Doha. Pour ce qui est du commerce des biens, comme lobjectif principal des ACR est de parvenir la suppression mutuelle des obstacles tarifaires et non tarifaires entre les parties aux ACR, ces accords relvent directement des ngociations en cours sur lagriculture et laccs aux marchs des produits non agricoles dans le cadre du Programme de travail de Doha. Les pays en dveloppement qui ont conclu des ACR doivent tenir compte des incidences de la libralisation dans les NPF et du niveau appropri de prfrence pour les autres parties leurs ACR, alors que le systme commercial multilatral, qui prvaut, exige que ce traitement prfrentiel ne nuise pas aux efforts dploys dans le cadre du multilatralisme pour obtenir des rductions de droits de douane gnrales de la part des NPF. En tant quexportateurs, ils doivent dterminer quelles sont les instances, multilatrales ou rgionales, qui conviennent le mieux pour amliorer laccs un march donn ou pour en constituer un des fins de cohrence, et pour obtenir les meilleurs accords commerciaux et les meilleures possibilits pour leurs exportations. Lrosion des marges de prfrence est le principal problme pour les pays les moins avancs et les pays faible revenu qui ont bnfici de marges de prfrence importantes accordes par des pays dvelopps importants, soit dans le cadre dACR, soit dans celui de prfrences unilatrales. Il faut peut-tre mettre au point, dans le cadre de lOMC ou dune autre manire, un mcanisme de compensation ou dajustement et des solutions allant dans le sens du commerce afin de remdier aux consquences graves et prjudiciables pour les perspectives de dveloppement de ces pays.
Cest lOMC que certaines mesures ayant des effets de distorsion sur le commerce, comme les subventions agricoles, peuvent tre examines (voir, par exemple, le dbat sur les aides 25 Document de lOMC TN/RL/W/155 du 28 avril 2004. 26 TN/RL/W/173/Rev.1, 3 mars 2005.
13
-
Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
lagriculture dans la ZLEA), mais certains obstacles laccs aux marchs dans des secteurs sensibles comme lagriculture pourraient ltre plus profitablement dans le champ limit du cadre rgional. ce sujet, il convient de noter que la protection qui prvaut sur la base des intrts de la NPF tend persister lintrieur des ACR (en ce qui concerne, par exemple, lagriculture et les textiles)27. Alors que les ACR peuvent mieux convenir un nombre limit de secteurs spcifiques trs protgs, la position dfavorable des pays en dveloppement dans les ngociations des accords Nord-Sud peut ne pas leur permettre de russir faire lever ces obstacles face des partenaires dvelopps puissants.
iii) Les ACR et les ngociations sur les services
la suite des ngociations du Cycle dUruguay sur les services, lAGCS est devenu un cadre multilatral de principes et de rgles pour le commerce des services en vue de lexpansion de ce dernier dans des conditions de transparence et de libralisation progressive et un moyen de promouvoir la croissance conomique de tous les partenaires commerciaux ainsi que le dveloppement des pays en dveloppement. LAGCS prvoit une approche de la libralisation des services dite de la liste positive, laquelle renvoie un mcanisme de libralisation sparant les obligations gnrales valables pour tous les pays (comme le traitement de la NPF) des engagements spcifiques ngocis pour laccs aux marchs et du traitement national concernant le secteur spcifique des services, lesquels peuvent faire lobjet de limitations et de conditions particulires28. Les engagements contracts au cours des ngociations du Cycle dUruguay ont largement reflt un statu quo, exception faite des secteurs des services financiers et des tlcommunications o lon a assist leur renforcement. Ainsi, les ngociations de Doha sur les services devraient entraner une libralisation progressive et plus importante. La libralisation sest accrue dans le cadre rgional, un certain nombre dACR impliquant des pays en dveloppement ont amorc une libralisation prfrentielle des services base sur des engagements contracts dans le cadre dAGCS-plus, certains dentre eux selon une approche fonde sur la liste ngative pour accorder un traitement prfrentiel leurs partenaires au sein de lACR. La libralisation des services dans un cadre rgional peut utilement amliorer le rapport cot-efficacit des conomies nationales, car les services comptent pour une part importante dans le PIB de la plupart des pays en dveloppement et contribuent de faon essentielle la production de biens et services. Conformment larticle V de lAGCS, les pays en dveloppement qui concluent des accords rgionaux dintgration (ARI) bnficient dune certaine flexibilit, laquelle est encore plus grande pour les ARI conclus seulement entre pays en dveloppement.
Il a t montr, en thorie, que la libralisation des services tend confrer des avantages statiques aux pays qui la pratiquent, par comparaison avec le statu quo, que ce soit sur une base prfrentielle ou non prfrentielle29. La raison en est que les obstacles au commerce dans le secteur des services tendent tre plus svres tout en nayant aucune rpercussion sur les recettes pour le gouvernement. Les avantages seront vraisemblablement plus consquents avec une libralisation des services au plan multilatral quau plan rgional. La programmation de la libralisation revt une plus grande importance dans le secteur des services que dans celui des biens en raison des cots fixes qui sont plus levs et des avantages lis certains services forte 27 OMC, Champ dapplication, processus de libralisation et dispositions transitoires des Accords commerciaux rgionaux, historique effectu par le secrtariat (WT/REG/W/46), 5 avril 2002. 28 Lapproche dite de la liste positive permettrait chaque pays de choisir selon sa stratgie la branche des services ou la transaction quil est dispos libraliser. Voir Mina Mashayekhi, GATS 2000 negotiations: Options for developing countries, Trade-related Agenda, Development and Equity (T.R.A.D.E) Working Papers 9, South Centre, dcembre 2000. 29 Aaditya Mattoo et Carsten Fink, Les accords rgionaux et le commerce des services: questions de politique gnrale, communication prsente au sminaire de lOMC sur lvolution du systme commercial mondial: Le rgionalisme et lOMC, 26 avril 2002, Genve (Suisse).
14
-
I: Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
intensit de capital. Selon les estimations, les avantages les plus importants dont les pays en dveloppement pourraient bnficier dans le cadre du Programme de travail de Doha proviendraient de la libralisation du mode 4. Winters et al. ont montr quun mouvement de personnes physiques quivalent 3 % de la main-duvre qualifie et non qualifie dans les pays dvelopps entranerait un accroissement de la prosprit mondiale estim plus de 150 milliards de dollars des tats-Unis, assez galement partag entre les pays dvelopps et les pays en dveloppement30. Concernant laccs au titre du mode 4, les progrs peuvent tre plus rapides dans un cadre rgional, y compris grce la reconnaissance des qualifications et aux visas pour les prestataires de services. Cela met en lumire le fait que les enjeux sont particulirement importants pour les pays en dveloppement dans les ngociations multilatrales et rgionales sur la libralisation des services. Il convient de noter que les articles IV et XIX.2 de lAGCS autorisent une certaine flexibilit aux pays en dveloppement en fonction de leurs engagements de libralisation et dun engagement pris par les pays dvelopps daccorder une attention prioritaire aux secteurs et modes de fourniture intressant les pays en dveloppement.
iv) Les ACR et les dispositions rglementaires et les normes
Dans le domaine de la rglementation du commerce, les ACR occupent de plus en plus le devant de la scne car ils commencent mettre en uvre de nouvelles mesures rglementaires caractre commercial prises lintrieur des frontires. Les rgles multilatrales, dans ces secteurs, sont actuellement insuffisantes. Les domaines dans lesquels nexiste aucune rgle multilatrale concernent particulirement les pays en dveloppement. Certains ACR ont donn la priorit, aux termes daccords de type dit OMC-plus, aux rgles multilatrales, comme dans le cas des investissements dans le cadre de lALENA, ou de la politique de la concurrence et dautres politiques conomiques dans lUnion europenne. Certains ont vu l une preuve lappui de la thse de la construction du nouvel difice concernant les liens mutuels entre le systme commercial multilatral et les ACR, car ces derniers servent de plate-forme pour un nouveau mode de rglementation. Dautres considrent que cette volution pourrait faire courir le risque dune fragmentation accrue des rgles commerciales au niveau rgional, rendant difficile un accord multilatral sur les nouvelles questions.
Mme l o existent des rgles multilatrales, les ngociations daccords de type OMC-plus peuvent se transformer en ngociations pour la dfinition de normes, entranant par l le risque dune harmonisation par le haut des normes rglementaires. Un bon exemple en est la protection de la proprit intellectuelle31. Alors quun minimum de normes statutaires sont nonces dans les rgles multilatrales, savoir lAccord sur les aspects des droits de proprit intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), en labsence de dispositions quivalentes larticle XXIV du GATT ou larticle V de lAGCS (ou parce quil ne comporte pas dlments relatifs laccs aux marchs et que le traitement prfrentiel peut ne pas tre, en soi, conomiquement souhaitable ou praticable), les normes relatives aux droits de proprit intellectuelle (DPI) font automatiquement lobjet dune application multilatrale. On peut remarquer que, en vertu de lAccord sur les ADPIC, la seule exception permise au principe de la
30 Alan Winters et al., Liberalizing temporary movement of natural persons: An agenda for the Development Round, World Economy, vol. 26, p. 1137 1161, aot 2003. 31 Pour une prsentation du rle des ACR dans ltablissement des normes de type OMC-plus relatives au rgime de protection de la proprit intellectuelle, voir, par exemple, David Vivas-Eugui, Regional and bilateral agreements and a TRIPS-plus world: The Free Trade Area of the Americas (FTAA), TRIPS Issues Paper 1, QUNO/QIAP/ICTSD, Genve, 2003; MSF, Access to medicines at risk across the globe: What to watch out for in Free Trade Agreements with the United States, MSF Briefing Note, mai 2004.
15
-
Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
NPF est celle des droits acquis pour la protection prfrentielle des droits de proprit intellectuelle dans le cadre de traits plurilatraux antrieurs la cration de lOMC32.
Les incidences du caractre normatif des ACR sont particulirement importantes dans le cadre des rapports Nord-Sud, car les pays en dveloppement se trouveraient amens adopter des normes plus leves, comme une protection par brevet concernant ltendue de la couverture, le niveau de protection ou le degr de rigueur de la rglementation, avec la rduction qui en dcoulerait de la porte de la flexibilit en matire de politique dont ils disposent dans le cadre des rgles multilatrales, y compris aux fins de la garantie pour tous de laccs aux mdicaments essentiels. De nouveaux points sont souvent ngocis et inclus dans les accords Nord-Sud, dont linvestissement, la politique de la concurrence, les marchs publics, lenvironnement et les normes du travail. En ce sens, les ACR peuvent servir contourner le systme commercial multilatral, le vider de sa substance ou prvaloir sur lui pour des pays en dveloppement libres de le faire en vertu des rgles de lOMC, et crer, dans des secteurs non couverts par lOMC, des obligations nouvelles qui seraient plus contraignantes que si elles avaient d faire lobjet dun accord multilatral.
IV. Remdier aux asymtries structurelles: le volet dveloppement des accords Nord-Sud
Il est une nouveaut trs importante dans la conclusion des ACR, savoir quon en voit apparatre qui regroupent des pays dvelopps et des pays en dveloppement. Traditionnellement rgis par divers mcanismes prfrentiels unilatraux, un certain nombre daccords en cours de ngociation visent transformer les relations commerciales et conomiques que des pays en dveloppement avaient avec les pays dvelopps qui leur accordaient prcdemment une prfrence en relations de libre-change mutuel, comme dans le cas des ngociations panamricaines dans le cadre de la ZLEA, ou en accords de partenariat plus large comme dans le cas des ngociations ACP-UE pour laccord de partenariat conomique conformment lAccord de Cotonou. En vertu de lAfrican Growth and Opportunity Act des tats-Unis, la possibilit existe de conclure des ACR avec des pays africains subsahariens bnficiaires. LAccord sur le resserrement des liens conomiques du Forum des les du Pacifique (PACER) envisage que soient engages des ngociations relatives une zone de libre-change entre les pays insulaires du Pacifique dune part et lAustralie et la Nouvelle-Zlande dautre part, une fois que les premiers auront engag des ngociations relatives une zone de libre-change avec dautres pays dvelopps, comme ceux de lUE. Ainsi quil a t not, diverses initiatives bilatrales ont t lances dans le cadre des relations Nord-Sud, et tout dernirement par les tats-Unis33. On peut citer un autre exemple, savoir les accords euromditerranens visant tablir le libre-change entre lUE et les pays du bassin mditerranen.
Lasymtrie structurelle entre les deux partenaires en matire de taille, de situation et de capacit rend ncessaire quune asymtrie correspondante en matire dobligations et dengagements soit prvue dans laccord de manire ce que ces deux partenaires ingaux soient traits de manire quitable. Des mcanismes comportant le renforcement de la capacit doffre et des capacits infrastructurelles, institutionnelles et humaines des pays en dveloppement
32 Larticle 4 d) de lAccord sur les ADPIC prvoit que la NPF est exonre de ses obligations pour tout avantage, faveur, privilge ou immunit qui dcoule daccords internationaux se rapportant la protection de la proprit intellectuelle dont lentre en vigueur prcde celle de lAccord sur lOMC. 33 Ces initiatives bilatrales des tats-Unis sont les suivantes: des accords commerciaux rgionaux conclus avec lAustralie (mai 2004), le Maroc (mars 2004), les pays dAmrique centrale (accord de libre-change entre lAmrique centrale et les tats-Unis) (dcembre 2003), le Chili (juin 2003) et Singapour (mai 2003). Des ngociations ont t engages avec Bahren (aot 2003), lUnion douanire dAfrique australe (UDAA) (juin 2003), la Bolivie, la Colombie, lquateur, le Prou (mai 2004) et le Panama (avril 2004).
16
-
I: Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
partenaires serait une condition pralable des arrangements et des rsultats mutuellement profitables. En pratique, cela signifie quil convient dassurer laccs aux marchs pour les pays en dveloppement et lentre pour leurs exportations, tout en dfinissant plus soigneusement et plus clairement le champ dapplication des accords et en garantissant un traitement spcial et diffrenci (TSD) dans le cadre de cet accord pour leur permettre de faire face aux cots dajustement et aux cots sociaux, y compris un transfert de ressources par le biais de laide au dveloppement. Il existe aussi une question pralable en matire dasymtrie dont il conviendrait de tenir compte, savoir que cest souvent le pays le plus important qui a la possibilit de choisir son partenaire. Les accords dintgration rgionale Nord-Nord, comme celui qui a prsid llargissement de lUnion europenne, auraient galement des rpercussions sur les pays en dveloppement.
Pour ce qui est des exportations, comme les pays en dveloppement ont bnfici, sur des bases prfrentielles, de conditions assez librales daccs aux marchs des pays dvelopps, il nest pas facile de dterminer les domaines dans lesquels ces pays pourraient tirer des avantages de futurs accords, et cela dautant moins que les marges de prfrence diminuent au fur et mesure que se rduisent les droits de douane de la NPF et dautres droits. Il est, lvidence, un domaine dans lequel les pays en dveloppement pourraient esprer des avantages, savoir les problmes rsiduels lis aux obstacles laccs aux marchs dans des secteurs qui les intressent pour leurs exportations, notamment et avant tout dans lagriculture et les produits manufacturs forte intensit de main-duvre. Il sagit toujours l de domaines importants, car certains pays en dveloppement faible revenu, petits et vulnrables ont grand besoin dun accs prfrentiel aux marchs des pays dvelopps pour pouvoir exporter un nombre limit de marchandises. Il convient de noter, toutefois, que ce sont des secteurs o il est trs dlicat de procder la libralisation dans les pays dvelopps. Il faut galement tenir compte de lincidence gnrale actuelle des marges prfrentielles dans le cadre des ngociations commerciales multilatrales parallles afin de maintenir le niveau existant des prfrences en faveur des pays en dveloppement.
Parmi les autres domaines dans lesquels il est possible denvisager des avances, il y a les obstacles lentre sur les marchs pour les produits, notamment les rgles techniques, sanitaires et environnementales, ainsi que les rgles dorigine. Les ACR pourraient tre conus pour permettre dliminer les obstacles laccs aux marchs opposs par les pays en dveloppement plus efficacement que dans le cadre multilatral, par exemple grce une simplification des rgles dorigine. La reconnaissance mutuelle des normes et des rsultats dessais aiderait amliorer les exportations des parties en dveloppement aux ACR, tout comme des mesures de facilitation du commerce. Plus particulirement, il faut concevoir les rgles dorigine de manire promouvoir le dveloppement des exportations et de la base de production des pays en dveloppement tout en leur permettant de conserver laugmentation de la valeur ajoute. La libralisation du commerce des services est un autre domaine o des amliorations sont possibles, en particulier en ce qui concerne un mouvement temporaire des personnes physiques au titre du mode 4 de lAGCS et la reconnaissance de la qualification des professionnels des services. Les progrs ont t lents dans ces domaines. En outre, des composantes plus fortes de la politique non commerciale et de la politique dappui au dveloppement dans lensemble mondial des accords Nord-Sud, comme le transfert de ressources sous forme daide technique et financire au dveloppement, ainsi que le transfert de technologie, peuvent revtir une importance non ngligeable pour les pays en dveloppement.
Il serait particulirement apprciable de remdier ces obstacles non tarifaires, car cela gnrerait des avantages dynamiques attendus de la libralisation. En effet, les accords Nord-Sud sont souvent valoriss en raison des effets escompts sur les flux dinvestissements trangers directs, des avantages inhrents une extension de la protection des droits de proprit
17
-
Multilatralisme et rgionalisme: La nouvelle interface
intellectuelle, et de leur impact sur la prvisibilit des rgles du jeu, la cration dinstitutions et la gouvernance.
En ce qui concerne les importations, les cots de la libralisation dans le cadre des accords Nord-Sud seront vraisemblablement levs pour les pays en dveloppement. La rciprocit prvue par les ACR sapplique louverture des marchs et dautres engagements entre les parties ces accords, et cela vaut aussi pour les accords Nord-Sud. Dans certains ACR projets, ce sont les proccupations concernant la compatibilit avec lOMC de prfrences unilatrales antrieures (par exemple la Convention de Lom de lUE) qui ont pouss les pays concerns abandonner les accords commerciaux unilatraux au profit daccords commerciaux rciproques34. cet gard, tant donn le niveau de la protection douanire dans les pays en dveloppement et son incidence sur lensemble des recettes publiques, les cots seront vraisemblablement lourds pour ces pays, avec des rpercussions sur le financement du dveloppement dans les domaines du dveloppement national et de la lutte contre la pauvret, et cela en particulier pour les p