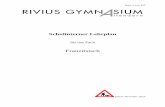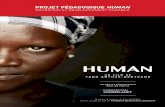02-couvRST2013-22févregardssurlaterre.com/sites/default/files/rst/2013-5-FR.pdfnotamment à la...
Transcript of 02-couvRST2013-22févregardssurlaterre.com/sites/default/files/rst/2013-5-FR.pdfnotamment à la...
Regards sur la Terre décrypte la complexité des processus qui composent le développe-ment durable et en révèle toute la richesse.
La première partie dresse le bilan de l’année 2012 : retour sur les dates qui ont marqué l’avancée des connaissances et la construction de l’action dans les domaines du climat, de la biodiversité, des ressources naturelles, de la gouvernance, de l’énergie, de la santé ou du développement ; analyse des événements clés et des tendances émergentes, identifi cation des acteurs majeurs, des enjeux et des perspectives.
Le Dossier 2013 traite des relations entre l’accroissement des inégalités contemporaines et l’insoutenabilité de nos trajectoires de développement. Les inégalités sont-elle un obstacle au développement durable ? La réduction des inégalités est-elle un prérequis à un mode de développement plus soutenable ? Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio, les aspects sociaux du développement et de la croissance ont en effet pris une place prépondérante dans le débat public. La frontière historique entre les préoccupations présumées pour l’environnement des pays de l’OCDE, actuellement en crise, et le désir légitime de croissance des pays émergents en pleine expansion semble aujourd’hui s’être brouillée et les équilibres mondiaux profondément transformés. Sous l’effet de la crise économique, les écarts de revenus entre pays riches et pays en développement n’ont fait que diminuer, mais les inégalités au sein même des pays n’ont jamais été aussi fortes, avec des conséquences immédiates sur la santé, l’urbanisation, la biodiversité… Objet de préoccupation commune, nécessitant la mise en œuvre de politiques nova-trices à l’échelle internationale, la question de la réduction des inégalités est au cœur des objectifs d’un développement qui permette à chacun un niveau de vie convenable tout en préservant les besoins des générations futures.
Fruit d’une coopération entre l’AFD (Agence française de développement), l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) et le TERI (The Energy and Resources Institute), Regards sur la Terre constitue un outil d’information et de compréhension indispensable.
Rémi GENEVEY, Rajendra K. PACHAURI et Laurence TUBIANA (dir.)
Réduire les inégalités : un enjeu de développement durable
2013
Rega
rds
sur l
a Te
rre
25 € Prix TTC France6990683ISBN : 978-2-200-28326-1
Établissement public, l’Agence française de développe-ment (AFD) agit depuis soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le gouvernement français. Présente
sur quatre continents où elle dispose d’un réseau de soixante-dix agences et bureaux de représentation dans le monde, dont neuf dans l’outre-mer et un à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance écono-mique et protègent la planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt tropicale, lutte contre le réchauffement climatique… En 2011, l’AFD a consacré près de 6,9 milliards d’euros au financement d’actions dans les pays en développement et en faveur de l’outre-mer. Ils contribueront notamment à la scolarisation de 4 millions d’enfants au niveau primaire et de 2 millions au niveau collège, et à l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable pour 1,53 million de personnes. Les projets d’efficacité éner-gétique sur la même année permettront d’économiser près de 3,8 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an. www.afd.fr
Institut de recherche sur les politiques, l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) a pour objectif d’élaborer et de partager des clés d’analyse et de compréhension des enjeux stratégiques
du développement durable dans une perspective mondiale. Face aux défis majeurs que représentent le changement climatique et l’érosion de la biodiversité, l’Iddri accompagne les différents acteurs dans la réflexion sur la gouvernance mondiale et participe aux travaux sur la redéfinition des trajectoires de développement. Ses travaux sont structurés transver-salement autour de cinq programmes thématiques : gouvernance, climat, biodiversité, fabrique urbaine et agriculture. www.iddri.org
The Energy and Resources Institute (TERI) est une organisation non gouvernementale indienne créée en 1974 pour développer des solutions innovantes afin de traiter les enjeux du développement durable, de
l’environnement, de l’efficacité énergétique et de la gestion des ressources naturelles. Ses diverses activités vont de la formulation de stratégies locales et nationales jusqu’à la proposition de politiques globales sur les enjeux énergétiques et environnementaux. Basé à Delhi, l’Institut est doté de plusieurs antennes régionales sur le territoire indien. www.teriin.org
Rémi GENEVEY, directeur exécutif à l’Agence française de développement (AFD), est actuellement responsable de la direction de la stratégie, qui regroupe les activités de production de connaissances, pilotage stratégique, évaluation et formation de l’AFD, ainsi que le Secrétariat du Fonds français pour l’environnement mondial. Il a exercé des fonctions de management à l’AFD dans
différents postes, en tant que directeur financier (2006-2008), directeur du département Méditerranée et Moyen-Orient (2002-2005), directeur de l’agence de l’AFD au Maroc (1999-2002), directeur général adjoint et directeur des opérations de Proparco, la filiale de l’AFD pour le financement du secteur privé (1994-1999). Il a été responsable entre 2008 et 2010 de la coordination, pour la France, du groupe de travail international en charge de la création du Centre de Marseille pour l’intégration méditerranéenne.
Laurence TUBIANA, économiste, a fondé et dirige l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) et la chaire Développement durable de Sciences Po. Elle est professeur au sein de l’École des affaires internationales de Sciences Po et à l’université Columbia (États-Unis). Elle est membre du comité de pilotage du débat national français sur la
transition énergétique et co-présidente du Leadership Council du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies. Chargée de mission puis conseillère auprès du Premier ministre sur les questions d’environnement de 1997 à 2002, elle a été directrice des biens publics mondiaux au ministère des Affaires étrangères et européennes. Elle est membre de divers conseils d’universités et de centres de recherches internationaux (Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement – Cirad, Earth Institute à l’université Columbia, Oxford Martin School). Elle est également membre du China Council for International Cooperation on Environment and Development et du Conseil d’orientation stratégique de l’Institute for Advanced Sustainability Studies (Potsdam, Allemagne).
Rajendra Kumar PACHAURI est docteur en génie industriel et en économie. Il est actuellement le directeur général de The Energy and Resources Institute (TERI) basé à Delhi (Inde). Depuis 2002, il préside le Groupe intergou-vernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2007.
20132013
Dossier
9 782200 283261
02-couvRST2013-22fév.indd 102-couvRST2013-22fév.indd 1 22/02/13 17:3622/02/13 17:36
98
RE
GA
RD
S S
UR
20
12
Le développement économique prodi-gieux de la planète, qui a sorti de la misère des centaines de millions de personnes au cours des dernières décennies, s’accompagne de dérègle-
ments d’une ampleur inédite : creusement des inégalités, réchauffement climatique, dégrada-tion et raréfaction de nombreuses ressources naturelles, crises fi nancières, multiplication des États « faillis », etc. Le constat de la fi nitude des ressources à partir des années 1970 et de la gravité des déséquilibres environnementaux, avec notamment la mesure du changement climatique à partir de 1985, a conduit à mettre l’accent sur les limites de notre modèle de croissance et de développement. La complexité croissante des enjeux à traiter, la nécessité de les aborder dans leur ensemble dans un monde interdépendant au fonctionnement globa-lisé, et le besoin de les transcrire de manière compréhensive et objective, ont progressive-ment ouvert de nouveaux thèmes de négocia-tion – et, souvent, de discorde – entre les pays.
Développement durable : une longue histoire, déjà… Depuis la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de Stockholm en 1972 et la mise en place du Programme des Nations unies pour l’environ-nement (PNUE), l’environnement a pris place dans les grandes discussions internationales. Dès le début, ce fut diffi cile : Stockholm cris-tallisa l’opposition entre pays du Nord et du Sud, les premiers prenant conscience qu’une résolution des problèmes d’environnement (et notamment d’environnement mondial comme
Rio+20 : un processus permanent ?Alexis BONNEL, AFD
le changement climatique, la biodiversité ou la désertifi cation) devait obligatoirement impli-quer les pays du Sud, tandis que ces derniers estimaient que l’environnement ne devait pas être un frein à leur développement.
Vingt ans plus tard, le Sommet de la Terre de Rio en 1992 avait pour ambition de renouveler les conceptions du développement pour conci-lier croissance économique, progrès sociaux et réponse aux défi s environnementaux. Le Sommet consacra le concept de « dévelop-pement durable », géniale invention de la Norvégienne Gro Harlem Brundtland1 pour tenter de rapprocher les positions entre pays développés et en développement. Qui peut être contre le développement durable, ou pour un développement non durable ? Malgré cela, le Sommet de 1992 ne parvint pas à dépasser les clivages Nord/Sud, faute de pouvoir rendre le mode de vie américain davantage « négo-ciable2 », et d’avoir suffi samment convaincu les pays en développement (PED) que la conver-sion à une économie verte et solidaire pouvait générer moults bénéfi ces.
Le Sommet de Rio de 1992 a toutefois permis des avancées, comme la véritable prise de conscience, à l’échelle internationale puis ensuite locale via les Agendas 21, de l’impor-tance des enjeux environnementaux et du lien fort entre développement et environnement. Rio 1992 a également élargi les débats à
1. Avril 1987, Notre avenir à tous, rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, présidée par Gro Harlem Brundtland.
2. Le président américain de l’époque, George W. Bush, avait déclaré en fin de Sommet que « le mode de vie américain n’est pas négociable ».
01-RST2013-26fev.indd 9801-RST2013-26fev.indd 98 26/02/13 12:0726/02/13 12:07
99
TE
ND
AN
CE
S,
AC
TE
UR
S,
FA
ITS
MA
RQ
UA
NT
S
d’autres acteurs et sujets (ONG, minorités, droits sociaux, approches participatives et démocratiques, etc.), ce qui a structuré les termes du débat. Pour la première fois, l’ensemble des parties a reconnu que la dégradation de l’environnement et la dilapi-dation des ressources fi niront par bloquer les processus de développement économique et social, notamment dans les pays les plus vulné-rables, et que ces enjeux doivent être cogérés à l’échelle planétaire.
Dans le grand marchandage qu’est un sommet mondial, les pays développés ont obtenu la reconnaissance d’une responsabilité commune sur les sujets environnementaux, et ceux en développement l’idée que cette responsabilité devait être différenciée, « étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement mondial », dont la responsabilité « historique » revient aux pays du Nord. Depuis, ce principe des « res-ponsabilités communes mais différenciées » a été introduit en droit international. Cette différenciation a notamment conduit les pays développés à s’engager à fi nancer les coûts additionnels qui résultent pour les PED de la prise en compte de l’environnement mondial. Cet engagement s’est concrètement traduit par la création d’un fonds spécifi que, le Fonds pour l’environnement mondial, fi nancé sur la base du volontariat. Par contre, le Sommet de 1992 a mis un terme à l’espoir de voir appliqué à la biodiversité le principe de « patrimoine commun de l’humanité », et a conforté la souveraineté des États en matière d’environne-ment mondial.
Au fi nal, la Conférence de Rio a donné une forte impulsion au concept de développement durable, transformant notre vision de la planète et de son avenir. Mais l’évolution du monde depuis 1992, le poids croissant des grands pays émergents, la pression grandis-sante sur les ressources naturelles ou encore le désordre climatique conduisent à s’interroger sur la pérennité de ce compromis « a minima ».
Rio+20 : ni un début, ni une fin…La Conférence de Rio+20 qui s’est tenue en juin 2012 avait pour ambition de renouveler une
dynamique pour concilier croissance écono-mique, progrès sociaux et réponse aux défi s environnementaux. Plus spécifi quement, outre un bilan de la mise en œuvre des décisions passées (Rio 1992 et Johannesburg 2002), la Conférence avait pour objectif de traiter deux thèmes : l’économie verte, dans le contexte du développement durable et de l’éradication de la pauvreté ; et le cadre institutionnel du déve-loppement durable. À ces deux thèmes offi -ciels s’est ajoutée la proposition de défi nir des objectifs de développement durable (ODD) pour structurer l’agenda des Nations unies autour d’un ensemble élargi et cohérent d’ob-jectifs économiques, sociaux et environnemen-taux après 2015.
Si les résultats de la Conférence sont jugés décevants par la majorité des observateurs, le texte fi nal présente quelques avancées. En matière de gouvernance, le PNUE a été renforcé (consolidation du siège à Nairobi, adhésion universelle à son conseil d’administration – qui ne comprend actuellement que cinquante-huit membres). Ces décisions restent cependant très en deçà de l’ambition de départ visant à transformer le PNUE, simple « programme » aux moyens limités, en une Organisation mon-diale de l’environnement (OME) pouvant jouer un rôle davantage normatif, prescriptif, voire devenir une « police de l’environnement ».
En matière d’économie verte, les résultats de Rio+20 sont particulièrement limités. Le concept est présenté comme un simple outil, sans être par ailleurs défi ni. Les PED craignaient que le concept conduise à une marchandisation de la nature et à la mise en place de nouvelles entraves commerciales. Les pays développés ont, quant à eux, refusé tout engagement nouveau sur des fi nancements additionnels pour accompagner les pays du Sud dans la conception et la mise en œuvre de politiques d’économie verte. In fi ne, le texte est peu engageant, même s’il cite le rôle du secteur privé et les opportunités d’emploi dans une économie verte.
Une des avancées les plus signifi catives de Rio+20 concerne la décision de préparer la mise en place, après 2015, d’objectifs de déve-loppement durable présentant un caractère
01-RST2013-26fev.indd 9901-RST2013-26fev.indd 99 26/02/13 12:0726/02/13 12:07
100
RE
GA
RD
S S
UR
20
12
universel, c’est-à-dire non limités aux seuls PED. Leur élaboration devra être coordonnée avec la suite des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), qui avaient été adop-tés lors du Sommet du Millénaire en 20003 avec l’ambition d’éradiquer la pauvreté dans le monde. Les OMD courent jusqu’en 2015, et ne concernent que les PED. La décision de Rio+20 sur les ODD marque un retour de balancier de l’approche principalement sociale des OMD, vers une approche plus équilibrée entre enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Toutefois, la Conférence n’a pas permis de parvenir à un accord sur une liste, même indicative, d’objectifs. La décision de Rio+20 indique que les ODD devront être « concrets, concis et faciles à comprendre, en nombre limité, ambitieux, d’envergure mondiale et susceptibles d’être appliqués dans tous les pays, compte tenu des réalités, des ressources et du niveau de développement respectifs de ceux-ci, ainsi que des politiques et des priorités nationales ». Leur défi nition devra ainsi conci-lier de multiples contradictions. Par ailleurs, le processus retenu pour la négociation, qui implique un groupe de pays et non pas directe-ment le Secrétariat général des Nations unies (SGNU), peut être interprété comme une marque de défi ance envers ce dernier, ce qui pourrait compliquer l’émergence d’une propo-sition ambitieuse.
En ce qui concerne les moyens de mise en œuvre, la Conférence a buté sur la demande du G77 4 de bénéfi cier de moyens nouveaux et additionnels pour fi nancer le développement durable (30 milliards de dollars jusqu’à 2017, puis 100 milliards à partir de 2018). Cette demande a fi nalement été retirée du texte, qui décide de mettre en place un groupe d’experts pour élaborer d’ici 2014 une « stratégie de
3. Les huit OMD sont : 1) réduire l’extrême pauvreté et la faim ; 2) assurer l’éducation primaire pour tous ; 3) promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 4) réduire la mortalité infantile ; 5) améliorer la santé maternelle ; 6) combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies ; 7) assurer un environnement durable ; 8) mettre en place un partenariat mondial pour le développement.
4. Coalition de 132 pays en développement, initialement créée par 77 pays, qui coordonne ses positions lors des grandes réunions onusiennes.
fi nancement du développement durable ». Il s’agit de repenser le système de fi nance-ment international du développement, dont le caractère fortement centralisé prévaut depuis les accords de Bretton Woods en 1944 et la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le texte de Rio+20 reconnaît ainsi l’importance des acteurs fi nanciers dans leur diversité (publics, privés, internationaux mais aussi régionaux et locaux), ouvre la porte à un rôle accru de ces derniers dans le développement durable, et s’intéresse à l’effi cacité d’une architecture fi nancière du développement durable qui a considérablement évolué ces dernières années. Ceci suppose de renforcer la coordi-nation, la cohérence et la complémentarité entre des canaux de fi nancement de plus en plus diversifi és, mais aussi de consolider les capacités des systèmes fi nanciers locaux et nationaux à intégrer le développement durable. Cependant, pour certains pays, cette « stratégie de fi nancement du développement durable » se borne à insister sur les fi nance-ments nouveaux et additionnels qu’ils n’ont pas obtenus à Rio+20.
Déconvenues européennesPlus généralement, le résultat de la Conférence peut être considéré comme une déconvenue pour les pays européens et les Nations unies, et une affi rmation du pouvoir des pays émer-gents ainsi que, dans une moindre mesure, de l’importance de la société civile.
L’Union européenne (UE) souhaitait une conférence aux conclusions ambitieuses, marquant une nouvelle étape dans l’agenda du développement durable. Certains observa-teurs lui reprochent d’avoir pris une position trop rigide, voire « donneuse de leçons » et d’avoir passé trop de temps en négociations internes aux dépens de l’écoute des autres délégations. C’est une déconvenue également pour le Secrétariat général des Nations unies qui n’a pas réussi à sortir des blocages du texte jusqu’à la reprise en main du processus par le gouvernement brésilien et se voit dessaisi de la suite des négociations sur les ODD ou le fi nancement.
01-RST2013-26fev.indd 10001-RST2013-26fev.indd 100 26/02/13 12:0726/02/13 12:07
101
TE
ND
AN
CE
S,
AC
TE
UR
S,
FA
ITS
MA
RQ
UA
NT
S
Le poids des émergents dans les négocia-tions, leur capacité à entraîner le G77 et leur approche minimaliste des accords internatio-naux se renforcent. Ces pays, dont certains font de réels efforts, ne veulent pas endosser des contraintes externes s’ajoutant aux défi s domestiques auxquels ils doivent faire face. Les affi rmations maintes fois réitérées dans le texte de Rio+20 sur les « responsabilités com-munes mais différenciées » ou encore sur la primauté de la « souveraineté nationale », sym-bolisent bien cette position. Réciproquement, le groupe des pays africains qui avait affi rmé à haut niveau son attachement à la création d’une OME basée sur leur continent (vraisem-blablement à Nairobi où se situe déjà le siège du PNUE) n’a pas réussi à tenir sa position et a rejoint le G77 sans batailler, au grand regret de l’UE qui croyait tenir là un allié solide.
Enfi n, la Conférence reconnaît le poids de la société civile dans le développement durable, tout comme celui des autorités locales et du secteur privé. Pour autant, les « dialogues du développement durable », le Global Town Hall et le Corporate Sustainability Forum qui les ont respectivement réunis en marge du Sommet, même s’ils ont formulé des propositions, n’ont eu in fi ne aucun impact sur l’issue de la négo-ciation, montrant par là que celle-ci reste avant tout une affaire d’États.
Que peut-on encore attendre des négociations internationales ? Faire s’accorder plus de 190 pays, par consensus, sur des sujets complexes et de long terme, est une gageure. Malgré la dramatisation parfois extrême de ces conférences, souvent considé-rées comme celles de « la dernière chance pour sauver la planète », le fait qu’elles accouchent à chaque fois d’une souris illustre l’ampleur et la complexité du problème.
Ces rendez-vous planétaires ne doivent pas être rejetés en bloc, d’autant que les alterna-tives sont diffi ciles à identifi er. Ils contribuent déjà, grâce aux retombées médiatiques asso-ciées, à la diffusion du savoir et à la maturation de la problématique, et ont permis d’engager un débat de société mondial, à l’échelle des enjeux. Depuis Rio 1992, l’environnement n’est
plus un sujet confi dentiel, géré par quelques excentriques. L’enjeu est devenu géopolitique, fi nancier, commercial, et la prise de conscience qu’il conditionne la stabilité du monde conti-nue à émerger.
La réfl exion lancée par Rio+20 vise un ensemble de débats essentiels. Ceux sur les ODD et sur la suite des OMD devront combi-ner, d’une part, des « planchers individuels », ensemble de services auxquels devraient avoir accès à terme tous les individus (éducation, santé, sécurité alimentaire), étendu à de nouveaux sujets (énergie, protection sociale, etc.) et pouvant déboucher sur la notion de « droits universels » et, d’autre part, s’agissant d’objectifs globaux, des « plafonds collectifs » prenant en compte, dans chaque domaine, des limites imposées par la nature et la capacité des technologies disponibles à les repousser.
Bien évidemment, ces discussions à l’échelle planétaire, aussi indispensables soient-elles, ne pourront à elles seules résoudre ces équations. Si l’on n’y prend pas garde, les négociations internationales peuvent même parfois devenir une solution de facilité pour les nombreux acteurs aux échelles nationales et locales, parce qu’ils y reportent la responsabilité de décisions diffi ciles à défi nir, à prendre, puis à mettre en œuvre. Le cadre international, même réformé et renforcé, ne peut servir que d’aiguillon pour des acteurs et des actions concrètes de terrain qui, en retour, peuvent inspirer les discussions internationales.
Une discussion sans fin pour gérer la complexité croissante du monde ?Le développement durable demeure un défi collectif. En dépit des nombreux efforts déjà entrepris, souvent dans la diffi culté et les contradictions, le concept comme ses décli-naisons opérationnelles restent diffi ciles à appréhender. Entre les tenants d’approches technico-économistes (pas de protection de l’environnement, ni de protection sociale sans une base économique forte), plus consen-suelles (concilier protection de l’environ-nement, équité sociale et croissance écono-mique), voire très écologiques (pas de péren-nité du système humain sans prise en compte
01-RST2013-26fev.indd 10101-RST2013-26fev.indd 101 26/02/13 12:0726/02/13 12:07
102
RE
GA
RD
S S
UR
20
12
du support écologique), l’espace de discussion semble infi ni.
Il n’y a probablement pas de cadre concep-tuel incontestable du développement durable. Sur un fond d’analyses de plus en plus nourries mais toujours incomplètes, chaque acteur individuel ou collectif, doté de son système de valeurs et d’intérêts, agit pour une certaine défi nition du monde ou ce qu’il devrait être. Le développement durable ressemble ainsi à une invention en discussion permanente, plus ou moins dirigée par une vision et une volonté politiques, et des arbitrages permanents entre intérêt local et global et entre le court et le long terme. Ce processus social, politique et institutionnel est particulièrement important et gagne à être accompagné. En réfl échissant davantage au contexte dans lequel chacun agit et aux multiples interdépendances entre
les projets entrepris, les secteurs et le monde extérieur, en enrichissant et multipliant les manières de penser et d’agir, en repoussant les limites habituelles de raisonnement, tant dans l’espace (ce qui se passe ici a un impact ailleurs, qu’il faut savoir apprécier et intégrer dans toute action) que dans le temps (en consi-dérant davantage le long terme dans les prises de décision), des espaces de débat s’ouvrent sur les nécessaires changements de modèle dans toutes leurs dimensions environnemen-tales, économiques et sociales.
Si progresser vers un « développement plus durable », c’est apprendre à déplacer, ne serait-ce que légèrement, notre regard sur le quotidien, avec une bonne dose d’optimisme et d’utopie, alors nous sommes loin d’en avoir fi ni avec les sommets de Rio et leurs déclinaisons locales… n
Après Rio+20
L’année 2015 est déjà inscrite sur l’agenda international comme la limite fixée pour avoir atteint les objectifs du Millénaire pour le développement fixés en 2000. Après Rio+20, c’est aussi la date à laquelle devront avoir été définis des objectifs de développement durable, communs, mesurables et vérifiables. L’agenda diplomatique s’organise autour de ces deux processus de négociation et d’évaluation.
REP
ÈRE
01-RST2013-26fev.indd 10201-RST2013-26fev.indd 102 26/02/13 12:0726/02/13 12:07
Regards sur la Terre décrypte la complexité des processus qui composent le développe-ment durable et en révèle toute la richesse.
La première partie dresse le bilan de l’année 2012 : retour sur les dates qui ont marqué l’avancée des connaissances et la construction de l’action dans les domaines du climat, de la biodiversité, des ressources naturelles, de la gouvernance, de l’énergie, de la santé ou du développement ; analyse des événements clés et des tendances émergentes, identifi cation des acteurs majeurs, des enjeux et des perspectives.
Le Dossier 2013 traite des relations entre l’accroissement des inégalités contemporaines et l’insoutenabilité de nos trajectoires de développement. Les inégalités sont-elle un obstacle au développement durable ? La réduction des inégalités est-elle un prérequis à un mode de développement plus soutenable ? Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio, les aspects sociaux du développement et de la croissance ont en effet pris une place prépondérante dans le débat public. La frontière historique entre les préoccupations présumées pour l’environnement des pays de l’OCDE, actuellement en crise, et le désir légitime de croissance des pays émergents en pleine expansion semble aujourd’hui s’être brouillée et les équilibres mondiaux profondément transformés. Sous l’effet de la crise économique, les écarts de revenus entre pays riches et pays en développement n’ont fait que diminuer, mais les inégalités au sein même des pays n’ont jamais été aussi fortes, avec des conséquences immédiates sur la santé, l’urbanisation, la biodiversité… Objet de préoccupation commune, nécessitant la mise en œuvre de politiques nova-trices à l’échelle internationale, la question de la réduction des inégalités est au cœur des objectifs d’un développement qui permette à chacun un niveau de vie convenable tout en préservant les besoins des générations futures.
Fruit d’une coopération entre l’AFD (Agence française de développement), l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) et le TERI (The Energy and Resources Institute), Regards sur la Terre constitue un outil d’information et de compréhension indispensable.
Rémi GENEVEY, Rajendra K. PACHAURI et Laurence TUBIANA (dir.)
Réduire les inégalités : un enjeu de développement durable
2013
Rega
rds
sur l
a Te
rre
25 € Prix TTC France6990683ISBN : 978-2-200-28326-1
Établissement public, l’Agence française de développe-ment (AFD) agit depuis soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le gouvernement français. Présente
sur quatre continents où elle dispose d’un réseau de soixante-dix agences et bureaux de représentation dans le monde, dont neuf dans l’outre-mer et un à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance écono-mique et protègent la planète : scolarisation, santé maternelle, appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt tropicale, lutte contre le réchauffement climatique… En 2011, l’AFD a consacré près de 6,9 milliards d’euros au financement d’actions dans les pays en développement et en faveur de l’outre-mer. Ils contribueront notamment à la scolarisation de 4 millions d’enfants au niveau primaire et de 2 millions au niveau collège, et à l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable pour 1,53 million de personnes. Les projets d’efficacité éner-gétique sur la même année permettront d’économiser près de 3,8 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an. www.afd.fr
Institut de recherche sur les politiques, l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) a pour objectif d’élaborer et de partager des clés d’analyse et de compréhension des enjeux stratégiques
du développement durable dans une perspective mondiale. Face aux défis majeurs que représentent le changement climatique et l’érosion de la biodiversité, l’Iddri accompagne les différents acteurs dans la réflexion sur la gouvernance mondiale et participe aux travaux sur la redéfinition des trajectoires de développement. Ses travaux sont structurés transver-salement autour de cinq programmes thématiques : gouvernance, climat, biodiversité, fabrique urbaine et agriculture. www.iddri.org
The Energy and Resources Institute (TERI) est une organisation non gouvernementale indienne créée en 1974 pour développer des solutions innovantes afin de traiter les enjeux du développement durable, de
l’environnement, de l’efficacité énergétique et de la gestion des ressources naturelles. Ses diverses activités vont de la formulation de stratégies locales et nationales jusqu’à la proposition de politiques globales sur les enjeux énergétiques et environnementaux. Basé à Delhi, l’Institut est doté de plusieurs antennes régionales sur le territoire indien. www.teriin.org
Rémi GENEVEY, directeur exécutif à l’Agence française de développement (AFD), est actuellement responsable de la direction de la stratégie, qui regroupe les activités de production de connaissances, pilotage stratégique, évaluation et formation de l’AFD, ainsi que le Secrétariat du Fonds français pour l’environnement mondial. Il a exercé des fonctions de management à l’AFD dans
différents postes, en tant que directeur financier (2006-2008), directeur du département Méditerranée et Moyen-Orient (2002-2005), directeur de l’agence de l’AFD au Maroc (1999-2002), directeur général adjoint et directeur des opérations de Proparco, la filiale de l’AFD pour le financement du secteur privé (1994-1999). Il a été responsable entre 2008 et 2010 de la coordination, pour la France, du groupe de travail international en charge de la création du Centre de Marseille pour l’intégration méditerranéenne.
Laurence TUBIANA, économiste, a fondé et dirige l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) et la chaire Développement durable de Sciences Po. Elle est professeur au sein de l’École des affaires internationales de Sciences Po et à l’université Columbia (États-Unis). Elle est membre du comité de pilotage du débat national français sur la
transition énergétique et co-présidente du Leadership Council du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies. Chargée de mission puis conseillère auprès du Premier ministre sur les questions d’environnement de 1997 à 2002, elle a été directrice des biens publics mondiaux au ministère des Affaires étrangères et européennes. Elle est membre de divers conseils d’universités et de centres de recherches internationaux (Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement – Cirad, Earth Institute à l’université Columbia, Oxford Martin School). Elle est également membre du China Council for International Cooperation on Environment and Development et du Conseil d’orientation stratégique de l’Institute for Advanced Sustainability Studies (Potsdam, Allemagne).
Rajendra Kumar PACHAURI est docteur en génie industriel et en économie. Il est actuellement le directeur général de The Energy and Resources Institute (TERI) basé à Delhi (Inde). Depuis 2002, il préside le Groupe intergou-vernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2007.
20132013
Dossier
9 782200 283261
02-couvRST2013-22fév.indd 102-couvRST2013-22fév.indd 1 22/02/13 17:3622/02/13 17:36