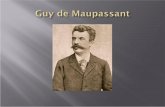00 UneVie prof - BIBLIO - HACHETTE vie Guy de Maupassant Livret pédagogique correspondant au livre...
-
Upload
nguyenkhue -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of 00 UneVie prof - BIBLIO - HACHETTE vie Guy de Maupassant Livret pédagogique correspondant au livre...
Une vie
Guy de Maupassant
L i v r e t p é d a g o g i q u e correspondant au livre élève n°53
établi par Véronique Brémond,
agrégée de Lettres classiques, professeur au CNED, et
Myriam Cournarie, certifiée de Lettres classiques, professeur en lycée
Sommaire – 2
S O M M A I R E
A V A N T - P R O P O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
T A B L E D E S C O R P U S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
R É P O N S E S A U X Q U E S T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bilan de première lecture (p. 286)......................................................................................................................................................... 6
Chapitre I (pp. 9 à 24)............................................................................................................................................................................ 7 ◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 25 à 27) ...................................................................................................................... 7 ◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 28 à 35) ........................................................................................................ 11
Chapitre VI (pp. 89 à 105).................................................................................................................................................................... 21 ◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 106-107) .................................................................................................................. 21 ◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 108 à 116) .................................................................................................... 24
Chapitre VIII (pp. 138 à 149)................................................................................................................................................................ 33 ◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 150-151) .................................................................................................................. 33 ◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 152 à 160) .................................................................................................... 37
Chapitre X (pp. 185 à 206)................................................................................................................................................................... 46 ◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 207 à 209) ................................................................................................................ 46 ◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 210 à 217) .................................................................................................... 50
Chapitre XI (pp. 218 à 239).................................................................................................................................................................. 58 ◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 240-241) .................................................................................................................. 58 ◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 242 à 252) .................................................................................................... 61
C O M P L É M E N T S A U X L E C T U R E S D ’ I M A G E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8
B I B L I O G R A P H I E C O M P L É M E N T A I R E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
Tous droits de traduction, de représentation et d’adaptation réservés pour tous pays. © Hachette Livre, 2009. 43, quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15. www.hachette-education.com
Une vie – 3
A V A N T - P R O P O S
Les programmes de français au lycée sont ambitieux. Pour les mettre en œuvre, il est demandé à la fois de conduire des lectures qui éclairent les différents objets d’étude au programme et, par ces lectures, de préparer les élèves aux techniques de l’épreuve écrite (lecture efficace d’un corpus de textes ; analyse d’une ou deux questions préliminaires ; techniques du commentaire, de la dissertation, de l’argumentation contextualisée, de l’imitation…). Ainsi, l’étude d’une même œuvre peut répondre à plusieurs objectifs. Une vie, en l’occurrence, permet d’étudier la construction romanesque d’un personnage de femme caractéristique du XIXe siècle, d’observer les mutations du genre romanesque entre réalisme et naturalisme, et d’apprécier la prose sensible et efficace de Maupassant, tout en s’exerçant à différents travaux d’écriture… Dans ce contexte, il nous a semblé opportun de concevoir une nouvelle collection d’œuvres classiques, Bibliolycée, qui puisse à la fois : – motiver les élèves en leur offrant une nouvelle présentation du texte, moderne et aérée, qui facilite la lecture de l’œuvre grâce à des notes claires et quelques repères fondamentaux ; – vous aider à mettre en œuvre les programmes et à préparer les élèves aux travaux d’écriture. Cette double perspective a présidé aux choix suivants : • Le texte de l’œuvre est annoté très précisément, en bas de page, afin d’en favoriser la pleine compréhension. • Il est accompagné de documents iconographiques visant à rendre la lecture attrayante et enrichissante, la plupart des reproductions pouvant donner lieu à une exploitation en classe, notamment au travers des lectures d’images proposées dans les questionnaires des corpus. • En fin d’ouvrage, le « Dossier Bibliolycée » propose des études synthétiques et des tableaux qui donnent à l’élève les repères indispensables : biographie de l’auteur, contexte historique, liens de l’œuvre avec son époque, genres et registres du texte… • Enfin, chaque Bibliolycée offre un appareil pédagogique destiné à faciliter l’analyse de l’œuvre intégrale en classe. Présenté sur des pages de couleur bleue afin de ne pas nuire à la cohérence du texte (sur fond blanc), il comprend : – Un bilan de première lecture qui peut être proposé à la classe après un parcours cursif de l’œuvre. Il se compose de questions courtes qui permettent de s’assurer que les élèves ont bien saisi le sens général de l’œuvre. – Des questionnaires raisonnés en accompagnement des extraits les plus représentatifs de l’œuvre : l’élève est invité à observer et à analyser le passage. On pourra procéder en classe à une correction du questionnaire ou interroger les élèves pour construire avec eux l’analyse du texte. – Des corpus de textes (accompagnés le plus souvent d’un document iconographique) pour éclairer chacun des extraits ayant fait l’objet d’un questionnaire ; ces corpus sont suivis d’un questionnaire d’analyse des textes (et éventuellement de lecture d’image) et de travaux d’écriture pouvant constituer un entraînement à l’épreuve écrite du bac. Ils peuvent aussi figurer, pour la classe de Première, sur le « descriptif des lectures et activités » à titre de groupements de textes en rapport avec un objet d’étude ou de documents complémentaires. Nous espérons ainsi que la collection Bibliolycée sera, pour vous et vos élèves, un outil de travail efficace, favorisant le plaisir de la lecture et la réflexion.
Table des corpus – 4
T A B L E D E S C O R P U S
Corpus Composition du corpus Objet (s) d’étude et niveau (x)
Compléments aux travaux d’écriture destinés aux séries technologiques
À quoi rêvent les jeunes filles ? (p. 28)
Texte A : Extrait du chapitre I d’Une vie de Guy de Maupassant (p. 19, l. 321, à p. 20, l. 366). Texte B : Extrait du Rouge et le Noir de Stendhal (pp. 29-30). Texte C : Extrait des Misérables de Victor Hugo (pp. 30-32). Texte D : Extrait de Guerre et Paix de Léon Tolstoï (pp. 32-33). Document : Femme à la fenêtre de Caspar David Friedrich (pp. 33-34).
Un mouvement culturel et littéraire : le romantisme (Seconde) Le récit : le roman et la nouvelle (Seconde) Le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde (Première)
Questions préliminaires 1) Quels traits de caractère communs ont ces jeunes filles ? 2) Quelle vision ont-elles de l’amour ? Commentaire Vous montrerez comment Hugo nous présente la découverte de l’amour chez une jeune fille pure et naïve.
L’ennui (p. 108)
Texte A : Extrait du chapitre VI d’Une vie de Guy de Maupassant (p. 89, l. 2113, à p. 90, l. 2151). Texte B : Extrait d’Indiana de George Sand (pp. 109-110). Texte C : Extrait de La Confession d’un enfant du siècle d’Alfred de Musset (pp. 110-112). Texte D : Extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert (pp. 112-113). Texte E : Extrait de La Joie de vivre d’Émile Zola (pp. 113-114). Document : Méditation de Claude Monet (pp. 114-115).
Un mouvement culturel et littéraire : le romantisme et le naturalisme (Seconde) Le récit : le roman et la nouvelle (Seconde) Le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde (Première)
Question préliminaire Quelles sont les manifestations physiques de l’ennui dans l’ensemble des documents ? Commentaire Vous pourrez montrer comment Zola nous fait comprendre l’ennui et l’angoisse de son personnage.
Maternités (p. 152)
Texte A : Extrait du chapitre VIII d’Une vie de Guy de Maupassant (p. 142, l. 3499, à p. 143, l. 3542). Texte B : Extrait des Mémoires de deux jeunes mariées d’Honoré de Balzac (pp. 152-154). Texte C : Extrait de La Terre d’Émile Zola (pp. 154-155). Texte D : Extrait de La Maison de Claudine de Colette (pp. 155-156). Texte E : Extrait de Désert de J. -M. G. Le Clézio (pp. 156-158). Document : La Jeune Mère de Jean-Louis Hamon (p. 158).
Le récit : le roman et la nouvelle (Seconde) Le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde (Première)
Question préliminaire Quels sont les sentiments des mères à l’égard de leur enfant dans ces cinq textes et le tableau ? Comment sont-ils exprimés ? Commentaire Vous pourrez montrer comment Colette, à travers un récit autobiographique, nous présente l’amour maternel de Sido.
Éloge et blâme de la figure religieuse dans les récits du XIXe siècle (p. 210)
Texte A : Extrait du chapitre X d’Une vie de Guy de Maupassant (p. 192, l. 4760, à p. 194, l. 4831). Texte B : Second extrait d’Une vie de Guy de Maupassant (p. 211). Texte C : Extrait du Curé de Tours d’Honoré de Balzac (pp. 211-212). Texte D : Extrait des Misérables de Victor Hugo (pp. 212-214). Texte E : Extrait du Baptême de Guy de Maupassant (pp. 214-216).
L’éloge et le blâme (Seconde) Un mouvement culturel et littéraire : le réalisme (Seconde) Convaincre, persuader et délibérer (Première) Le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde (Première)
Question préliminaire Quels sont, dans ces cinq textes, les éloges et les blâmes concernant les personnages de prêtres ? Commentaire Vous pourrez montrer en quoi ces deux personnages s’opposent et comment leur portrait physique permet de révéler leur intériorité.
Une vie – 5
Corpus Composition du corpus Objet (s) d’étude et niveau (x)
Compléments aux travaux d’écriture destinés aux séries technologiques
Maîtresses et servantes (p. 242)
Texte A : Extrait du chapitre XI d’Une vie de Guy de Maupassant (p. 236, l. 5828, à p. 237, l. 5864). Texte B : Extrait de Tristan et Iseut adapté par Joseph Bédier (pp. 243-245). Texte C : Extrait de Phèdre de Jean Racine (pp. 245-246). Texte D : Extrait du Mariage de Figaro de Beaumarchais (pp. 246-248). Texte E : Extrait de « Un cœur simple » de Gustave Flaubert (pp. 248-249). Document : Femme avec servante lui tendant une lettre de Johannes Vermeer (p. 250).
Le récit : le roman et la nouvelle (Seconde) Le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde (Première).
Question préliminaire Quels sont les liens qui unissent servantes et maîtresses dans ces cinq textes et le tableau ? Commentaire Vous pourrez montrer comment Flaubert transforme une scène très simple en moment d’émotion.
Réponses aux questions – 6
R É P O N S E S A U X Q U E S T I O N S
B i l a n d e p r e m i è r e l e c t u r e ( p . 2 8 6 )
u Le sous-titre du roman est « L’humble vérité ». v La propriété de la famille de Jeanne s’appelle Les Peuples et se situe dans le pays de Caux, près d’Yport (Étretat, Fécamp). w Jeanne a 17 ans au début du roman et a été élevée au couvent à Rouen depuis l’âge de 12 ans. x Le trait de caractère principal du baron est la bonté qui le conduit à être dispendieux : « Sa grande force et sa grande faiblesse, c’était la bonté, une bonté qui n’avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre, une bonté de créateur, éparse, sans résistance, comme l’engourdissement d’un nerf de la volonté, une lacune dans l’énergie, presque un vice » (l. 28-31). y Rosalie est la servante attachée au service de la baronne, pour « guider les pas de sa maîtresse » (l. 93-94). U Jeanne rêve du grand amour et d’une vie familiale idyllique aux Peuples (l. 378-382). V Jeanne se sent parfaitement heureuse le soir de son arrivée aux Peuples quand elle rêve devant sa fenêtre ouverte, lors de la promenade en bateau avec Julien, le baron et le père Lastique (chap. III) et quand elle découvre le plaisir amoureux dans le val d’Ota (on peut évoquer aussi les bains de mer, la découverte de son enfant à la fin de l’accouchement…). W Le voyage de noces de Jeanne se déroule en Corse, où elle y découvre le plaisir amoureux. X Jeanne sombre dans le désespoir quand elle trouve Julien et Rosalie ensemble, quand elle veille sa mère et découvre son adultère, après l’enterrement de Tante Lison qui succède de peu à celui de son père (on peut rajouter le départ de Poulet pour la pension au Havre, l’annonce de sa liaison avec une femme de mauvaise vie, l’errance de Jeanne à Paris à la recherche de son fils…). at Julien trompe Jeanne avec Rosalie puis avec Gilberte de Fourville. ak Tante Lison, la sœur de la baronne, est restée vieille fille et n’inspire qu’un « doux mépris » à la famille, personne ne faisant attention à elle, malgré sa gentillesse (l. 1195-1206). al L’enfant de Jeanne se prénomme Paul et est surnommé Poulet. am Jeanne et sa famille le gâtent et le couvent, au point qu’il devient paresseux et capricieux. Le baron essaie de l’instruire, mais Jeanne a toujours peur qu’il se fatigue ; il ne va plus au catéchisme après y avoir attrapé un mal de gorge. Puis le baron, quand Paul a 15 ans, force Jeanne à le mettre au collège au Havre, mais il n’y fait rien et finit par fuguer. an Julien meurt avec Gilberte de Fourville, dans une cabane roulante précipitée du haut de la falaise par le comte de Fourville. ao Le roman raconte la mort de la baronne et celle de Julien et évoque celles du baron et de Tante Lison. ap Le nouveau curé se nomme « l’abbé Tolbiac » : il est violent, fanatique, mystique, intransigeant, névrotiquement attaché à la chasteté. aq Rosalie réapparaît au cimetière, lors de l’enterrement de Tante Lison, et emporte dans ses bras Jeanne accablée de chagrin et incapable de réagir. Désormais, elle restera auprès d’elle et prendra en main sa destinée et sa fortune. ar Paul s’enfuit avec une femme de mauvaise vie, s’installe à Londres, fonde une société de paquebots qui périclite rapidement et le ruine avant de ruiner sa famille. Il se réfugie à Paris, vivant de l’argent de sa famille et multipliant les dettes. Sa maîtresse meurt en donnant naissance à une petite fille. as Le roman se termine sur l’arrivée de la petite-fille de Jeanne, que Rosalie est allée chercher à Paris, après la mort de sa mère. bt La dernière phrase du roman est prononcée par Rosalie.
Une vie – 7
C h a p i t r e I ( p p . 9 à 2 4 )
◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 25 à 27)
Une « poésie vivante » u Dans les lignes 321 à 344, la nature a un effet progressif sur la sensibilité de Jeanne. La description est organisée sous forme d’une série de paragraphes de longueur inégale en asyndète. Dans le premier, Jeanne contemple la mer, puis, dans le second, elle respire les parfums de la nature environnante ; très vite, dès le troisième, ces sensations l’apaisent, la rendent heureuse : Jeanne « s’abandonna au bonheur de respirer : et le repos de la campagne la calma comme un bain frais. » Le narrateur décrit alors les animaux qui « s’éveillent quand vient le soir ». Puis il passe des animaux à Jeanne, établissant une comparaison entre eux et la naissance d’une multitude de désirs en elle : « Il semblait à Jeanne que son cœur s’élargissait, plein de murmures comme cette soirée claire, fourmillant soudain de mille désirs rôdeurs, pareils à ces bêtes nocturnes dont le frémissement l’entourait. » La rêverie amoureuse qui va naître se trouve ainsi annoncée par la métaphore de ce cœur qui s’élargit et cette fusion avec la nature : « Une affinité l’unissait à cette poésie vivante ; et dans la molle blancheur de la nuit elle sentait courir des frissons surhumains, palpiter des espoirs insaisissables, quelque chose comme un souffle de bonheur. » v Les sens de Jeanne sont en éveil et elle éprouve de multiples sensations : comme nous venons de le voir, ce sont d’abord des sensations visuelles (« Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir sous les étoiles »), puis olfactives (« toutes les senteurs de la terre se répandaient. Un jasmin […] exhalait continuellement son haleine pénétrante qui se mêlait à l’odeur plus légère des feuilles naissantes »), et parfois à la fois olfactives et tactiles, avec le vent (« De lentes rafales passaient, apportant des saveurs fortes de l’air salin »), et enfin auditives (Jeanne est attentive aux bruits particuliers de la nuit : « des bourdonnements d’insectes invisibles effleuraient l’oreille » ; « Seuls quelques crapauds mélancoliques poussaient vers la lune leur note courte et monotone »). Extrêmement sensuelle et sensible, elle s’unit corps et âme au paysage, en perçoit les moindres modifications, s’en imprègne ; à tel point qu’elle n’est plus séparée de la nature mais en totale osmose avec elle. De plus, ses sensations sont unies et non séparées, soit parce qu’elles sont de même nature (c’est le cas des sensations olfactives : « toutes les senteurs de la terre […] qui se mêlai[en]t à l’odeur plus légère des feuilles naissantes »), soit parce qu’elles sont différentes mais mêlées (« De lentes rafales passaient, apportant les saveurs fortes de l’air salin et de la sueur visqueuse des varechs »), cette impression étant aussi renforcée par le fait que toutes ces sensations ne sont éprouvées que par une seule et même personne. On peut alors parler de « synesthésies ». Le bonheur que Jeanne va ressentir sera en partie dû à cette impression d’unité, d’accord parfait, d’harmonie entre elle et le monde et entre les différentes sensations. Livrée tout entière à son bonheur et à sa rêverie, elle imaginera qu’elle et son amant mêleront « leur amour à la limpidité suave des nuits d’été ». Cette expression résume en une magnifique formule de conclusion aux sonorités glissantes en s la très grande douceur du plaisir éprouvé. w Le fait que cette scène soit nocturne la rend singulière et crée une atmosphère particulière, plus silencieuse, plus sereine que pendant la journée, comme le montre la première phrase du second paragraphe : « Dans cet apaisement du soleil absent ». La préposition de lieu « dans » évoque à la fois le lieu et la cause. La nuit est ici présentée par une périphrase, insistant sur l’absence de soleil, créant une rime intérieure en -ent avec des allitérations en s et en ap/ab. C’est parce qu’il fait nuit que l’atmosphère est si douce et les sensations si développées. Les parfums s’exhalent (« toutes les senteurs »), les formes deviennent des ombres (« des courses muettes traversaient l’herbe » ; « De grands oiseaux qui ne criaient point fuyaient dans l’air comme des taches, comme des ombres »). Les bruits se font mieux entendre ou deviner (« des bourdonnements d’insectes invisibles effleuraient l’oreille » ; « Seuls quelques crapauds mélancoliques »), se détachant dans le silence de la nuit. La nature se peuple de présences invisibles pendant la journée (« Toutes les bêtes qui s’éveillent quand vient le soir, et cachent leur existence obscure dans la tranquillité des nuits, emplissaient les demi-ténèbres d’une agitation silencieuse »). Le narrateur insiste sur leur nombre avec l’adjectif indéfini « Toutes » et le verbe emplir, et, plus loin, le verbe fourmiller et l’hyperbole « mille » (« fourmillant soudain de mille désirs rôdeurs, pareils à ces bêtes nocturnes dont le frémissement l’entourait »). Tout est au pluriel. On a l’impression d’un soudain peuplement nocturne. L’énumération est longue, accentuant l’idée d’abondance, presque de multitude (« De grands oiseaux […] ; des bourdonnements […] ; des courses muettes »). Jeanne est très sensible à une telle atmosphère qui,
Réponses aux questions – 8
aussitôt, l’apaise, elle qui, trop excitée par son retour, ne parvient pas à dormir (« des flots qui semblaient dormir sous les étoiles » ; « Le repos de la campagne la calma comme un bain frais » ; « la tranquillité des nuits […] emplissai[t] les demi-ténèbres d’une agitation silencieuse » ; « des courses muettes traversaient l’herbe » ; « Il semblait à Jeanne que son cœur s’élargissait, plein de murmures comme cette soirée claire »). La nuit est aussitôt personnifiée : les flots semblent dormir, la campagne se repose. En outre, il s’agit d’une nuit éclairée par la lune et les étoiles. Ce sont des « demi-ténèbres ». La nuit donne au paysage une beauté particulière : la surface de la mer est « moirée » ; le narrateur désigne la nuit par l’expression « molle blancheur de la nuit ». Plus tard, lorsque Jeanne rêve et imagine passer des « soirs pareils à celui-ci » avec celui qu’elle aime, elle se voit « sous la cendre lumineuse qui tombait des étoiles ». La métaphore fait briller cette nuit d’une lumière argentée qui tombe sous la forme extrêmement fine d’une poussière scintillante. x On remarque dans le deuxième paragraphe des assonances et des allitérations. Les sons ouverts en a, en ai, ainsi que les voyelles nasalisées accentuent l’impression que tout est vaste, ample : « Dans cet apaisement du soleil absent, toutes les senteurs de la terre se répandaient. Un jasmin grimpé autour des fenêtres d’en bas exhalait continuellement son haleine pénétrante qui se mêlait à l’odeur plus légère des feuilles naissantes. De lentes rafales passaient, apportant les saveurs fortes de l’air salin et de la sueur visqueuse des varechs. » Et l’abondance de sifflantes et de fricatives laisse une impression de douceur. Ces harmonies sonores renforcent l’impression d’unité. y Le quatrième paragraphe n’est composé que de 2 phrases, la seconde étant formée de propositions indépendantes juxtaposées qui lui donnent un rythme particulier : « Toutes les bêtes qui s’éveillent […] ou le sable des chemins déserts. » Nous avons déjà évoqué dans la question 3 l’effet provoqué par une telle énumération. Le rythme des phrases est régulier, le nombre de syllabes étant quasiment identique dans chaque proposition. L’imparfait renforce l’impression de durée, de lenteur. La répétition « comme des taches, comme des ombres » accentue la musicalité de ce passage. Jeanne perçoit les bruits et les mouvements des animaux les uns après les autres, sans qu’il y ait de rupture entre eux. Tout s’enchaîne et pourrait ainsi continuer indéfiniment. U L’expression « poésie vivante » désignée par l’adjectif démonstratif « cette » apparaît au sixième paragraphe et résume à elle seule cette première partie du texte où Jeanne, avant de s’abandonner à sa rêverie amoureuse, se sent en osmose avec un paysage extrêmement vivant et qui a éveillé tous ses sens (« Une affinité naissante l’unissait à cette poésie vivante »). La poésie est une aptitude à voir le monde et à s’étonner, à s’émerveiller. Elle est inséparable de l’idée de « beauté », d’« esthétique », et liée à l’émotion que font naître la vision, la contemplation d’une telle beauté. Toute cette première partie du texte est une description de la magnificence d’une nature sensuelle et débordante (cf. questions précédentes). Le texte est d’autant plus poétique qu’il est empreint de lyrisme, Jeanne étant bouleversée par le paysage nocturne qu’elle a sous les yeux et auquel elle se sent unie. L’écriture de Maupassant, par ses nombreuses images, ses rythmes, ses répétitions, ses sonorités, parvient à traduire en mots, à recréer, en un long poème en prose, la poésie déjà existante dans la nature.
Un « paysage état d’âme » V Le passage commence par l’expression « Jeanne regardait au loin », ce qui introduit aussitôt le lecteur dans le champ de vision du personnage et montre que le point de vue adopté est interne. Puis le troisième paragraphe débute par ces mots : « La jeune fille s’abandonna d’abord au bonheur de respirer ». Ainsi, tout sera non seulement vu mais aussi senti par l’intermédiaire de Jeanne. C’est pourquoi le lecteur perçoit le monde comme elle le perçoit et entre dans son intimité. Cela lui permet de mieux comprendre Jeanne. Sa sensibilité à la sensualité et à la beauté de cette nuit de printemps est un des signes de sa personnalité et, en ce début de roman, elle crée une atmosphère particulière, qu’on retrouvera tout au long du récit. Le ton est donné. Ce point de vue interne sera le point de vue choisi par le narrateur tout au long du roman. W Dans cette suite de paragraphes où le paysage est décrit, Jeanne apparaît quasiment un paragraphe sur deux. Cette première partie est en effet composée de 6 paragraphes et elle intervient aux paragraphes 1, 3 et 5, ce qui permet une sorte d’alternance, un « va-et-vient » entre Jeanne et le paysage. Comme nous l’avons déjà vu, le point de vue dans ce passage est interne et tout est donc perçu par l’intermédiaire de Jeanne. Dès la première phrase précédemment citée (« Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots »), nous savons en effet que la description sera faite suivant la façon
Une vie – 9
dont Jeanne perçoit les éléments du paysage. Les sensations évoquées dans les deux premiers paragraphes sont donc éprouvées par Jeanne, mais le narrateur ne l’a pas encore mentionné explicitement. C’est à partir du troisième paragraphe qu’il évoque l’effet bénéfique de la nature sur son état d’esprit : « La jeune fille s’abandonna d’abord au bonheur de respirer : et le repos de la campagne la calma comme un bain frais. » Le fait que la jeune fille « s’abandonne » ainsi « au bonheur de respirer » montre à quel point elle est non seulement sensuelle mais aussi en quelque sorte attentive à ce qu’elle ressent. Le verbe abandonner conjugué à la forme pronominale réfléchie pour une action habituellement naturelle et même vitale montre à quel point elle éprouve du plaisir au contact de ce paysage. C’est encore un « bonheur » sensuel qui va peu à peu s’intérioriser. La comparaison avec un bain frais fait allusion au corps et présente, dès ce début du roman, une jeune fille proche de son corps et de ses sens. Puis le huitième paragraphe commence de la même façon, par une réaction de Jeanne à la beauté nocturne du monde qui l’entoure, mais ses sentiments ont évolué : la phrase « Il semblait à Jeanne que son cœur s’élargissait » reprend l’idée de « bonheur » décrite dans le sixième paragraphe, mais cette fois-ci il s’agit de son cœur. On entre donc dans le domaine des sentiments, de l’affectivité. Jeanne est de plus en plus heureuse, de plus en plus proche de la nature : « Une affinité l’unissait à cette poésie vivante ; et dans la molle blancheur de la nuit elle sentait courir des frissons surhumains, palpiter des espoirs insaisissables, quelque chose comme un souffle de bonheur. » Cette dernière phrase met sur le même plan « des frissons surhumains » et « des espoirs insaisissables », ce qui témoigne d’un tempérament particulier : une immense sensibilité, à fleur de peau, peu de séparation entre les sensations et les sentiments qui sont ici mêlés et peu de connaissance de soi. Jeanne n’analyse pas ce qu’elle ressent : elle est un réceptacle de sensations. X Très rapidement, Jeanne se trouve unie au paysage qui l’entoure. Les sensations et les sentiments qu’elle éprouve sont tellement en accord avec lui qu’on a l’impression qu’ils émanent du paysage. Comme nous l’avons déjà analysé, le narrateur passe, par le biais d’une comparaison, de la tranquillité de la nuit à celle de Jeanne (« Dans cet apaisement du soleil absent, […] la jeune fille s’abandonna […] et le repos de la campagne la calma comme un bain frais ») ; elle hume les parfums et les murmures des animaux emplissent son cœur (« Il semblait à Jeanne que son cœur s’élargissait […] comme un souffle de bonheur »). Dans cette phrase, Maupassant a créé une impression d’osmose parfaite entre Jeanne et le monde qui l’entoure (« Une affinité l’unissait à cette poésie vivante ») ; les comparaisons y contribuent (« comme cette soirée claire, […] pareils à ces bêtes nocturnes »). Il évoque son cœur comme étant « plein de murmures ». Ce qui se passe à l’extérieur se passe aussi à l’intérieur d’elle-même. Pour renforcer cette impression, il emploie des verbes ou des substantifs appartenant au même champ lexical, aussi bien pour évoquer la multitude des désirs qui s’agitent en elle que l’agitation du monde autour d’elle : « fourmillant », « frémissement », « frissons surhumains », « palpiter ». at Dans le sixième paragraphe (cf. question 9), Jeanne est tellement en osmose avec la nature que ses sensations sont intériorisées : dans la phrase « Il semblait à Jeanne que son cœur s’élargissait », le verbe s’élargir, utilisé à la forme pronominale réfléchie de façon métaphorique, met bien en valeur le bonheur éprouvé. Son cœur se dilate, s’agrandit, toutes les sensations évoquées dans les paragraphes précédents y pénétrant. Les murmures des animaux y sont entrés : puisque son cœur en est « plein », les espoirs palpitent en elle et son bonheur est ressenti « comme un souffle ». Ses sentiments sont éprouvés comme des sensations olfactives, tactiles ou auditives et sont aussi « insaisissables », évanescents et impalpables qu’elles. ak La rêverie de Jeanne est introduite par la conjonction de coordination et qui a ici valeur de conséquence, comme on le constate souvent chez Flaubert : la phrase « Et elle se mit à rêver d’amour » forme à elle seule un paragraphe, créant ainsi une sorte de silence autour d’elle. Ce procédé rappelle aussi les fameux « blancs » de Flaubert. La progression du texte a préparé le lecteur à cette rêverie. À partir du moment où Jeanne s’est « abandonn[ée] au bonheur de respirer », elle se fond dans le paysage. Le verbe s’abandonner est révélateur de l’état d’esprit du personnage qui, peu à peu, se trouve en fusion avec le paysage. De plus, cette rêverie correspond à une attente de deux ans : « L’amour ! Il l’emplissait depuis deux années de l’anxiété croissante de son approche. » On retrouve dans la rêverie de Jeanne les mêmes éléments du paysage que ceux qu’elle a sous les yeux. Ainsi, les étoiles font à nouveau partie du décor : à la première phrase « Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir sous les étoiles » répond la phrase « Ils se promèneraient par les soirs pareils à celui-ci, sous la cendre lumineuse qui tombait des étoiles ». Le décor change à peine et,
Réponses aux questions – 10
comme dans un morceau de musique, la seconde phrase est une variation de la première, la nuit rêvée étant, elle aussi, illuminée par les étoiles. On passe d’une nuit printanière à une nuit d’été qui possède la même douceur et provoque la même volupté : « mêlant leur amour à la limpidité suave des nuits d’été ». En imaginant son amant présent, Jeanne est parcourue d’un « vague frisson de sensualité » et cette expression répond à : « elle sentait courir des frissons surhumains ». Personnifiant à nouveau le printemps, comme il avait personnifié le jasmin, le narrateur réemploie le mot « haleine » (« comme si l’haleine du printemps lui eût donné un baiser d’amour »).
La rêverie d’amour al Nous avons vu que la focalisation interne permettait au lecteur d’entrer dans la pensée de Jeanne. Le narrateur utilise aussi le discours indirect libre : « Comment serait-il ? Elle ne le savait pas au juste et ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout. Elle savait seulement qu’elle l’adorerait […]. Ils iraient, les mains dans les mains, serrés l’un contre l’autre ». am Jeanne est une jeune fille naïve, romanesque et romantique. Sa rêverie d’amour n’est pas dénuée de clichés. La focalisation interne empêche le narrateur de glisser des sous-entendus, d’introduire son avis. Mais une telle naïveté qui – on le verra par la suite – finira par perdre Jeanne peut faire sourire le lecteur. Tout y est : Jeanne idéalise son amant qui (cf. question suivante) n’est ni décrit ni imaginé avec précision ; né de la rêverie de Jeanne, il n’a que des contours flous (« il serait lui, voilà tout ») ; Jeanne se voit déjà en train de se promener avec lui, main dans la main, un soir d’été, sous un ciel étoilé (« Ils se promèneraient par les soirs pareils à celui-ci, sous la cendre lumineuse qui tombait des étoiles. Ils iraient, les mains dans les mains, […] mêlant leur amour à la limpidité suave des nuits d’été »). an Le « Prince Charmant » est un inconnu d’abord désigné par le pronom « lui » mis en valeur par la tournure emphatique, la virgule et le point d’exclamation : « elle n’avait plus qu’à le rencontrer, lui ! ». Puis Jeanne s’interroge : « Comment serait-il ? » et aussitôt se débarrasse de la question par deux propositions négatives, mettant en valeur son ignorance et son refus de se le représenter précisément (« Elle ne le savait pas au juste et ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout »). On retrouve le verbe savoir au paragraphe suivant, mais pour évoquer une certitude : « Elle savait seulement qu’elle l’adorerait de toute son âme et qu’il la chérirait de toute sa force. » Cette parfaite réciprocité des sentiments est exprimée par une phrase au rythme binaire avec des parallélismes (à « de toute sa force » répond « de toute son âme ») et un chiasme (avec l’inversion des pronoms personnels : « elle l’adorerait »/« il la chérirait »). Jeanne imagine qu’elle l’aimera passionnément et que cet amour sera parfaitement réciproque. Le narrateur utilise alors, pour reproduire les pensées de Jeanne, un vocabulaire hyperbolique : « elle l’adorerait de toute son âme et qu’il la chérirait de toute sa force » ; l’amour dont elle rêve sera fusionnel, leurs âmes et leurs corps ne feront plus qu’un : c’est un véritable conte de fées (p. 20 : « serrés l’un contre l’autre, entendant battre leurs cœurs, sentant la chaleur de leurs épaules, mêlant leur amour à la limpidité suave des nuits d’été, tellement unis qu’ils pénétreraient aisément, par la seule puissance de leur tendresse, jusqu’à leurs plus secrètes pensées » ; ce qui s’oppose à ce qu’elle découvrira plus tard, p. 80 : « s’apercevant pour la première fois que deux personnes ne se pénètrent jamais jusqu’à l’âme, jusqu’au fond des pensées, qu’elles marchent côte à côte, enlacées parfois, mais non mêlées, et que l’être moral de chacun de nous reste éternellement seul par la vie »). Une telle réciprocité va être renforcée par l’apparition du pronom « ils » qui va remplacer le « il » et le « elle » qui les représentaient comme étant séparés, deux personnes distinctes ; les deux amoureux vont être sujets des mêmes verbes : ils sont ensemble, unis dans les mêmes actes et les mêmes sentiments, et le pluriel revient en début de phrase de façon anaphorique (« Ils se promèneraient […] Ils iraient, les mains dans les mains, […] tellement unis qu’ils pénétreraient aisément, par la seule puissance de leur tendresse »). De même, l’expression « l’un contre l’autre » et l’emploi de l’adjectif possessif « leur » dans chaque proposition mettent en valeur cette réciprocité que Jeanne imagine parfaite. C’est un amour tellement fusionnel que, totalement transparents l’un pour l’autre, ils pourront lire chacun dans la pensée de l’autre. Le passage s’achève sur l’idée d’un amour éternel et paisible, avec l’emploi de l’adverbe « indéfiniment » et de l’adjectif « indescriptible ». La phrase au discours indirect libre forme à elle seule un paragraphe très court et est ainsi mise en valeur : « Et cela continuerait indéfiniment, dans la sérénité d’une affection indestructible. » Jeanne s’attarde sur cette dernière pensée qui ressemble à une conclusion.
Une vie – 11
L’espace qui suit cette phrase donne une impression de continuité, laissant la rêverie de Jeanne s’attarder sur cette éternité. ao Dans le dernier paragraphe, Jeanne passe, dans son imaginaire, à une autre étape. Le rythme s’accélère avec l’apparition d’adverbes comme « soudain » et « brusquement ». On retrouve à deux reprises le « et » de conséquence déjà noté au paragraphe 7 : « Et il lui sembla soudain qu’elle le sentait là, contre elle ; et brusquement ». Jeanne s’est tellement abandonnée à sa rêverie qu’elle va jusqu’à sentir auprès d’elle et même « contre elle » la présence de l’être aimé. Son corps, dont le narrateur évoque certaines parties (sa poitrine, ses lèvres), est en émoi : « Elle serra ses bras contre sa poitrine […] et sur sa lèvre tendue vers l’inconnu quelque chose passa. » Jeanne se pâme, révélant une sensualité qui ne demande qu’à s’épanouir, trouver son objet : « un vague frisson de sensualité lui courut des pieds à la tête […] qui la fit presque défaillir, comme si l’haleine du printemps lui eût donné un baiser d’amour ». ap En ce début de roman, ce passage révèle déjà les aspects essentiels du tempérament de Jeanne et annonce sa future désillusion. Jeanne est très jeune et très naïve. Elle sort du couvent avec un seul rêve : rencontrer l’amour. À l’image de tant d’héroïnes tragiques et romanesques, fidèle au « amabam amare » de saint Augustin, elle aime aimer. Cet amour de l’amour se cristallisera sur le premier venu, dans la mesure où il entrera dans les critères sociaux de sa classe et fera assez illusion pour ressembler au séduisant Prince Charmant attendu. En outre, elle fait preuve, dans ce passage, d’une extrême sensibilité et d’une aptitude innée à s’abandonner à un mélange de sensualité et d’imagination débordante. Le lecteur a déjà l’impression qu’elle n’analyse pas ce qu’elle ressent, préférant se laisser emporter par les rêves les plus aptes à idéaliser le monde et l’amour. Le contact avec une réalité difficile et décevante la brisera sans la faire évoluer.
◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 28 à 35)
Examen des textes et de l’image u Stendhal est connu pour son ironie bienveillante à l’égard de ses personnages. Leur naïveté n’est pas due à leur médiocrité mais, au contraire, à des aspirations trop grandes et décalées par rapport au monde dans lequel ils vivent. C’est le cas de Mathilde qui fait preuve d’un mélange étonnant d’orgueil et de naïveté. Elle a une haute idée d’elle-même et l’on retrouve chez elle cette « exaltation aristocratique du moi » que Malraux attribue aux personnages libertins des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Le narrateur le montre avec un mélange de moquerie et de tendresse amusée : « À mon âge, une fille jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des sensations […] ? » ; « Le ciel me devait cette faveur. Il n’aura pas en vain accumulé sur un seul être tous les avantages. Mon bonheur sera digne de moi. Chacune de mes journées ne ressemblera pas froidement à celle de la veille. Il y a déjà de la grandeur et de l’audace à oser aimer un homme placé si loin de moi par sa position sociale. Voyons : continuera-t-il à me mériter ? ». Ainsi il utilise tout un champ lexical évoquant l’héroïsme, les exploits, la grandeur d’âme : « sentiment héroïque » ; « Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles ; mais, bien loin de là, faisait faire de grandes choses » ; « Je me sens au niveau de tout ce qu’il y a de plus hardi et de plus grand ». Il glisse quelques expressions qui révèlent son ironie : « Il n’était question, bien entendu, que de la grande passion ; l’amour léger était indigne d’une fille de son âge et de sa naissance. » v Dans tous ces textes, les jeunes filles connaissent à peine le jeune homme auquel elles pensent. Certaines même, comme Jeanne, ne le connaissent pas mais l’imaginent. Dans Une vie, Jeanne est dans l’imaginaire (cf. questions 13 et 14). Mathilde rêve, elle aussi, de « la grande passion » (« Elle ne donnait le nom d’amour qu’à ce sentiment héroïque »). C’est un amour qui pousse à accomplir de grands exploits : « Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles ; mais, bien loin de là, faisait faire de grandes choses » ; « Oui, c’est l’amour avec tous ses miracles qui va régner dans mon cœur ; je le sens au feu qui m’anime ». Elle cristallise ses rêves sur Julien : celui-ci étant sans nom ni fortune, elle se le représente comme différent des autres jeunes gens qu’elle connaît. Cosette est plus humble que Mathilde. Le narrateur insiste sur son ignorance en utilisant dans une interrogative indirecte le pronom indéfini « ce que », faisant de l’amour « une chose étrange, inconnue » : « Cosette ne savait pas ce que c’était que l’amour. » L’amour n’est pour elle qu’un mot : « Elle n’avait jamais entendu prononcer ce mot dans le sens terrestre. » Dans une proposition comparative, il crée un parallèle entre ignorance et passion : « Elle aimait avec d’autant plus de passion qu’elle aimait avec ignorance. »
Réponses aux questions – 12
L’ignorance étant un facteur d’idéalisation, elle transforme l’amour en passion. De plus, il utilise le verbe aimer sans objet, ce qui montre qu’elle aime davantage l’amour que Marius qu’elle connaît à peine et sur qui se cristallisent tous ses rêves. On retrouve là le célèbre « amabam amare » de saint Augustin (« Elle aimait »). Ainsi, elle idéalise Marius : « Il se trouva que l’amour qui se présenta était précisément celui qui convenait le mieux à l’état de son âme. » V. Hugo utilise toute une succession de termes en gradation pour montrer que toute sa vision de l’amour est onirique et doit le rester, sous peine de l’effrayer : « Toute rencontre plus palpable et plus proche eût à cette première époque effarouché Cosette » ; « C’était une sorte d’adoration à distance, une contemplation muette, la déification d’un inconnu ». De même, les expressions qui désignent Marius appartiennent au domaine du flou, du fantasmatique : il est évanescent, désincarné (c’est « l’amant lointain et demeuré dans l’idéal, une chimère ayant une forme » ; « le fantôme souhaité enfin réalisé et fait chair » ; « Elle se mit à adorer Marius comme quelque chose de charmant, de lumineux et d’impossible » ; « c’était une vision ») ; il est parfait et pur (« n’ayant pas encore de nom, ni de tort, ni de tache, ni d’exigence, ni de défaut »). Natacha n’est pas plus réaliste : « Natacha s’était envolée dans le monde heureux des songes, où tout était aussi beau, aussi facile que dans la vie réelle, mais bien plus attrayant, car ce n’était pas la même chose. » Elle va jusqu’à entendre les propos que celui qu’elle aimera prononcera à son sujet : il est en effet un « tiers créé par son imagination » et « cet aimable inconnu » se pare de toutes les qualités (« et qui devait être le phénix des hommes, un esprit supérieur ! »). w Si l’on prend l’adjectif romantique au sens originel, la plus romantique des jeunes filles est sans doute Mathilde, parce que sa conception de l’amour est manifestement d’origine littéraire ; certes, il est évident que c’est aussi le cas de Jeanne et de Cosette qui ont passé plusieurs années au couvent. Mais le texte de Stendhal est plus explicite et fait référence à des romans qui sont aussi une référence au sujet de la passion : « Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu’elle avait lues dans Manon Lescaut, la Nouvelle Héloïse, les Lettres d’une Religieuse portugaise. » De plus, l’abbé Prévost et J.-J. Rousseau sont des préromantiques et leurs deux romans sont des références pour la génération romantique qui est leur héritière. Toutes ces jeunes filles se réfugient dans l’imaginaire et préfèrent le rêve à la réalité, refusant le monde tel qu’il est. Leur conception de l’amour (cf. question 2) est à la fois héroïque, passionnée et idéaliste. C’est un amour qui transcenderait, élèverait leur existence. Typiquement romantique, Mathilde croit que Julien va pouvoir accomplir des exploits comme au temps des rois, un temps exalté et embelli par la nostalgie, bien loin de l’époque si décevante et si terne de la Restauration : « Elle ne donnait le nom d’amour qu’à ce sentiment héroïque que l’on rencontrait en France du temps de Henri III » ; « Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles ; mais, bien loin de là, faisait faire de grandes choses. Quel malheur pour moi qu’il n’y ait pas une Cour véritable comme celle de Catherine de Médicis […]. Je me sens au niveau de tout ce qu’il y a de plus hardi et de plus grand. Que ne ferais-je pas d’un roi homme de cœur, comme Louis XIII soupirant à mes pieds ! Je le mènerais en Vendée ». Ces jeunes filles sont pétries de rêves : « Natacha s’était envolée dans le monde heureux des songes, où tout était aussi beau, aussi facile que dans la vie réelle, mais bien plus attrayant, car ce n’était pas la même chose. » Extrêmement sensibles, elles font preuve d’un tempérament excessif et exalté, comme nous venons de le voir pour Mathilde et, plus haut, pour Jeanne (questions 8 sqq). Cosette « aimait avec d’autant plus de passion qu’elle aimait avec ignorance. […] Il se trouva que l’amour qui se présenta était précisément celui qui convenait le mieux à l’état de son âme. C’était une sorte d’adoration à distance, une contemplation muette, la déification d’un inconnu. […] Elle se mit à adorer Marius. » Natacha, elle aussi, se laisse emporter par son exaltation : « Et Natacha fredonna aussitôt quelques mesures de son passage favori de la messe de Cherubini, puis, se jetant joyeuse et souriante sur son lit ». Comme Jeanne, elle est trop excitée pour dormir : « Elle fut longtemps à s’endormir : elle pensait à mille choses à la fois ». Dans son monologue intérieur, elle passe vivement d’une idée à l’autre : « Oh ! pas du tout ! Elle est si vertueuse ; elle aime Nicolas, tout le reste lui est indifférent. Maman non plus ! » La communion avec la nature, telle que Jeanne la vit, est inséparable du tempérament romantique (cf. les réponses aux questions de la lecture analytique). Caspar David Friedrich est considéré comme le chef de file de la peinture allemande romantique. La jeune femme représentée ici de dos semble rêver à un ailleurs plus libre et plus ouvert que le lieu dans lequel elle se trouve : le motif de la rêverie solitaire et de la contemplation à la fois intérieure et extérieure est un topos de la peinture romantique (cf. l’analyse du tableau à la question 5). x Toutes les héroïnes de ce corpus sont très jeunes et naïves, ce qui est déjà manifeste dans leur conception idéalisée, romantique et exaltée de l’amour (cf. questions précédentes 2 et 3). La vie n’a
Une vie – 13
pas encore eu le temps de briser leur enthousiasme. Le ton est exalté, rien n’est nuancé, tout est hyperbolique. Jeanne se laisse emporter par sa rêverie (cf. questions 8 sqq), comme Mathilde qui rêve d’un avenir exalté et du « grand amour », à la mesure de l’image qu’elle a d’elle-même : « L’amour léger était indigne d’une fille de son âge et de sa naissance » (le discours indirect libre reproduisant la pensée du personnage). L’extrait B est ponctué d’un grand nombre de points d’exclamation et d’interrogation. Les phrases en asyndète montrent que Mathilde passe d’une idée à l’autre rapidement et sans lien, obéissant à une logique tout intérieure. De même, cette tendresse ironique et amusée des narrateurs à l’égard de leur personnage est en partie due à l’extrême jeunesse de leurs héroïnes. On retrouve cette ironie bienveillante (déjà analysée pour Stendhal dans la question 1) dans l’extrait de Tolstoï : Natacha, elle aussi, se persuade qu’elle est belle et séduisante, allant jusqu’à imaginer les paroles qu’on pourrait prononcer à son sujet ; et l’on retrouve le même ton, la même ponctuation : « “[…] Je suis très intelligente, et comme… elle est jolie !” ajoutait-elle en mettant cette réflexion à son adresse dans la bouche d’un tiers créé par son imagination […]. “Elle a tout, tout pour elle, disait cet aimable inconnu, jolie, charmante, adroite comme une fée ; elle nage, elle monte à cheval dans la perfection, et quelle voix, une voix surprenante !…” ». Natacha est tellement jeune qu’elle se croit incomprise comme tous les adolescents : « elle en arrivait toujours à conclure que personne ne pouvait deviner, ni tout ce qu’elle comprenait, ni tout ce qu’elle valait. “Et Sonia me comprend-elle ?” ». Jeanne et Cosette sortent tout juste du couvent où elles ont reçu une éducation qui ne les prépare ni au réel ni à l’existence, l’extrême jeunesse de Cosette étant soulignée par l’emploi de l’adverbe d’intensité « trop » devant l’adjectif « jeune » : « Mais Cosette était sortie encore trop jeune pour s’être beaucoup préoccupée du “tambour”. » Cosette non seulement ignore tout de la vie et de l’amour (cf. la question 2 évoquant son ignorance) mais encore ne se connaît pas elle-même : « La première chose que Cosette éprouva, ce fut une tristesse confuse et profonde. Il lui sembla que, du jour au lendemain, son âme était devenue noire. Elle ne la reconnaissait plus. » Dans Les Misérables, le narrateur insiste aussi sur ce mélange de jeunesse et de naïveté, en utilisant le présent de vérité générale et le terme générique de jeune fille au pluriel : « La blancheur de l’âme des jeunes filles, qui se compose de froideur et de gaieté, ressemble à la neige. Elle fond à l’amour qui est son soleil. » En comparant son âme à la neige dont il évoque la blancheur et la fragilité, le narrateur souligne le fait que Cosette est avant tout une jeune fille naïve, innocente et pure. Et il évoque à plusieurs reprises l’ignorance de Cosette au sujet de l’amour et de la vie (cf. question 2). Il décrit son amour pour Marius comme la rencontre de « l’adolescence avec l’adolescence ». Cosette est décrite comme une enfant que tout effraie : on retrouve la même hyperbole que dans la phrase déjà évoquée plus haut : « Elle avait toutes les peurs des enfants et toutes les peurs des religieuses » et dans : « Toute rencontre plus palpable et plus proche eût à cette première époque effarouché Cosette ». y Il s’agit d’un tableau du célèbre peintre romantique allemand Caspar David Friedrich (1774-1840), représentant une jeune femme de dos à une fenêtre. Il est fréquent que les peintres choisissent ces deux motifs, soit séparément, soit ensemble, la fenêtre étant une ouverture lumineuse sur l’extérieur, capable de donner au tableau une autre dimension et un autre éclairage. Ainsi, la scène représentée ne se limite pas à elle-même, mais s’ouvre sur un autre monde. Dans un grand nombre de toiles de Friedrich, la silhouette peinte est de dos, ce qui lui permet de mettre en valeur le point de vue du personnage. Le spectateur est ainsi en focalisation interne. Le personnage alors sans visage en devient plus mystérieux. Ce qui semble important est davantage ce qu’il voit et la manière dont il le voit que le reste de sa personnalité. On peut cependant déceler beaucoup d’éléments de la vie d’une personne et de sa personnalité dans une silhouette vue de dos. Ici, la silhouette est fine, élancée et élégante ; les vêtements et la coiffure sont assez soignés pour que l’on puisse penser que le personnage appartient à la bourgeoisie ou à l’aristocratie. Il s’agit sans doute de l’épouse du peintre. Le corps de la jeune femme est légèrement penché en avant, ce qui suggère une attention particulière portée au paysage qui se trouve devant elle. Elle est au centre du tableau et ainsi mise en valeur. La pièce dans laquelle elle se trouve est sombre, austère, très dépouillée. Les volets sont en bois et seule une partie en est ouverte. Le cadrage symétrique et l’omniprésence de la ligne (aussi bien sur les murs qu’au sol) créent un monde rigoureux, sans fantaisie, sans échappée possible. L’ouverture sur l’extérieur est elle aussi maîtrisée. Tous ces éléments mettent en valeur la luminosité du paysage extérieur. On distingue des peupliers, un ciel clair et vaste, le mât d’un bateau. La forme de la pièce, la fenêtre, la silhouette, les peupliers et le mât créent une impression de verticalité, un mélange de raideur et d’élévation. Le ciel étant vaste et occupant toute la partie haute de la fenêtre au-dessus du volet permet au regard de s’y perdre, d’aller des peupliers vers le mât, du mât vers lui, suggérant ainsi l’infini. On peut imaginer que
Réponses aux questions – 14
la jeune femme, solitaire, médite devant un tel paysage, s’ennuie dans cette pièce où tout est si sévère, rêve de s’échapper. Ce tableau permet donc une contemplation à la fois extérieure et intérieure.
Travaux d’écriture
Question préliminaire Les auteurs utilisent différents procédés pour faire entrer le lecteur dans la pensée du personnage : – Maupassant, dans Une vie, utilise presque exclusivement la focalisation interne (cf. les réponses aux questions de la lecture analytique). Le spectateur du tableau de Friedrich est lui aussi en focalisation interne (cf. question 5). Mais les trois autres auteurs utilisent le point de vue omniscient : nous savons tout de ce que pense, imagine et ressent Mathilde (« Une idée l’illumina tout à coup […]. Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu’elle avait lues ») ; de la même façon, nous savons tout de Cosette, son passé comme son présent (« La première chose que Cosette éprouva, ce fut une tristesse confuse et profonde. […] Cosette ne savait pas ce que c’était que l’amour. Elle n’avait jamais entendu prononcer ce mot dans le sens terrestre ») ; Tolstoï utilise à son tour le même procédé (« Elle fut longtemps à s’endormir : elle pensait à mille choses à la fois »). – Variant aussi les procédés, Stendhal et Tolstoï nous présentent les pensées de leurs héroïnes de façon très directe et vivante par le biais du discours direct et du monologue intérieur. Mathilde, ainsi, nous livre ses pensées, pense tout haut : « J’ai le bonheur d’aimer, se dit-elle un jour, avec un transport de joie incroyable. J’aime, j’aime […] ; enfin, ils m’ennuient. » Et Natacha agit de même : « Et Sonia me comprend-elle ? […] Oh ! pas du tout ! […] Maman non plus ! C’est vraiment étonnant ! » De même, nous avons déjà analysé l’emploi du discours indirect libre dans le texte de Maupassant (question 12). Nous le trouvons aussi dans celui de Stendhal : « Il n’était question, bien entendu, que de la grande passion ; l’amour léger était indigne d’une fille de son âge et de sa naissance. Elle ne donnait le nom d’amour […]. Il se ferait un nom, il acquerrait de la fortune. » – Plus original encore apparaît un autre procédé, qui consiste à introduire le discours d’un tiers : dans Les Misérables, le narrateur imagine l’étonnement de Cosette en entendant certaines remarques (« On l’eût bien étonnée si on lui eût dit : “Vous ne dormez pas ? mais c’est défendu ! Vous ne mangez pas ? mais c’est fort mal ! Vous avez des oppressions et des battements de cœur ? mais cela ne se fait pas ! Vous rougissez et vous pâlissez quand un certain être vêtu de noir paraît au bout d’une certaine allée verte ? mais c’est abominable !” Elle n’eût pas compris, et elle eût répondu : “Comment peut-il y avoir de ma faute dans une chose où je ne puis rien et où je ne sais rien ?” »). Ce procédé lui permet d’introduire à la fois la naïveté de Cosette et son trouble amoureux. Natacha, quant à elle, à la fois candide et fière de son image, va jusqu’à imaginer elle-même ce qu’un jeune homme pourrait dire d’elle : « “[…] elle est jolie !” ajoutait-elle en mettant cette réflexion à son adresse dans la bouche d’un tiers créé par son imagination et qui devait être le phénix des hommes, un esprit supérieur ! “Elle a tout, tout pour elle, disait cet aimable inconnu, jolie, charmante, adroite comme une fée ; elle nage, elle monte à cheval dans la perfection […]…” » – Il existe encore des moyens plus détournés, comme c’est le cas du « paysage état d’âme » (cf. questions 7 à 11). – Le peintre présentant son personnage de dos ne nous montre pas explicitement ses pensées, mais (cf. question 5) ce procédé permet au spectateur de saisir de nombreux éléments. Nous avons donc ici une grande variété de procédés qui révèle l’habileté des écrivains, capables de rendre des scènes, pourtant traditionnelles, très originales.
Commentaire
Introduction Cosette est l’un des personnages principaux de ce vaste roman épique. Se tenant au centre de la vie d’autres personnages comme Jean Valjean, Fantine et Marius, elle occupe une place importante dans l’intrigue. Au fur et à mesure qu’elle grandira, elle représentera différents symboles et correspondra à différentes étapes de la vie de Jean Valjean, de son ascension morale et sociale. Elle sera d’abord la personnification de l’enfance misérable et maltraitée. Sauvée de la misère par Jean Valjean, elle deviendra l’amour de sa vie. Le lecteur voit la petite fille souffreteuse et craintive s’épanouir et devenir une belle jeune fille, confiante en l’avenir, pleine d’espoirs et de rêves. Elle a donc cessé de représenter l’enfance malheureuse pour incarner la jeune fille romantique qui rêve de rencontrer le jeune homme idéal. C’est cet aspect romanesque et rêveur que le narrateur souligne dans cet extrait.
Une vie – 15
1. Une jeune fille naïve et ignorante A. Une éducation carencée • Cosette vient de passer cinq ans au couvent où elle a reçu une éducation qui l’a maintenue dans une totale ignorance des réalités de l’existence. Hugo ne cache pas à quel point il juge sévèrement une telle éducation : « L’esprit du couvent, dont elle s’était pénétrée pendant cinq ans, s’évaporait encore lentement de toute sa personne et faisait tout trembler autour d’elle. » Le verbe pénétrer souligne à quel point une telle éducation peut marquer. Il s’agit d’un « esprit » et donc d’une façon de penser, sans doute très influente. Il explique avec beaucoup d’humour les substituts utilisés alors à la place du mot amour : « Sur les livres de musique profane qui entraient dans le couvent, amour était remplacé par tambour ou pandour. Cela faisait des énigmes qui exerçaient l’imagination des grandes comme : Ah ! que le tambour est agréable ! ou : La pitié n’est pas un pandour ! Mais Cosette était sortie encore trop jeune pour s’être beaucoup préoccupée du “tambour” ». Il évoque le couvent de façon métaphorique avec l’expression « brume grossissante du cloître » dans laquelle Cosette se trouve « encore à demi plongée ». Cette éducation rend craintif et Cosette est victime à la fois de ses propres peurs et de celles des religieuses qui l’ont élevée, comme le montre cette phrase hyperbolique (avec la répétition de l’adjectif indéfini « toutes ») construite sur des parallélismes syntaxiques : « Elle avait toutes les peurs des enfants et toutes les peurs des religieuses mêlées. » • Le résultat d’une telle éducation est une méconnaissance du monde et de soi : à plusieurs reprises, le narrateur insiste sur son ignorance en utilisant de nombreuses fois le verbe savoir ou un synonyme (« Cosette ne savait pas », « Elle n’avait jamais entendu », « Elle n’eût donc su quel nom donner à ce qu’elle éprouvait maintenant », « Elle ne savait pas », « où je ne sais rien », « elle aimait avec ignorance »). • Cosette ne se connaît pas elle-même et ne comprend rien à ce qui lui arrive : « La première chose que Cosette éprouva, ce fut une tristesse confuse et profonde. Il lui sembla que, du jour au lendemain, son âme était devenue noire. Elle ne la reconnaissait plus. » L’adjectif « confuse » et le verbe sembler soulignent le fait que Cosette est dans le flou, l’inconnu, l’incertitude. B. Une jeune fille naïve et pure • Le narrateur a ici choisi le point de vue omniscient pour faire découvrir au lecteur ce que ressent Cosette. Nous savons tout d’elle et lisons dans ses pensées les plus intimes, comme le montre la première phrase : « La première chose que Cosette éprouva, ce fut une tristesse confuse et profonde […]. » Il est lui-même attendri par son propre personnage qui représente la jeunesse, l’innocence. Cosette ne comprend rien à ce qui lui arrive, comme nous le verrons par la suite en analysant la façon dont le narrateur évoque sa découverte du sentiment amoureux. • Cosette représente en effet la très jeune fille candide et enthousiaste, incapable d’instaurer une distance entre elle et ce qui lui arrive ou d’y réfléchir. • Le narrateur insiste sur l’extrême jeunesse de Cosette (cf. question 4). Il évoque à plusieurs reprises son ignorance au sujet de l’amour et de la vie (cf. question 2). Il décrit son amour pour Marius comme un amour adolescent (cf. question 4). Tout effraie Cosette (cf. question 4). Ainsi, elle idéalise Marius (cf. question 2). Comme la plupart des jeunes filles romantiques, Cosette possède quelque chose d’angélique tant elle incarne la fraîcheur et la naïveté. L’amour la transporte, la métamorphose : elle n’est plus une jeune fille mais une amoureuse.
2. La découverte de l’amour A. Le trouble amoureux • Cosette ressent tous les signes habituels du trouble amoureux mais sans les comprendre. Le narrateur introduit ce trouble de manière très originale en imaginant des questions que pourrait lui poser un tiers fictif : il crée ainsi un dialogue imaginaire avec des questions et des réponses qu’il introduit par un conditionnel passé deuxième forme (nous sommes dans l’irréel du passé : « On l’eût bien étonnée si on lui eût dit : “Vous ne dormez pas ? mais c’est défendu ! […]” et elle eût répondu : “[…] je ne sais rien ?” »). Par ce procédé rapide et vivant, le lecteur comprend que Cosette est non seulement amoureuse mais troublée, puisqu’elle a perdu le sommeil, l’appétit… et manifeste des troubles, comme le fait d’avoir de la tachycardie, de rougir, de pâlir… • L’amour est présenté par Hugo comme un danger sous forme de formules antithétiques, dont il est friand, et dans une suite d’énumérations ; dangers que Cosette, dans sa candeur, ignore : « Elle ne savait pas si cela est bon ou mauvais, utile ou dangereux, nécessaire ou mortel, éternel ou passager, permis ou prohibé ». Dans Les Misérables, l’amour peut transcender les êtres, mais il peut aussi les détruire, comme
Réponses aux questions – 16
c’est le cas de la mère de Cosette, Fantine, qui a été perdue par un étudiant qui l’a abandonnée. L’amour de Cosette et de Marius, en revanche, les rendra heureux mais il transformera Cosette, la rendant plus secrète et plus complexe : elle cachera sa passion à Jean Valjean et s’éloignera de lui au point de le délaisser, ce qui le rendra extrêmement malheureux. • Cet amour la rend soudain (« du jour au lendemain ») triste et méconnaissable : « La première chose que Cosette éprouva, ce fut une tristesse confuse et profonde. » Hugo joue sur les oppositions traditionnelles entre noir et blanc : « Il lui sembla que, du jour au lendemain, son âme était devenue noire […]. La blancheur de l’âme des jeunes filles ». B. Un amour passionné • L’amour a envahi le cœur de Cosette. Cet extrait des Misérables est à la fois un portrait de la jeune fille innocente et romantique et une description de la découverte de l’amour et de son trouble. Le champ lexical de l’amour est par conséquent très abondant dans ce passage. Le mot « amour » et le verbe aimer apparaissent trois fois ; on trouve aussi le terme d’« amant » et des expressions dont le sens est plus fort comme le verbe adorer et le mot « adoration ». • Comme nous l’avons analysé dans la question 2, le verbe aimer est sans objet. La phrase métaphorique « Elle fond à l’amour qui est son soleil », qui décrit ce qui arrive à l’âme des jeunes filles, souligne à quel point l’amour, représenté par le soleil, est attendu et rêvé. • Il s’agit d’un amour passionné (cf., plus haut, son trouble), le narrateur ayant fait un lien de corrélation entre sa passion et son ignorance (cf. question 2). • Comme tout amour passionné, il est excessif (cf. question 3) : Cosette « aimait avec d’autant plus de passion […]. C’était une sorte d’adoration à distance, une contemplation muette, la déification d’un inconnu. […] Elle se mit à adorer Marius ». Elle se laisse emporter par son exaltation en des termes évoquant l’excès : « passion », « adoration à distance », « déification ». C. Un amant désincarné • Cf. question 2. Ainsi, elle idéalise Marius : « Il se trouva que l’amour qui se présenta était précisément celui qui convenait le mieux à l’état de son âme. » Cosette ne tombe pas amoureuse de Marius mais d’une illusion : il correspond parfaitement à l’image qu’elle s’est construite, comme le montre le superlatif « le mieux ». Hugo utilise toute une succession de termes en gradation pour montrer que toute sa vision de l’amour est onirique et doit le rester, sous peine de l’effrayer : refus du réel exprimé par l’emploi de l’irréel du passé – conditionnel passé deuxième forme (« Toute rencontre plus palpable et plus proche eût à cette première époque effarouché Cosette »). • Cosette, qui représente à la fois la très jeune fille à peine sortie de l’enfance et la jeune fille romantique, fuit donc le réel : son amour est décrit comme « le rêve des nuits devenu roman et resté rêve ». La répétition du mot « rêve » souligne l’absence d’évolution : il n’y a pas passage du rêve au réel ; au contraire, le rêve « reste » rêve : il était nocturne et est devenu diurne ; Cosette ne s’est pas réveillée de son rêve mais l’a prolongé : ce qu’elle veut vivre n’est pas réel mais fictif ; elle est romanesque au sens propre du terme : elle désire vivre un rêve, un roman. À cette phrase répond cette autre phrase, à la fin du paragraphe : « Dans cette situation, ce n’était pas un amant qu’il lui fallait, ce n’était pas même un amoureux, c’était une vision. » L’amant mis en valeur par la forme emphatique, reprise trois fois, correspond exactement à ce rêve « resté rêve » ; la gradation décroissante (les propositions sont de plus en plus courtes) et les négations mettent en valeur le mot « vision » qui définit l’aspect totalement onirique et irréel de Marius. • Cette préférence, ce processus du rêve sont mis en valeur par une accumulation d’expressions qui se complètent, dans des phrases construites de façon très rhétorique, au moyen d’une syntaxe énumérative au rythme ternaire : composées de la même façon, elles commencent par deux termes précédés d’un article indéfini qui sont résumés par un dernier terme, précédé de l’article défini. Le lecteur se laisse prendre par une telle régularité, une telle emphase et un tel lyrisme ; ce qu’elle ressent est exprimé ainsi : « C’était une sorte d’adoration à distance, une contemplation muette, la déification d’un inconnu » (le narrateur insiste sur le fait qu’elle ne connaît pas Marius, ce qui facilite le processus d’idéalisation). Il y a un grand nombre d’articles et de pronoms indéfinis (« un », « une », « quelque chose »). Comme Cosette a élevé Marius au rang d’un dieu, il est totalement désincarné, lointain, intouchable, comme un personnage entrevu dans un rêve. Les expressions qui le désignent appartiennent toutes au domaine du flou (cf. question 2). Les participes passés décrivent une action qui a eu lieu et dont on vérifie le résultat, la façon dont Cosette, dans son imaginaire, a créé Marius : il est
Une vie – 17
donc un pur produit de son imaginaire (« l’amant lointain et demeuré dans l’idéal », « le fantôme souhaité enfin réalisé et fait chair »). • Il est donc facile de vivre avec cet inconnu (dénué « d’exigence ») qui vient de naître (« n’ayant pas encore de nom ») et qui est nécessairement parfait et pur : « mais n’ayant pas encore de nom, ni de tort, ni de tache, ni d’exigence, ni de défaut » (cf. question 2).
Conclusion Victor Hugo nous offre ici une peinture touchante à la fois de la jeune fille romanesque et de l’amour naissant. Telle qu’elle est décrite, Cosette ne peut aimer autrement et l’amour qu’elle éprouve lui ressemble. Ce texte, typiquement romantique, et par son écriture et par le choix des thèmes, n’est pas seulement descriptif : il introduit un tournant dans l’intrigue du roman.
Dissertation
Introduction La quête du bonheur est sans doute une des quêtes essentielles de l’homme. Non seulement il voudrait être heureux, mais encore il se pose sans cesse des questions à ce sujet. Il cherche à savoir ce qu’est le bonheur, s’il peut le trouver et par quels moyens. Le roman, en représentant l’homme dans ses désirs les plus profonds, pose nécessairement la question du bonheur. Nous verrons quelle forme prend cette quête dans le roman.
1. La place du bonheur dans la littérature A. Une place essentielle • Tous les genres littéraires depuis l’Antiquité évoquent le bonheur : le théâtre, la poésie, le conte, etc. : – Tout au long de Roméo et Juliette, par exemple, les deux héros cherchent le bonheur dans l’amour. L’échec de cette quête met en valeur la vision du monde de Shakespeare, comme le montrent les scènes de conflit, la scène de l’apothicaire (quand Roméo va acheter du poison) et la dernière scène (discours du Prince devant les cercueils). Shakespeare décrit un monde corrompu et divisé par des haines absurdes, monde dans lequel un amour aussi pur et parfait n’a pas sa place. À cela s’ajoute sans doute la fatalité : Roméo pense être né sous une mauvaise étoile. – On peut aussi prendre l’exemple de la dernière phrase de la pièce Œdipe roi de Sophocle, dont le sujet essentiel, pourtant, pourrait sembler être autre que le bonheur : « C’est donc ce dernier jour qu’il faut, pour un mortel, toujours considérer. Gardons-nous d’appeler jamais un homme heureux, avant qu’il n’ait franchi le terme de sa vie sans avoir subi un chagrin. » – Dans un autre genre littéraire plus proche du roman, comme le conte philosophique, Candide, héros éponyme du conte de Voltaire, a pour quête la recherche du bonheur. • Mais le sujet porte spécifiquement sur le roman : or, si le bonheur occupe une place essentielle dans la vie des hommes et dans la littérature en général, il en va de même dans le roman qui semble le genre littéraire le plus proche de la vie. B. Le roman : le genre littéraire le plus approprié pour évoquer cette question • Le roman est un genre littéraire très vaste et complexe et sans doute le plus proche de la vie (genre protéiforme, où l’écrivain dispose d’une grande liberté) ; il est difficile à définir, d’autant plus qu’il a beaucoup évolué au cours du temps. • Le roman est un « récit fictif en prose s’étendant sur une certaine durée […] qui raconte une histoire (qui se développe dans le temps) fictive (mais entretenant un certain rapport avec la réalité par opposition au conte ou au mythe) » (définition du roman dans La Littérature de A à Z aux éditions Hatier). Et le Littré le définit ainsi : « Histoire feinte, écrite en prose, où l’auteur cherche à exciter l’intérêt par la peinture des passions, des mœurs, ou par la singularité des aventures. » • Le romancier recrée un univers à part entière : en cela, le roman est le genre littéraire le plus proche du réel et le plus apte à transporter le lecteur dans son univers. Une telle conception implique des thèmes, des sujets de réflexion, des questions qui peuvent toucher ou intéresser le lecteur. Il n’est donc pas étonnant que le bonheur y occupe une place essentielle et que ce genre littéraire soit particulièrement apte à donner une vision de l’homme et du monde, que ce soit à travers le bonheur ou d’autres thèmes.
Réponses aux questions – 18
• Les questions que se posent les personnages rappellent celles des lecteurs, et en cela aussi le roman rejoint la vie. • Le fait que le roman ait une certaine durée va permettre au romancier de raconter la vie ou une partie de la vie des personnages, au travers d’événements abordant les questions essentielles de l’existence (dont la question du bonheur). Ainsi, Une vie raconte une partie de la vie de Jeanne de l’âge de 17 ans à celui de 40 ans… Il en est de même pour Madame Bovary qui suit le personnage éponyme jusqu’à sa mort. Dans les romans dont sont extraits les textes du corpus, les personnages sont au centre et l’auteur s’attache à rendre leur existence la plus vraisemblable possible : héros ou anti-héros, hommes extraordinaires ou banals, ces hommes ressemblent au lecteur et vivent comme lui. Le roman est donc le genre littéraire qui tente de reproduire la vie, de recréer des êtres avec des sentiments ou des préoccupations humaines essentielles. • Le roman a ainsi pour fin d’être vraisemblable : il imite la réalité, s’inscrit en elle, tente de faire croire à la réalité de ce qui est raconté. Les textes du corpus mettent en scène des jeunes filles qui rêvent de rencontrer l’amour qui les rendrait heureuses. Par des moyens différents (de focalisation ou de discours) selon les auteurs (cf. questions déjà traitées), le lecteur peut se représenter les scènes, y croire, lire dans la pensée de ces jeunes filles en quête d’amour et de bonheur. Encore très jeunes, romanesques et enthousiastes, elles croient pouvoir y parvenir. • Dans la mesure où le roman met en scène des personnages essayant de vivre et de trouver un sens face au mal, au malheur, à la misère, etc., il pose la question du bonheur. C. La place du bonheur dans le roman Toutes les œuvres romanesques (Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, Candide, La Peste) abordent cette question ; et si le bonheur n’est pas nécessairement le sujet du roman, il fait partie des questions essentielles, comme nous l’avons vu pour des œuvres appartenant à d’autres genres littéraires : – Dans Le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, Yvain est en quête d’aventures, comme tout chevalier de la Table ronde, pour acquérir la gloire et la renommée qui le rendront heureux. Plus tard, lorsqu’il perd Laudine, son épouse, il sombre dans la folie et le désespoir. Sa quête va changer. Derrière tous les exploits qu’il va accomplir, non plus pour sa propre gloire mais pour aider autrui, c’est Laudine qu’il cherche : en accomplissant en effet ces actes héroïques et altruistes, il manifeste son désir de vivre à nouveau le bonheur de mériter son amour – Dans La Princesse de Clèves, le personnage cherche à vivre en adéquation avec lui-même, par la pratique de la vertu, même si c’est au prix de sa passion avec le duc de Nemours. Là encore, le bonheur n’est pas le centre de l’histoire, mais la princesse de Clèves ne peut pas être heureuse si elle vit en contradiction avec les principes sur lesquels elle a fondé son existence (vivre en adéquation avec soi et son éthique). – Dans Les Liaisons dangereuses, Choderlos de Laclos pose les mêmes questions si l’on considère le personnage de Mme de Tourvel, d’autres questions si l’on considère les libertins. Chaque personnage est en quête du bonheur : les libertins cherchent le bonheur dans un monde sans Dieu, un bonheur lié au plaisir jusqu’à l’hédonisme, à la domination de l’autre et à la gloire. – Toutes les œuvres romanesques abordent cette question : dans Candide, dont la structure romanesque est proche de celle du roman picaresque, la question du bonheur est essentielle ; dans L’Assommoir, la quête de Gervaise est celle d’un bonheur simple ; dans La Peste de Camus, les personnages se posent la question de savoir comment on peut être heureux, d’un bonheur conscient et lucide qui n’oublie pas ; dans La Musique d’une vie, Andreï Makine présente au début les espoirs de son personnage principal, Alexeï, puis ses désillusions, ses errances, ses souffrances… – Enfin, dans les romans d’apprentissage, les héros, en faisant l’apprentissage de la vie, font aussi celui du bonheur (Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, Frédéric Moreau dans L’Éducation sentimentale).
2. La manière dont les romanciers traitent cette question est-elle révélatrice du regard qu’ils portent sur la société ? A. La quête du bonheur : une quête révélatrice • Il faut comprendre le mot « monde » (utilisé dans le sujet) au sens large du terme : la société, le monde, la vie, les hommes. Et donc se poser la question de savoir si la quête du bonheur dans le roman est un miroir de la société dans laquelle vit le romancier (époque, culture, valeurs…), du monde et des hommes en général.
Une vie – 19
• On constate, dans les exemples précédemment étudiés, que le romancier met parfois ses personnages en échec. Certains ne parviennent pas à être heureux. Pourquoi ? Qu’est-ce qui les en empêche ? Ainsi, il répond en quelque sorte à la question suivante : peut-on être heureux en ce monde ? comment ? et si le bonheur en ce monde est impossible, pourquoi ? La question du bonheur est donc, de toute évidence, une ouverture sur des questions plus vastes et souvent inséparables les unes des autres : dans quel monde vit l’homme qui cherche à être heureux ? quelles sont les entraves à son bonheur : lui-même ? les autres ? la société ? le mal ? la mort ? l’angoisse ? l’échec amoureux ? l’imperfection du monde ? quel bonheur idéal le romancier propose-t-il ? B. Quête du bonheur et critique de la société Le monde, les hommes, la société seraient-ils une entrave au bonheur ? – L’exemple du conte de Candide est significatif d’une critique globale de la société, des hommes et du monde. Les trois maux (social, métaphysique, moral) empêchent Candide de trouver le bonheur. Celui qu’il trouve est relatif et ne correspond pas au bonheur espéré au début… Ce n’est pas non plus celui que souhaite le lecteur pour lui-même… Il est un reflet de ce que pense Voltaire. Voltaire peint le monde, la société du XVIIIe siècle, comme un univers chaotique, bouleversé par les guerres, l’Inquisition… Il cherche à ouvrir les yeux du lecteur sur le monde afin de faire naître en lui le désir de le transformer, de l’améliorer. La morale du jardin, si elle n’est pas une morale du bonheur (trop modeste, trop « recroquevillée » pour cela), est néanmoins une morale du « bien vivre » ou du « vivre le mieux possible ». – Dans Les Lettres persanes, Montesquieu, autre philosophe des Lumières, offre une vision étonnante et très critique de la France de son temps. Pour que l’homme soit heureux, il faut qu’il progresse… C’est bien ce que propose Roxane à la fin du roman. Sa dernière lettre, qui est aussi la conclusion des Lettres persanes, est une revendication du bonheur suivant les principes universels de justice, de tolérance et de liberté. – Plus tard, au XIXe siècle, des auteurs engagés comme Hugo ou Zola ont peint et dénoncé toutes les formes de misère dans l’espoir de les voir un jour disparaître. En montrant l’échec de Gervaise, de Catherine Maheu, de Claude Gueux, de Fantine, etc., qui n’ont pas eu droit au bonheur, ils soulignent l’injustice et la cruauté de la société… Ils écrivent dans l’espoir que ceux qui les lisent voudront transformer le monde pour que des hommes qui vivent des situations similaires à celles de leurs personnages y soient plus heureux. Ils défendent dans leurs romans l’idée d’un « droit universel au bonheur ». C. Bonheur et éthique • Le romancier peut aussi mettre ses personnages en quête du bonheur devant des choix qui impliquent une conception du monde, de la vie… La quête du bonheur soulève aussi des questions d’ordre moral, éthique : – L’homme, en effet, peut chercher le bonheur par différents moyens : il peut donc le chercher en utilisant des moyens moralement répréhensibles ou contraires au bien, à la vertu. Y a-t-il, moralement, des bonnes et des mauvaises façons de parvenir au bonheur ? C’est la question qui est posée dans La Princesse de Clèves dont nous avons déjà évoqué le dilemme tragique. Mme de Tourvel se retrouvera devant les mêmes interrogations dans Les Liaisons dangereuses, lorsqu’elle tombera amoureuse du vicomte de Valmont, mais elle cédera à sa passion. – Plusieurs choix s’imposent à l’homme : il peut être heureux dans l’amour, en Dieu… en vivant en conformité avec ce qu’il est, pense… en adéquation avec lui-même… dans le travail ou le « bien agir », le « bien faire », le fait d’être utile… C’est la question que se posent les personnages de La Peste de Camus, la peste symbolisant le mal. – Mais il peut le chercher aussi de manière plus perverse : dans la jouissance, l’hédonisme, l’égoïsme, la domination, la gloire, comme le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. D’autres le chercheront dans les honneurs, l’acquisition de biens… Or, Choderlos de Laclos fait échouer tous ses personnages, ces deux derniers se détruisant en détruisant les autres. Son projet, au-delà de la réussite intellectuelle et littéraire que représente cet inégalable roman, était avant tout éthique. • Pourquoi des personnages vertueux ou bons ne parviennent-ils pas à être heureux ? – Certains personnages, pour parvenir au bonheur dans une société corrompue, se laissent corrompre eux-mêmes : la comparaison entre Bel-Ami et Jeanne est intéressante. Or, Maupassant fait échouer Jeanne qui va de malheur en malheur et réussir Bel-Ami. Au XIXe siècle, les romantiques, comme les
Réponses aux questions – 20
réalistes et les naturalistes, sont déçus par le monde dans lequel ils vivent. Ils expriment cette déception d’une manière différente. Mais, souvent, les auteurs réalistes, comme Balzac, Flaubert, Maupassant ou Stendhal, choisissent des héros jeunes, romantiques, idéalistes, et les font échouer. La réussite de Bel-Ami, par exemple, n’est que sociale et matérielle ; sur le plan humain, il est plein de vices et de défauts. Sa réussite est donc relative et éthiquement peu enviable. D’où la révélation de l’immense pessimisme de Maupassant, sa vision du monde, des hommes, de la vie qui n’est que désillusion. Les seuls moments où Jeanne est heureuse sont ceux où elle se trouve dans la nature ou avec ses parents, ceux où elle rêve… Or, eux non plus ne sont pas faits pour ce monde. – Il en est de même à la fin du Père Goriot : le discours de Vautrin à Rastignac révèle une vision extrêmement pessimiste de la société du XIXe siècle. • Quel que soit le roman, la question du bonheur n’est jamais envisagée seule. Des genres romanesques, parfois considérés à tort comme moins sérieux, tel le roman fantastique ou policier, proposent une vision du monde et du bonheur : – Le roman fantastique peint souvent des utopies ou des dystopies : ce sont soit des mondes imaginaires meilleurs, idéaux, soit des visions terrifiées ou terrifiantes d’un monde qui pourrait devenir le nôtre (les défauts, les risques y sont amplifiés)… Dans ces mondes-là, le bonheur est impossible. – Le roman policier, qui peut s’apparenter à un divertissement, fait plonger le lecteur dans un monde terrible où le crime est le plus souvent la conséquence de la quête du pouvoir, de l’argent, de la folie des hommes. La plupart du temps, le roman s’achève par le rétablissement de la justice.
3. Une question existentielle et métaphysique : le bonheur est-il possible ? A. Le bonheur et le mal • Au-delà des questions sociales, politiques ou éthiques, c’est la question du mal qui est posée. La misère, le vice, etc. sont des formes du mal. La plupart des romans déjà cités, comme Les Liaisons dangereuses (ou le conte philosophique Candide), mettent le lecteur en face de cette question fondamentale. • Au XXe siècle, après deux guerres, le totalitarisme, etc., la question du mal et du bonheur est posée dans le roman de façon plus cruciale encore, comme Kundera l’analyse dans L’Art du roman : « Le roman est […] une exploration de ce qu’est la vie dans le piège qu’est devenu le monde. […] Dans notre siècle […] le monde se referme autour de nous. » C’est ce que décrit Andreï Makine dans La Musique d’une vie, comme dans la plupart de ses romans (son dernier roman La Vie d’un homme inconnu traite les mêmes thèmes) : son personnage, Alexeï, en fuyant le régime de terreur stalinien à Moscou, se retrouve sur le front. Il perd en un instant tout ce qui pouvait le rendre heureux et donner un sens à sa vie : sa famille, sa fiancée, sa carrière de pianiste virtuose, jusqu’à sa propre identité. Son roman est une véritable quête du bonheur et du sens. B. Le bonheur existe-t-il ? La manière dont les romanciers traitent cette question est-elle révélatrice du regard qu’ils portent sur la vie, la condition humaine ? Certains d’entre eux sont-ils totalement désespérés ? Est-elle révélatrice de leur propre capacité à être heureux, non pas en considérant le monde mais, plus largement, l’existence. Croient-ils au bonheur ? La condition humaine est-elle, pour certains, fondamentalement malheureuse ? – Comme nous l’avons déjà vu, Camus évoque le bonheur dans La Peste. Il choisit de mettre ses personnages dans la situation la plus sombre et la plus extrême qui soit pour poser la question du bonheur. Il affronte la question du mal comme les autres romanciers, mais il pose aussi la question du bonheur face à la mort, dans un monde sans Dieu, où l’homme ne croit pas à l’au-delà, à la vie éternelle, et où la mort risque de rendre la vie absurde (« Nous sommes tous des condamnés à mort »). – Il semble que, dans des romans comme La Peste, La Condition humaine, les romans de guerre (À l’ouest rien de nouveau, Les Croix de bois, etc.), les récits sur les camps de concentration nazis (Si c’est un homme, L’Écriture ou la Vie, La Nuit, etc.), l’homme puisse trouver le bonheur et un sens à sa vie, malgré tout ce qu’il endure : dans l’amour, l’amitié, la fraternité, le fait de se consacrer aux autres pour les aider, éventuellement les sauver de la mort et leur permettre de retrouver une forme de dignité malgré la souffrance, la maladie, dans la lutte contre le mal. Il doit « faire son métier d’homme » (Camus), il a besoin d’être en accord avec lui-même, en menant une existence qu’il peut revendiquer comme étant sienne, celle qu’il a choisie, qui lui convient. Camus n’est pas un écrivain désespéré et
Une vie – 21
propose comme conclusion dans Le Mythe de Sisyphe : « Il faut s’imaginer Sisyphe heureux. » On trouve aussi dans ces romans de magnifiques descriptions de la nature qui transportent les personnages et les rendent heureux. C’est aussi ce qui se passe dans Une vie. – Dans La Musique d’une vie de Makine, où l’on voit bien la vision pessimiste et mélancolique de l’auteur, le personnage principal cherche une clé qui pourrait l’aider à comprendre pourquoi, dans le chaos de sa vie, il peut encore trouver des moments où il est heureux. C. Le bonheur dans l’art, dans l’écriture • En effet, le bonheur réside aussi dans l’art, comme le montre Semprun dans L’Écriture ou la Vie. • Des auteurs, parmi les plus pessimistes (Flaubert, Maupassant), ont trouvé le bonheur dans l’écriture. Le perfectionnisme de Flaubert est célèbre, comme, plus tard, celui de Proust. Dans l’œuvre de ce dernier, le bonheur réside dans le passé retrouvé et dans la perfection de l’art.
Conclusion La question du bonheur a bien une place essentielle dans le roman, révélant la vision que les écrivains ont du monde, de l’existence et des hommes. Dans leur quête du bonheur et du sens de la vie, ils livrent au lecteur des réponses précieuses aux questions qu’il se pose. Ils peuvent aussi le rendre heureux en lui offrant ainsi ce qu’ils ont créé de meilleur.
Écriture d’invention Les élèves doivent choisir parmi les procédés de narration des textes du corpus et s’y tenir rigoureusement, que ce soit dans le choix du point de vue ou de la forme du discours. On valorisera les copies des élèves qui auront su utiliser les textes du corpus et les adapter à leur époque. On valorisera aussi celles qui proposeront une réflexion personnelle et approfondie sur leurs questions et leurs attentes au sujet de l’avenir.
C h a p i t r e V I ( p p . 8 9 à 1 0 5 )
◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 106-107)
Un moment de bilan et d’introspection u La phrase qui précède cet extrait est la suivante : « et Jeanne, un peu lasse, s’assit ». À partir de ce moment-là, le lecteur entre dans la pensée de Jeanne et assiste au cheminement de sa réflexion : « Elle se demanda ce qu’elle allait faire maintenant. » Jeanne pense aller se promener et y renonce aussitôt, comme l’annonce la conjonction de coordination « mais » (« mais la campagne semblait si triste »). Jeanne se met à la fenêtre et la contemplation du paysage la fait entrer à l’intérieur d’elle-même. Le paragraphe suivant débute ainsi : « Alors elle s’aperçut qu’elle n’avait plus rien à faire ». Cette phrase ne fait pas seulement basculer ce chapitre mais tout le roman. Jeanne découvre l’ennui. Elle revoit son passé, sa jeunesse au couvent, puis sa sortie du couvent et son mariage. Ce moment, introduit par l’adverbe de temps « Puis », correspond à la mort de ses désirs, de ses rêves, de ses espérances. Le paragraphe suivant commence par l’expression « Mais voilà que ». Nous avons donc à la fois une conjonction de coordination marquant une opposition et une tournure emphatique mettant en valeur la lassitude du personnage. Ce paragraphe est un paragraphe pivot qui marque une évolution par rapport au précédent où elle découvrait l’ennui. Désormais, elle en prend conscience et perd espoir. Elle pénètre dans l’ennui pour ne plus jamais en sortir. À ce paragraphe répond le suivant qui, par une phrase nominale, permet au lecteur d’assister aux tristes conclusions que tire le personnage : « Alors plus rien à faire ». « Alors » est ici à la fois un adverbe de temps et un adverbe de conséquence, qui exprime parfaitement le désarroi du personnage. v L’extrait commence par une interrogative indirecte : « Elle se demanda ce qu’elle allait faire maintenant ». Le lecteur va donc suivre le cheminement de la pensée de Jeanne qui se pose des questions sur sa vie. On trouve d’autres expressions équivalentes comme : « elle n’avait point envie », « elle songeait », « elle sentait en son cœur », « elle s’aperçut ». De très nombreuses expressions sont précédées de l’adjectif possessif (10 occurrences) : « son esprit », « ses mains », « sa mère », « son cœur »…
Réponses aux questions – 22
w Les deux premiers paragraphes débutent par un verbe au passé simple. Ce temps annonce les étapes de sa réflexion, de sa prise de conscience (« Elle se demanda », « Alors elle s’aperçut »). Les autres verbes sont, pour la plupart, à l’imparfait : ils expriment la durée, la monotonie des jours. On trouve aussi quelques futurs progressifs : Jeanne se penche sur son avenir qui sera identique au présent (« ce qu’elle allait faire », « allait devenir »). x Dans les trois derniers paragraphes, le paysage est le reflet des états d’âme de Jeanne. Comme au début du roman, Jeanne se met à la fenêtre et contemple le paysage. Mais la différence est frappante : ce paysage printanier qui la ravissait alors est devenu un paysage automnal triste et trempé de pluie, à l’image de ce qu’elle ressent et de sa vie future. « Elle se leva et vint coller son front aux vitres froides. Puis, après avoir regardé quelque temps le ciel où roulaient des nuages sombres, elle se décida à sortir » : le narrateur n’évoque plus ce que pense et ressent Jeanne mais décrit le monde qu’elle a sous les yeux et qu’elle parcourt. La description du paysage remplace l’introspection. Jeanne n’a plus qu’à regarder à l’extérieur d’elle-même pour comprendre ce que sera sa vie désormais. Les premières sensations (visuelles et tactiles) sont désagréables et évoquent la tristesse : les vitres sont « froides » et le ciel se couvre de « nuages sombres ».
Les espérances du passé y Jeanne se rend compte que ce qui la faisait vivre, c’étaient l’espoir et sa possibilité de rêver. On trouve à plusieurs reprises des expressions les évoquant : sa jeunesse fut « affairée de songeries » et agitée d’« espérances » et d’« espoirs indéfinis ». Le narrateur évoque l’« éclosion » de « ses illusions » et l’accomplissement de « son attente ». Le mari souhaité apparaît dans la périphrase « l’homme espéré ». U Le narrateur utilise un oxymore (« charmantes inquiétudes de l’inconnu ») pour exprimer ce qui faisait vivre Jeanne : Jeanne aimait ces inquiétudes, en avait besoin pour vivre, allant jusqu’à les trouver « charmantes », c’est-à-dire « agréables ». Cela s’oppose à l’expression « plus rien à faire » à laquelle répond, mais en l’amplifiant par l’adverbe de temps « jamais », « plus jamais rien à faire » ; cette expression rythme le texte et en révèle le sens. On la retrouve au quatrième paragraphe. Jeanne aimait se nourrir de rêves, d’espérances, d’illusions, car alors tout était encore possible. Le narrateur qualifie ses « espoirs » d’« indéfinis ». C’étaient cette incertitude, ce vague, ce possible qui lui plaisaient. À présent, il lui semble que son avenir est fermé et que sa vie sera la continuelle répétition des mêmes gestes. L’image de la fermeture apparaît plusieurs fois dans ce début de chapitre : à plusieurs reprises Jeanne songe à sortir, à s’échapper, et regarde par la fenêtre un paysage qui lui semble hostile (paragraphes 1 et 5). Et le narrateur traduit la fin des espérances par la métaphore de la « réalité quotidienne [qui] ferm[e] la porte aux espoirs ». L’image des illusions « écloses » est très explicite : une fois épanouies comme des fleurs, arrivées à maturité, que leur reste-t-il à faire sinon mourir ? De même, son « attente d’amour […] se trouv[e] tout de suite accomplie ». Le participe passé « accomplie » n’est pas à prendre dans un sens mélioratif mais, au contraire, il exprime la mort, l’anéantissement de cette attente qui la faisait vivre. V Dans le deuxième paragraphe, le rythme s’accélère. Tout est allé trop vite pour Jeanne. L’adverbe de temps « Alors » et le passé simple qui débutent le paragraphe expriment déjà un changement (cf. les questions précédentes). On retrouve plus loin les expressions « à peine » et « tout de suite » ; les phrases sont courtes et très ponctuées (seulement deux ou trois propositions) : tous ces éléments créent un effet d’accélération. La fréquente utilisation du participe passé renforce cette impression de finitude survenue trop tôt et trop rapidement : « sortie […] étaient écloses, son attente […] accomplie. L’homme espéré, rencontré, aimé, épousé ». W Au début du roman (cf. question 4), Jeanne se met à la fenêtre, contemple le paysage et se remémore, par effet de contraste, la campagne qu’elle avait contemplée autrefois à son arrivée aux Peuples. Et cette étonnante mémoire que possède Jeanne tout au long du roman la fait souffrir, cette campagne printanière symbolisant la « Jeanne d’autrefois » qui espérait encore. Le narrateur n’a pas besoin de décrire les sentiments de Jeanne, d’évoquer explicitement sa nostalgie ; elle se manifeste par la splendeur de ce tableau lumineux qui lui revient en mémoire. Sa nostalgie apparaît à travers les questions rhétoriques qu’elle se pose et qui sont retranscrites au discours indirect libre : « Étaient-ce la même campagne, la même herbe, les mêmes arbres qu’au mois de mai ? Qu’étaient donc devenues […] ? » Questions auxquelles sera donnée la réponse suivante : « Et cette griserie de l’air chargé de vie, d’arômes, d’atomes fécondants n’existait plus. » L’anaphore de l’adjectif « même » souligne le changement : c’est le
Une vie – 23
même paysage mais devenu méconnaissable. C’est un véritable tableau impressionniste fait de touches de couleurs vives et lumineuses : « la gaieté ensoleillée », « la poésie verte du gazon », « les pissenlits », « les coquelicots », « les marguerites », « les papillons jaunes ». Les rythmes des premières phrases sont rapides, soit ternaires, soit binaires. Puis l’anaphore de « où » crée un effet d’abondance, voire de luxuriance. L’énumération n’en finit plus. Chaque élément du paysage est sujet d’un verbe (flamber, saigner, rayonner…) exprimant l’idée d’une action forte, presque violente, qui en accentue la couleur, la luminosité ou le mouvement, la vie. C’est une nature joyeuse, enivrante et vivante qui lui revient en mémoire, comme le montre cette dernière phrase dont la rapidité, la vitalité sont renforcées par le rythme ternaire : « Et cette griserie de l’air chargé de vie, d’arômes, d’atomes fécondants n’existait plus. » La paronomase (« arômes »/« atomes ») permet de mieux lier encore les mots entre eux. À la fin, la locution verbale « n’existait plus » crée un effet de chute. Ce monde-là a disparu.
L’ennui X On trouve quatre occurrences du verbe faire dans cet extrait. Or, leur sens évolue et suit le courant pessimiste de la pensée de Jeanne. La première fois qu’il est utilisé, c’est au sens d’« agir », de « trouver une occupation », comme le montre la suite de la phrase : « Elle se demanda ce qu’elle allait faire maintenant, cherchant une occupation pour son esprit, une besogne pour ses mains. » Mais Jeanne se trouve devant l’incapacité d’agir, de faire quoi que ce soit. Et cette soudaine vacuité va l’envahir tout au long du roman. Elle est profonde et révèle une lassitude immense, proche du dégoût de vivre. Elle est le signe d’un ennui proche du désespoir : « Alors elle s’aperçut qu’elle n’avait plus rien à faire, plus jamais rien à faire. » L’on pourrait croire que le « plus rien à faire » n’est que temporaire, et même éphémère, mais la répétition en écho de la même phrase avec l’adverbe « jamais » inscrit cette vacuité dans sa vie tout entière. À cette phrase répond une autre quasiment semblable, au début du quatrième paragraphe : « Alors plus rien à faire, aujourd’hui, ni demain ni jamais. » La phrase est nominale : c’est un constat amer, immobile. La gradation des adverbes de temps exprime le profond désespoir de Jeanne. La récurrence du mot « rien » souligne l’anéantissement des désirs de Jeanne. at Cette découverte de l’inanité de son existence envahit donc non seulement le présent de Jeanne mais aussi son avenir. L’adverbe « maintenant » dans la première phrase signifie davantage que « l’instant présent » et pourrait être traduit par l’expression « à partir d’aujourd’hui ». Lorsqu’il oppose passé et présent dans le second paragraphe, le narrateur évoque l’absence d’ennui. Les verbes « préoccupé », « affairé », « emplissait », l’adjectif « continuelle » mettent en valeur cette jeunesse. Pourtant, tout a changé désormais : ce changement est souligné par la tournure emphatique « Mais voilà que » (« Mais voilà que la douce réalité des premiers jours allait devenir la réalité quotidienne qui fermait la porte aux espoirs indéfinis, aux charmantes inquiétudes de l’inconnu. Oui, c’était fini d’attendre »). Nous avons déjà analysé l’emploi du futur proche. Il s’agit bien de son avenir et d’un avenir qu’elle pré-voit : l’expression « allait devenir » montre que Jeanne est certaine de ce qui l’attend. S’opère ici une sorte de métamorphose, renforcée par l’emploi des mêmes termes : on passe de « la douce réalité des premiers jours » à une réalité qualifiée non plus de « douce » mais de « quotidienne » et suivie de la relative « qui fermait la porte aux espoirs indéfinis, aux charmantes inquiétudes de l’inconnu » déjà analysée précédemment. Il n’y a plus de plaisir de vivre (de douceur de vivre) mais des jours à venir, identiques les uns aux autres et dénués de rêves et d’espérances : « Oui, c’était fini d’attendre. » Cette phrase au discours indirect libre dans un registre de langue oral, presque familier, renforce l’idée que l’avenir, représenté ici par l’attente, a désormais disparu. ak La tristesse de Jeanne est manifeste tout au long du passage (cf. l’analyse précédente de son ennui et de son désespoir) et apparaît dans le vocabulaire : l’adjectif « triste » qualifie la campagne et la pluie l’état psychologique de Jeanne. Dans le premier paragraphe, ce qu’elle ressent est désigné par l’expression « une pesanteur de mélancolie ». Ce groupe de mots créé par Maupassant exprime parfaitement ce qu’elle éprouve : l’article indéfini « une » montre à quel point ce qui l’envahit reste vague, indéfini, et le mot « pesanteur » à quel point la mélancolie l’écrase, l’opprime. Le fait que le mot « mélancolie » soit le complément du nom « pesanteur » et soit introduit par la préposition « de » fait d’elle un sentiment vague, informe, une tristesse immense et lourde, d’autant plus difficile à combattre qu’elle est sans cause. Maupassant crée une autre expression à la fin du quatrième paragraphe, construite de la même façon : « Elle sentait tout cela vaguement à une certaine désillusion, à un affaissement de ses rêves. » On reste dans le vague, l’indéfini, mais une seule chose reste certaine et
Réponses aux questions – 24
imprégnante : la tristesse, qui apparaît ici sous la forme d’une désillusion définie de façon métaphorique par l’idée que les rêves se sont effondrés, comme s’ils avaient plié sous un poids trop lourd. Tout est vague et doux (les sonorités sont très douces), et Jeanne s’y enfonce. al La tristesse de Jeanne est aussi visible à travers le paysage qui est ici un véritable « paysage état d’âme » (cf. question 4) et qui est l’envers de celui qu’elle contemplait autrefois. La « gaieté ensoleillée des feuilles, et la poésie verte du gazon où flambaient les pissenlits » ont disparu. Le narrateur insiste sur le fait que la pluie est incessante : « Les avenues [sont] détrempées par les continuelles averses ». À cette phrase répond la dernière, qui compare à la pluie la chute incessante des feuilles et où l’adjectif « incessante » répond à l’expression « sans cesse ». C’est un paysage où tout s’effondre. On assiste à la lente et inexorable chute des feuilles par une succession de verbes à l’imparfait qui traduisent leur mouvement avant qu’elles ne tombent : « se détachaient, tournoyaient, voltigeaient et tombaient ». Le rythme est régulier, si bien que la chute paraît inéluctable ; c’est en effet le verbe tomber qui achève la phrase et le paragraphe. La nature, si belle, si luxuriante et gaie dans le passé, est ici montrée comme étant atteinte par le froid, la maigreur et la mort. « La gaieté ensoleillée des feuilles » est en effet remplacée par « un épais tapis de feuilles mortes ». Le narrateur insiste sur la couleur des « feuilles, toutes jaunes maintenant » : cette couleur unique fait contraste avec la multitude des couleurs évoquées dans le paragraphe précédent. Le jaune, qui est habituellement une couleur vive, chaude, lumineuse, ne l’est pas ici. Cette expression révèle une transformation, un dépérissement. Les peupliers, qui sont des arbres particulièrement hauts, effilés et élégants, sont décrits comme étant grelottants, nus et maigres. Cette maigreur et cette fragilité qui les font ressembler à des humains sont renforcées par des allitérations : « maigreur », « grelottante », « grêles », « s’égrener » et « peupliers », « presque », « branches », « tremblaient ». Les imparfaits et les participes accentuent l’effet de continuité, de durée. L’idée du « paysage état d’âme » peut être comprise ici de deux façons. Ce paysage est tellement intériorisé qu’on ne sait pas s’il est le reflet de l’état de l’âme de Jeanne ou si c’est le contraire. Et il en sera ainsi tout au long du roman, puisque le lecteur le perçoit toujours à travers le regard, la pensée de Jeanne. Est-ce la tristesse de Jeanne qui lui fait voir le paysage ainsi et le fait mourir en quelque sorte, elle qui a « collé son front aux vitres froides » puis est sortie affronter l’automne et la pluie, ou est-elle victime de la morosité de la campagne, se laissant envahir par sa tristesse qui, insidieusement, s’est glissée en elle, comme l’indique l’expression « incessante et triste à faire pleurer » ? am Ce passage est l’un des plus importants du roman parce que Jeanne y découvre l’ennui pour ne plus en sortir. Il peut être considéré comme le début d’un second roman, ce roman sur « rien » dont rêvait Flaubert. Jeanne s’est métamorphosée ; elle est totalement désenchantée. Elle n’éprouve plus de joie en revenant sur les lieux de son enfance ; tout plaisir a disparu de sa vie et plus rien, désormais, ne la porte vers l’avenir. Elle est à l’image de ce début de chapitre VI, où, à partir du moment où elle découvre qu’elle n’a « plus rien à faire » et n’aura « plus jamais rien à faire », elle s’immobilise dans une sorte de rêverie lasse qui tourne en rond, ne produit rien ; dans ce passage, rien n’est raconté ; le narrateur constate, à travers le regard de son héroïne, l’affaissement du monde et des espoirs de Jeanne, noyés par une triste pluie d’automne.
◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 108 à 116)
Examen des textes et de l’image u L’ennui peut se manifester de façon physique. Le personnage d’Indiana (texte B) est décrit en train de perdre toutes ses fonctions vitales au point d’en mourir : « Aussi elle se mourait […]. Elle était sans force et sans sommeil […] ; toutes ses facultés s’appauvrissaient également, tous ses organes se lésaient avec lenteur ; son cœur brûlait à petit feu, ses yeux s’éteignaient, son sang ne circulait plus que par crise et par fièvre ; encore quelque temps, et la pauvre captive allait mourir. » Les réactions du personnage de Lazare (texte E) sont moins violentes mais tout aussi profondes. Il est atteint d’une sorte de lassitude générale qui l’empêche d’agir : ainsi, bien qu’il ait envie de sortir pour échapper à l’atmosphère qui règne chez lui, « une répugnance invincible de la marche lui était venue ». Son ennui se traduit par un sentiment de malaise général à la fois psychologique et physique (« Il s’ennuyait dehors, d’un ennui qui allait jusqu’au malaise » – malaise traduit par une sensation d’écrasement). La mer, le ciel, tout lui semble soudain trop grand : « C’était trop grand, trop froid, et il se hâtait de rentrer, de s’enfermer, pour se sentir moins petit, moins écrasé
Une vie – 25
entre l’infini de l’eau et l’infini du ciel. » Les répétitions accentuent une telle sensation : « trop grand », « trop froid » ; « moins petit », « moins écrasé ». Le narrateur joue sur des antithèses : « grand » et « infini » s’opposant à « petit » et « écrasé ». Et la dernière met bien en valeur l’idée qu’il se sente perdu, seul et minuscule, au milieu de deux infinis, l’image plaçant l’homme au centre. Enfin, dans le tableau de Monet, la position de la femme donne une impression générale de fatigue, de lassitude. Son corps est affaissé et son menton est si rentré qu’on ne distingue plus son cou. v Dans le texte de Maupassant (texte A), le paysage est un véritable « paysage état d’âme » (cf. lecture analytique). Il en est de même dans celui de Flaubert (texte D) : pour Emma, que son ennui quotidien a abattue, le dimanche est un jour encore plus triste que les autres. Inoccupée, elle est attentive aux sons d’une cloche lointaine, le soir. Le narrateur évoque cette attention par l’oxymore « hébétement attentif » ; il semble que, dans sa torpeur – une sorte de somnolence –, elle guette des signes extérieurs qui ne feraient que la conforter dans sa mélancolie ; tout est triste alors, voire sinistre : les coups de la cloche sont « fêlés », sa « sonnerie monotone se perd dans la campagne ». L’adjectif « monotone » est très riche sémantiquement : il fait à la fois référence à un son qui se répète de façon régulière et à l’ennui – on retrouve ce thème de la cloche fêlée, dont le tintement affaibli et lointain dans la campagne attriste celui qui l’entend, dans un poème de Baudelaire intitulé La Cloche fêlée (« Moi, mon âme est fêlée ») ; ce bruit monotone et obsédant, associé à la tristesse et à la mort, apparaît aussi dans un autre de ses poèmes, Chant d’automne, où le poète, angoissé par l’arrivée de l’hiver, écoute le bruit des bûches qui tombent. À ces perceptions auditives s’en ajoute une autre, plus lugubre encore : celle du chien qui hurle « au loin ». D’autres éléments reflètent l’état d’âme du personnage : l’absence de lumière, la lenteur, un chat solitaire, le vent, la poussière, une route qui n’en finit plus. Les verbes, conjugués à l’imparfait, accentuent cette impression d’ennui, de tristesse. Ces éléments pourtant disparates (nous avons, en effet, une immense impression de solitude, de dénuement) contribuent à créer la même atmosphère et décrivent aussi bien ce qui se passe à l’extérieur qu’à l’intérieur du personnage. Le tableau de Monet illustrerait très bien ce texte : la femme représentée semble désœuvrée ; le regard perdu ailleurs, dirigé vers la fenêtre, elle tient un livre dans ses mains. Il semble qu’elle ait abandonné sa lecture : le livre est fermé et elle ne le regarde pas (« J’ai tout lu, se disait-elle », écrit Flaubert). Le salon dans lequel elle se trouve est réduit à un canapé aux motifs fleuris. On ne distingue pas le reste de la pièce, ce qui donne une impression à la fois de confort bourgeois sans fantaisie et d’enfermement. L’on peut penser que le personnage, désireux d’échapper à son ennui, regarde vers la fenêtre. Mais les rideaux sont fermés. C’est donc davantage un semblant d’ouverture qu’une possibilité réelle de s’échapper. Dans le texte de Zola (texte E), le personnage de Lazare cherche en sortant à échapper à l’atmosphère pesante de deuil et d’ennui qui règne chez lui. Mais le paysage extérieur qu’il aimait autrefois va le renvoyer à son ennui et à son angoisse. Il éprouve alors la même lassitude qu’Emma (texte D) à l’idée d’accomplir des actes qui lui plaisaient autrefois : « Mais une répugnance invincible de la marche lui était venue. Il s’ennuyait dehors, d’un ennui qui allait jusqu’au malaise. » Cependant, comme l’indique le mot « malaise », sa lassitude va plus loin. Le narrateur évoque alors plusieurs paysages, plusieurs lieux de promenade qui vont provoquer des réactions contraires à celles que le personnage espérait et le faire plonger encore plus profondément dans son « mal-être ». La mer et le ciel l’oppressent (cf. question 1). La mer n’est pas une métaphore de son état d’âme mais elle le renvoie à sa solitude. Elle est personnifiée et représentée comme étant indifférente et étrangère aux malheurs qui terrassent les humains : « Cette mer, avec son éternel balancement, son flot obstiné dont la houle battait la côte deux fois par jour, l’irritait comme une force stupide, étrangère à sa douleur, usant là les mêmes pierres depuis des siècles, sans avoir jamais pleuré sur une mort humaine. » Seul le cimetière le calme et lui permet d’échapper à lui-même : « il s’oubliait là ». Le lieu est rappelé de nombreuses fois par le pronom « y » ou l’adverbe « là ». Le narrateur insiste sur la paix que le personnage éprouve alors, celle-ci étant mise en valeur par tout un champ lexical : « douceur », « s’y calmait », « dormaient », « bercés », « il s’oubliait là » ; les deux avant-dernières phrases sont composées d’une succession d’indépendantes juxtaposées qui montrent comment, peu à peu, sous l’influence du décor, le calme s’installe en lui : « il y songeait à elle avec une grande douceur, il s’y calmait singulièrement, malgré sa terreur du néant. Les tombes dormaient dans l’herbe, des ifs avaient poussé à l’abri de la nef, on n’entendait que le sifflement des courlis, bercés au vent du large. Et il s’oubliait là des heures, sans pouvoir même lire sur les dalles les noms des vieux morts ». Le narrateur dresse un décor apaisant, à la fois visuel et auditif, particulièrement doux et harmonieux, en évoquant les ifs, le
Réponses aux questions – 26
chant des oiseaux. Mais, soudain, l’angoisse du néant surgit pour ne plus le quitter, sans que cette angoisse soit introduite. Dans le paragraphe qui suit apparaissent les questions que se pose Lazare et ses angoisses : « Encore si Lazare avait eu la foi en l’autre monde, s’il avait pu croire qu’on retrouvait un jour les siens, derrière le mur noir […]. » Il se peut que l’impossibilité de lire les noms des défunts sur les tombes ait contribué à la naissance de ces sentiments. w Le texte de Musset est une longue suite de métaphores par lesquelles l’auteur traduit le mal de vivre de toute la génération romantique qui a eu l’impression de naître ou trop tôt ou trop tard, le passé étant considéré comme mort (« derrière eux un passé à jamais détruit », « le vieux continent »). Musset utilise, pour l’évoquer, des images associées à la mort : ce sont des « ruines », des « fossiles », des « débris » ; le siècle présent se trouve « assis sur un sac de chaux plein d’ossements » ; c’est « un spectre » ou « une momie ». L’avenir, quant à lui, est encore impossible à atteindre et est alors comparé à la statue façonnée par Pygmalion qui attend qu’on lui donne la vie. Sa beauté lointaine devient « l’aurore d’un immense horizon, les premières clartés de l’avenir », « la jeune Amérique » (comparée au « vieux continent » qu’est le passé, comme nous venons de le voir). Comme il n’est pas encore né, ce sont aussi des « semences » (comparées aux « débris ») ou un « fœtus ». Dans la morosité du présent comparé à l’Océan, « les jeunes gens entrevoient quelque blanche voile lointaine ou […] quelque navire soufflant ». Entre ces deux temps, l’un n’existant plus, l’autre n’étant pas encore né, se trouve une période intermédiaire extrêmement floue et chaotique (« un chaos ») : le présent (« entre ces deux mondes… quelque chose […] qui sépare », « je ne sais quoi de vague et de flottant »). Il est personnifié : les êtres qui le représentent sont des êtres fragiles, inexistants, en souffrance, entre deux mondes ou déjà morts (l’« ange du crépuscule, qui n’est ni la nuit ni le jour » ; « serré dans le manteau des égoïstes, et grelottant d’un froid terrible » ; « ce spectre moitié momie et moitié fœtus » ; « la fille d’un vieux comte […], embaumée dans sa parure de fiancée »). Et Musset file la métaphore dans la phrase suivante : « Ce squelette enfantin fait frémir, car ses mains fluettes et livides portent l’anneau des épousées, et sa tête tombe en poussière au milieu des fleurs d’oranger. » Ainsi, la génération romantique, malgré sa jeunesse et sa vigueur, se sent désœuvrée et totalement inutile : elle est comparée à des « gladiateurs frottés d’huile qui avaient préparé leurs bras ». L’image de la mer est récurrente dans cet extrait et représente le présent : « l’affreuse mer de l’action sans but » dont « les vagues écumantes » se sont « retirées ». x Dans le texte de Musset (cf. question 3), la mélancolie de la jeune génération romantique est due à cette impression d’être née dans un temps mort, entre deux temps. Jeanne (texte A – cf. lecture analytique), nostalgique d’un passé heureux plein de rêves, d’illusions et d’espérances, envisage le présent et l’avenir comme un temps vide et ennuyeux, où il n’y aura plus jamais « rien à faire ». Emma Bovary (texte D) est dans une situation similaire à celle de Jeanne, les deux héroïnes ayant beaucoup de points communs, probablement parce que Maupassant et Flaubert étaient très proches. Elle est effrayée et désespérée par la monotonie du présent qu’elle considère comme une fatalité : « Mais, pour elle, rien n’arrivait, Dieu l’avait voulu ! » ; elle a l’impression que les jours passent et sont tous semblables les uns aux autres sans « événement[s] », ni « aventure[s] », ni « péripétie[s] ». Au loin, l’avenir lui semble à jamais fermé et est représenté par l’image d’un « corridor tout noir, et qui avait au fond sa porte bien fermée ». Le même ennui (cf. question 2) envahit le personnage de Lazare (texte E) qui, comme Emma Bovary, ne trouve plus d’intérêt dans les occupations qu’il aimait autrefois ; tout l’ennuie : les promenades, la contemplation de la mer. L’ennui envahit son présent, l’absorbe. Mais il passe rapidement de l’ennui à l’angoisse de la mort et, plus précisément, du néant, qui occupe ici tout un paragraphe et devient aussitôt un « mur noir ». Le narrateur nous fait assister à son débat intérieur : « Encore si Lazare avait eu la foi en l’autre monde, s’il avait pu croire qu’on retrouvait un jour les siens, derrière le mur noir. » Cette angoisse se manifeste par un refus, une révolte à l’idée que son « moi » disparaisse totalement et qu’il ne puisse pas retrouver dans l’au-delà ceux qu’il aimait : « il était trop convaincu de la fin individuelle de l’être, mourant et se perdant dans l’éternité de la vie. Il y avait là une révolte déguisée de son moi, qui ne voulait pas finir. Quelle joie de recommencer ailleurs, parmi les étoiles, une nouvelle existence avec les parents et les amis ! comme cela aurait rendu l’agonie douce, d’aller rejoindre les affections perdues, et quels baisers à la rencontre, et quelle sérénité de revivre ensemble immortels ! » Le discours indirect libre permet au lecteur d’entrer dans la pensée du personnage. Le narrateur, reprenant ainsi ses paroles et son ton, transmet de façon plus forte et plus vivante la révolte et l’angoisse qui le hantent. Ainsi, le passage s’achève sur la certitude de la finitude des êtres et sur l’image du gouffre de la mort et du vertige qu’il provoque. On retrouve les
Une vie – 27
mêmes exclamations que dans les phrases précédentes, des répétitions (avec les pronoms indéfinis « tout » et « rien » qui se répondent, l’adverbe de temps « jamais »), des parallélismes syntaxiques et phoniques (« tout finissait à la mort »/« rien ne renaissait de nos affections ») et un style qui reste proche de l’oralité (« Non […]. Oh ! jamais ! jamais ! c’était ce mot redoutable qui emportait son esprit dans le vertige du vide ! »). La tristesse du personnage du texte B est d’une tonalité différente. Le texte est lyrique et pathétique. Le lecteur lit dans la pensée du personnage qui se lamente à plusieurs reprises sur son sort dans un monologue intérieur. En outre, sa tristesse n’est pas sans cause : elle est née d’une déception due à des rêves qui ne se sont pas réalisés. Le texte met très clairement en évidence la rupture entre le futur rêvé, l’attente et le constat amer, dans une courte phrase qui est une chute avec la métaphore du messie et le plus-que-parfait exprimant l’idée d’un passé révolu : « “Un jour viendra où tout sera changé dans ma vie, où je ferai du bien aux autres ; un jour où l’on m’aimera, où je donnerai tout mon cœur à celui qui me donnera le sien ; en attendant, souffrons ; taisons-nous, et gardons notre amour pour sa récompense à qui me délivrera.” Ce libérateur, ce messie n’était pas venu. » L’anaphore de « où » et l’abondance de futurs mettent en valeur cette opposition.
Travaux d’écriture
Question préliminaire Les manifestations physiques du mal-être des personnages (cf. questions) sont différentes suivant les textes et les auteurs (cf. question 1). Il en est de même pour les liens entre leur état intérieur et le monde qui les entoure (cf. question 2). Leur relation avec le temps (cf. question 4) est directement liée à leur ennui. L’ennui dans ces textes prend des visages différents : tristesse, mélancolie, ennui, angoisse… Le seul texte vraiment mélancolique est sans doute celui de George Sand (texte B), dans la mesure où Indiana connaît les causes de sa tristesse et oscille encore entre espoir et désespoir. Entre mélancolie et ennui, les frontières sont fragiles (cf. introduction)… L’espoir revient en effet dans la deuxième partie du texte : « Mais quel que fût sa résignation ou son découragement, le besoin restait le même. Ce cœur silencieux et brisé appelait toujours à son insu un cœur jeune et généreux pour le réchauffer. » Dans les autres textes, en revanche, les deux maux semblent indissociables. Alfred de Musset nous laisse un témoignage et une analyse précieux de ce qu’il a appelé lui-même « le mal du siècle » romantique. Nous avons déjà étudié comment, par des métaphores, Musset décrivait le malaise de toute une génération, perdue entre la nostalgie d’un passé désormais mort et un avenir dont elle ne verra pas le jour. Nés trop tôt et trop tard, tous ces jeunes gens doivent se contenter d’un insupportable présent. Leur force, leur jeunesse n’ont aucune possibilité de se réaliser, comme le traduit si bien l’image déjà relevée (cf. question 3) des gladiateurs : « voilà ce qui se présentait à des enfants pleins de force et d’audace, fils de l’Empire et petits-fils de la Révolution ». La plupart de ces images sont celles de la mort et témoignent d’une angoisse terrible : « L’angoisse de la mort leur entra dans l’âme ». Il leur reste donc le présent, ce que Musset appelle avec mépris et amertume « l’esprit du siècle ». Une telle incapacité d’agir (« Condamnés au repos ») ou de trouver un but à leur existence (désignée par l’image de « l’affreuse mer de l’action sans but ») s’est transformée en « un sentiment de malaise inexprimable [qui] commença donc à fermenter dans tous les cœurs jeunes ». Ce siècle les dégoûte et les condamne à l’oisiveté et à l’ennui. Le « mal du siècle » est donc un sentiment complexe où se mêlent angoisse, lassitude, désespoir et ennui. En cela, on peut rapprocher ce texte de celui de Zola (texte E). Lazare (cf. question 1) est atteint d’une sorte de lassitude générale qui l’empêche d’agir : ainsi, bien qu’il ait envie de sortir pour échapper à l’atmosphère qui règne chez lui, « une répugnance invincible de la marche lui était venue ». Son ennui se traduit par un sentiment de malaise général. Seul le cimetière fait disparaître ce malaise et l’apaise : « il s’y calmait singulièrement ». Mais, inévitablement, il lui fait penser à la mort et l’angoisse du néant s’empare de lui d’une façon extrêmement violente. La lassitude de Lazare peut être liée à celle de Jeanne et d’Emma dans la mesure où, comme lui, elles ne trouvent plus de plaisir à accomplir des actes autrefois aimés. Emma, en effet, se détourne de la musique, du dessin, de la couture et de la lecture ; alternant point de vue omniscient et monologue intérieur, le narrateur permet au lecteur de lire dans la pensée d’Emma qui fait une sorte d’inventaire
Réponses aux questions – 28
de tout ce qui, désormais, l’ennuie : « Elle abandonna la musique. Pourquoi jouer ? qui l’entendrait ? […] Elle laissa dans l’armoire ses cartons à dessin et la tapisserie. À quoi bon ? à quoi bon ? La couture l’irritait. – J’ai tout lu, se disait-elle. » La question « Pourquoi jouer ? qui l’entendrait ? », le verbe irriter et la lassitude exprimée dans le passé composé et l’emploi du pronom indéfini « tout » (« J’ai tout lu ») montrent qu’elle n’éprouve plus ni intérêt ni goût pour des occupations qui, autrefois, avaient un sens. Il est difficile de savoir si ce dégoût est provoqué par l’ennui ou si l’ennui est une conséquence d’un tel dégoût. Ces textes sont en effet de véritables analyses d’un sentiment dont il est d’autant plus difficile de se défaire qu’il est sans cause tangible. Même s’il est provoqué par un sentiment ou un événement, il prend des proportions qui les dépassent et les causes semblent plus profondes, venir de plus loin. L’ennui qui envahit Emma Bovary est terrible : il lui fait perdre tout goût de vivre et se traduit par l’impression que rien ne viendra plus jamais briser la monotonie du quotidien : « Après l’ennui de cette déception, son cœur de nouveau resta vide, et alors la série des mêmes journées recommença. Elles allaient donc maintenant se suivre ainsi à la file, toujours pareilles, innombrables, et n’apportant rien ! […] Mais, pour elle, rien n’arrivait, Dieu l’avait voulu ! L’avenir était un corridor tout noir, et qui avait au fond sa porte bien fermée. »
Commentaire
Introduction Dans ce passage extrait de son roman La Joie de vivre, Zola nous présente l’un de ses personnages principaux en proie à l’ennui et à l’angoisse, à la suite de la mort de sa mère. Le lecteur assiste à la progression de ses sentiments qui, peu à peu, l’envahissent et sont en correspondance avec les différents lieux dans lesquels il se trouve.
1. Le décor A. Une atmosphère intérieure morose • Cet extrait présente un personnage qui ne trouve nulle part d’issue à son propre mal intérieur. Lazare, en premier lieu, cherche à fuir une atmosphère qu’il considère comme trop pesante : « Du moins, il aurait échappé au silence maussade de la bonne et au spectacle pénible de son père, abattu dans un fauteuil, ne sachant à quelle distraction occuper ses dix doigts. » Cette morosité est mise en valeur par les adjectifs « maussade » et « pénible » et le participe passé employé comme adjectif « abattu ». Cette seule phrase suffit à dresser un tableau très visuel, comme l’indique le mot « spectacle ». La position du père « abattu dans un fauteuil » permet d’imaginer la scène, ainsi frappée de tristesse, de silence, d’immobilité, voire d’inertie. • Mais cet ennui qui a atteint son père (« ne sachant à quelle distraction occuper ses dix doigts ») l’a atteint lui aussi, bien qu’il semble encore l’ignorer et cherche à le fuir en sortant de chez lui. B. La mer : une force étrangère et hostile • Cependant, à l’extérieur, le spectacle de la mer lui déplaît et le renvoie à sa solitude (cf. question 2). • Le narrateur décrit, du point de vue de Lazare, les mouvements de la mer, qu’il désigne par l’adjectif démonstratif « cette », qui a ici une valeur péjorative (au sens du latin iste) : « Cette mer, avec son éternel balancement, son flot obstiné dont la houle battait la côte deux fois par jour, l’irritait comme une force stupide, étrangère à sa douleur, usant là les mêmes pierres depuis des siècles, sans avoir jamais pleuré sur une mort humaine. » • Il met en valeur la répétition de ses mouvements en utilisant plusieurs procédés : l’imparfait d’habitude ; le rythme régulier de la phrase, très cadencée, très ponctuée ; les rythmes binaires qui évoquent le mouvement de flux et de reflux de la mer ; le retour régulier des mêmes sonorités comme les dentales (« Cette mer, avec son éternel balancement, son flot obstiné dont la houle battait la côte deux fois par jour, l’irritait comme une force stupide, étrangère à sa douleur, usant là les mêmes pierres depuis des siècles »). • La mer (cf. question 2) est personnifiée (« flot obstiné », « une force stupide, étrangère à sa douleur »). Personnification intéressante, puisqu’elle met paradoxalement en valeur non pas son humanité mais son inhumanité. Son éternel mouvement irrite et ennuie Lazare ; son immensité l’affole, le renvoyant à la fois à sa solitude et à sa fragilité (cf. question préliminaire). C. Le cimetière : un lieu paradoxalement apaisant • Cf. question 2.
Une vie – 29
2. De l’ennui à l’angoisse A. L’ennui • Nous avons déjà évoqué dans la première partie à quel point l’atmosphère qui règne chez lui l’ennuie. Mais le même ennui va s’emparer de lui à l’extérieur (« il s’ennuyait dehors »). Sa vaine tentative est exprimée par l’expression « il avait bien essayé » qui montre son effort. Le plus-que-parfait exprime une action désormais passée et révolue, dont le résultat se vérifie encore. La conjonction de coordination mais (« Mais une répugnance invincible ») marque une opposition entre passé et présent : désormais, ces promenades l’ennuient ; plus encore, elles provoquent en lui des sentiments très forts de « répugnance » et de « malaise » (cf. question 1). Répugnance qualifiée d’« invincible » et contre laquelle il est donc impossible de lutter. Le fait que cette « répugnance » soit le sujet du groupe verbal « lui était venue » montre à quel point cela ne dépend pas de sa volonté et à quel point il est impuissant. • Peu à peu, le narrateur précise la spécificité de cet ennui, de cette mélancolie qui s’empare du personnage : « d’un ennui qui allait jusqu’au malaise ». B. La négation de l’au-delà et son regret • Nous avons déjà montré comment Lazare passe de la paix à l’angoisse (cf. question 2). • Nous assistons dans le dernier paragraphe à la réflexion du personnage sur la mort (cf. question 4). Son angoisse est due à son incapacité de croire à la vie éternelle (« s’il avait pu croire »), croyance qu’il juge illusoire comme un « mensonge charitable des religions, dont la pitié cache aux faibles la vérité terrible ». En opposant ainsi « mensonge » et « vérité », le personnage manifeste un choix, une position métaphysique. Les « religions » étant évoquées ainsi de façon vague et au pluriel ne sont pas différenciées. Sous la forme d’une métonymie, elles agissent ici comme des personnes et sont accusées de leurrer (« dont la pitié cache ») les hommes dans le but de les soulager (« charitable », « pitié », « vérité terrible »). • Le narrateur, en utilisant une proposition hypothétique au plus-que-parfait et le conditionnel passé, montre clairement que Lazare sait ce qu’il perd et le regrette (« Encore si Lazare avait eu la foi en l’autre monde, s’il avait pu croire […] comme cela aurait rendu l’agonie douce »). Tout en ne parvenant pas à y croire, Lazare, avec une immense lucidité, évoque cette « foi en l’autre monde » comme « une consolation », « une joie », qui rend « l’agonie » plus « douce ». Il y a là une forme de courage, de refus de se nourrir d’illusions. • Le texte évoque de façon touchante ces espoirs auxquels il n’a pas droit : il s’agit de retrouver les êtres chers qu’on a perdus. • De façon très poétique, il désigne l’au-delà par une « nouvelle existence » (on remarque l’utilisation fréquente du préfixe re- : retrouver, recommencer, rejoindre, revivre ) « parmi les étoiles ». • De même, l’espace d’un instant, Lazare imagine quelle joie ce serait. Le texte s’adoucit dans la description de ce rêve qui est une très belle description du paradis, orientée essentiellement vers les retrouvailles avec les êtres chers qu’on a perdus. Le discours indirect libre rend parfaitement compte de ce rêve, de ce qu’il a d’enthousiasmant, avec des propositions exclamatives et l’anaphore de « quel » ; d’autant plus qu’il y a une gradation : on passe des « siens » aux « parents et amis » et aux « affections perdues ». De même, on passe des retrouvailles aux baisers et à la nouvelle vie passée ensemble dans l’immortalité. À plusieurs reprises le narrateur insiste sur le fait qu’il s’agit de revivre : la mort a disparu (« une nouvelle existence », « de revivre ensemble immortels »). • Lazare résume ce tableau onirique et idyllique par le mot « sérénité » qui montre à quel point une telle foi apaise celui qui y croit. C. L’angoisse • Par opposition à ce que Lazare imagine comme « la sérénité », le visage de la mort est terrifiant : au mot « terreur » répond plus loin l’adjectif « terrible ». Il s’agit donc non pas de peur mais d’un sentiment beaucoup plus fort. • Immense angoisse devant ce que Lazare voit comme le vide, le « néant », exprimée par la métaphore « derrière le mur noir ». • La mort, c’est d’abord la disparition, l’effacement évoqué dans l’avant-dernier paragraphe : « sans pouvoir même lire sur les dalles les noms des vieux morts, effacés par les pluies battantes de l’ouest ». Il ne reste donc rien, pas même un nom. • Cette angoisse rejoint son agacement devant l’indifférence de la mer et son effroi devant l’immensité du ciel et de la mer (cf. question 1). L’homme est trop petit, trop fragile face au cosmos : « mourant et se perdant dans l’éternité de la vie ».
Réponses aux questions – 30
• Face à cela, l’être, l’individu, n’est rien : individualité mise en valeur par les termes de « la fin individuelle de l’être », « son moi ». • Le passage se termine sur une sorte de cri de désespoir (cf. question 4) : « Non, tout finissait à la mort, rien ne renaissait de nos affections, l’adieu était dit à jamais. Oh ! jamais ! jamais ! c’était ce mot redoutable qui emportait son esprit dans le vertige du vide ! »
Conclusion Zola nous propose ici une peinture originale et sans doute personnelle de l’ennui et de l’angoisse de la mort dans ce passage qui renvoie le lecteur à des questions non seulement existentielles mais encore métaphysiques. L’une des forces de ce texte est de posséder aussi une grande puissance évocatrice dans le choix des images, à la fois poétiques et cosmiques, d’autant plus que les sentiments du personnage se matérialisent à l’intérieur d’un paysage qui leur fait écho. Le discours indirect libre, très habituel dans ses romans, nous permet d’accéder à l’intimité du personnage, de ses rêves et de ses angoisses les plus profonds, le rendant ainsi extrêmement touchant et humain.
Dissertation
Introduction Le roman a toujours été considéré comme un moyen de s’évader et de rêver ; et cela explique à la fois son succès et le mépris de certaines personnes à son sujet. Comme le dit Claude Roy, certains voient dans le roman « une amusette, un gaspillage de force ». Il est pourtant jugé par d’autres comme étant un instrument de connaissance (Milan Kundera, par exemple, ou Robbe-Grillet, qui pense que le roman doit « transcender […] l’anecdote » pour aller vers « une vérité humaine profonde, une morale ou une métaphysique »). Doit-on nécessairement opposer ces deux aspects du roman ou peut-on voir dans l’essence même de ce genre littéraire un instrument à la fois d’évasion et de connaissance de soi et du monde ?
1. Quels sont les liens entre le roman et le réel ? A. La création romanesque • Le roman, par définition, se démarque du réel : le mot même de roman et l’adjectif romanesque sont utilisés pour désigner le fait que l’on sort du réel, que l’on s’en éloigne. L’on dit d’une jeune fille qu’elle est romanesque quand elle est trop naïve, trop idéaliste (Jeanne dans Une vie, Emma Bovary). De même, « le langage commun appelle roman le récit mensonger du journaliste maladroit » (Camus, L’Homme révolté). • Le roman est une œuvre de fiction, née de l’imagination du romancier. Comme dans toute œuvre d’art, il y a création et recréation d’un monde et, notamment, du réel. Cela signifie que, comme l’écrit Zola, le romancier « ne saurait reproduire ce qui est dans la réalité, il n’a aperçu les objets qu’au travers de son tempérament : il retranche, il ajoute, il modifie, et, en somme, le monde qu’il nous donne est un monde de son invention » (Zola, Le Salut public, Lyon, 29 avril 1865). Le romancier propose donc une vision subjective, personnelle de la réalité, « au travers de son tempérament ». Ainsi, il ne va pas reproduire un monde mais le transformer, le recréer. Il va se servir de sa vue et de son imagination. Il va choisir. Il y a là une opération magique : le romancier voit et transpose par l’écriture ce qu’il a vu, et en fait une œuvre écrite, artistique. • Camus, dans L’Homme révolté, consacre plusieurs chapitres à la création romanesque dont la source, l’origine seraient l’insatisfaction, la mélancolie, la déception, la nostalgie… l’homme rêvant d’un monde plus uni, plus accompli que le nôtre. Le lecteur n’est donc pas dans le réel mais dans un réel recréé, si bien qu’il échappe nécessairement à la réalité en lisant un roman. B. La vraisemblance • Le romancier recrée alors un univers à part entière : en cela, le roman est le genre littéraire le plus proche du réel et le plus apte à transporter le lecteur dans son univers. • Le fait que le roman ait une certaine durée va permettre au lecteur d’avoir le temps d’entrer dans l’histoire et de la vivre, d’autant plus qu’elle racontera la vie de personnages qui souvent lui ressemblent. • Le roman, ainsi, a pour fin d’être vraisemblable : il imite la réalité, s’inscrit en elle, tente de faire croire à la réalité de ce qui est raconté. Là encore, le roman rejoint la vie.
Une vie – 31
• D’autres procédés permettent au lecteur de « croire » à ce qu’il lit, comme les descriptions qui l’aident à se représenter le monde dans lequel les personnages vivent et les personnages eux-mêmes. Les textes de Maupassant, de Flaubert et de Zola (corpus) mettent en scène les personnages qui se sentent écrasés par leur ennui. Le lecteur peut se représenter la scène, y croire. C. Les pouvoirs du roman : roman et évasion • Ainsi, le lecteur va échapper à sa vie et à lui-même en lisant un roman : – Lire un roman, c’est sortir de son propre monde pour entrer dans un autre. Pendant la lecture, nous menons une sorte de vie parallèle à la nôtre ; et même si la réalité décrite dans le roman ressemble au monde qui nous entoure (comme c’était le cas pour les lecteurs du XIXe siècle en lisant un roman réaliste ou naturaliste), elle est en dehors de nous : nous entrons dans un véritable univers qui a sa vie propre (lieu, temps, personnages, intrigue)… – Par les mots qui, une fois lus, prennent vie, le lecteur est transporté dans l’imaginaire, et cela devient un monde dont il peut palper l’existence : il y croit, ressent des émotions, jusqu’à attendre le dénouement avec impatience et parfois avec inquiétude. On peut être triste à la mort d’un personnage, comme si on l’avait connu (mort de Tarrou dans La Peste de Camus, de Catherine dans Germinal de Zola). Dans Une vie, le lecteur s’attache au personnage de Jeanne et s’intéresse à sa vie, s’en émeut. Il peut même être agacé, avoir envie de conseiller Jeanne, de la voir réagir davantage… • Le lecteur échappe donc nécessairement au quotidien, à sa vie. Proust écrit : « Nous sommes tous devant le romancier comme les esclaves devant l’empereur : d’un mot, il peut nous affranchir. Par lui, nous perdons notre ancienne condition pour connaître celle du général, du tisseur, de la chanteuse, du gentilhomme campagnard, la vie des champs, le jeu, la chasse, la haine, l’amour, la vie des camps. Par lui, nous sommes Napoléon, […] un paysan, bien plus – existence que nous aurions pu ne jamais connaître – nous sommes nous-même. Il prête une voix à la foule, à la solitude, au vieil ecclésiastique, au sculpteur, à l’enfant, au cheval, à notre âme. Par lui nous sommes le véritable Protée qui revêt successivement toutes les formes de la vie. » • Mais certains types de romans éloignent plus le lecteur du réel que d’autres. Quels sont ces romans ?
2. Des romans propices au rêve et à l’exaltation A. L’évasion par la lecture dans un autre temps, un autre lieu • Le temps d’une lecture, le lecteur change totalement de vie. C’est le cas des romans qui le transportent dans un autre temps (le passé, le futur), un autre lieu… En lisant un roman d’une période antérieure, le lecteur se trouve transporté dans cette époque, échappant ainsi à la sienne : la lecture d’Une vie transporte le lecteur au XIXe siècle, en Normandie ; celle d’À l’ouest rien de nouveau d’Erich Maria Remarque lui fait vivre la vie des soldats pendant la guerre de 14-18, de l’intérieur. • Le roman de science-fiction le fait entrer dans l’imaginaire pur en le faisant vivre dans un temps qui n’existe pas encore (Le Meilleur des mondes d’Huxley, 1984 d’Orwell, Fahrenheit 451 de Bradbury). • De même, le roman fantastique fait rêver le lecteur, le fascine (Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde). B. L’évasion par la lecture dans un ailleurs extraordinaire • De la même façon, le roman d’aventures permet au lecteur de sortir du quotidien en le plongeant dans des aventures extraordinaires qu’il a peu de chances de vivre dans la réalité. Tous ces romans enchantent le lecteur depuis son enfance : les romans picaresques comme Don Quichotte, les romans de Jules Verne, de Walter Scott (Ivanhoé) ou d’Alexandre Dumas (Le Comte de Monte-Cristo ou Les Trois Mousquetaires). • Des romans comme Robinson Crusoé ou L’Île au trésor ont fait rêver un grand nombre de générations d’enfants et d’adultes. Ils suscitent le rêve mais rejoignent aussi des rêves, des fantasmes d’enfant, et sont devenus des mythes. • Il en est de même avec le roman policier. • Il est certain que ces romans nous font entrer dans un monde totalement différent du nôtre. Ils nous éloignent de nous-mêmes, de notre vie, nous divertissent (au sens étymologique de « se détourner de soi »). C. L’exaltation par la lecture • C’est le cas aussi du roman épique, du roman de chevalerie (Tristan et Iseut, Le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes), dont les héros sont des êtres d’exception avec des aventures à la mesure de leurs qualités : courage, grandeur d’âme, idéaux…
Réponses aux questions – 32
• Pour le lecteur qui se laisse transporter par de tels romans, tout devient possible. D’autant plus que dans ces romans du Moyen Âge intervient le merveilleux. • Le lecteur ressent de l’admiration et de l’étonnement devant le courage, la vertu, la grandeur ou l’exception. • Ces romans nous exaltent, nous élèvent, donnent une vision du monde embellie, agrandie, magnifiée. Ces personnages sont ce que l’homme pourrait être sans le poids du devoir social, du quotidien banal et astreignant. Nous éprouvons le désir de ressembler à ces héros, de nous identifier à eux. • Ces héros sont entrés dans nos vies, dans nos rêves, pour ne plus jamais en sortir. On ne peut oublier ni Tristan, ni le prince André, ni d’Artagnan, ni Jean Valjean. Ils restent des références, des modèles, des repères, des raisons d’espérer dans le monde et l’homme : grâce à eux tout est encore possible. • Comme ils sont humains et donc proches de nous, nous avons l’impression que de tels personnages, de tels destins exemplaires sont possibles… • Mais le vrai « bon » roman sera celui qui transporte tout en faisant réfléchir.
3. Le roman ouvre les yeux A. Roman d’évasion et retour sur soi • Leur pouvoir d’évasion ne signifie pas que ces romans empêchent un retour sur soi, une réflexion sur la vie, le monde… Ils peuvent nous pousser aussi à nous interroger, à nous poser des questions graves, parce que certains de ces héros exemplaires se trouvent devant des choix impossibles, dans des situations tragiques… La lecture des Trois Mousquetaires, par exemple, peut nous faire réfléchir sur le mal, la vengeance (personnage très inquiétant de Milady), et si Robinson Crusoé est devenu un mythe, c’est qu’il soulève des questions essentielles, universelles et intemporelles. Et les romans du Moyen Âge permettent de s’évader tout en étant de véritables quêtes de l’amour, de soi… • La science-fiction fait rêver et ouvre les yeux : 1984 de George Orwell est un roman d’anticipation dont la dimension est tragique ; tout en plongeant le lecteur dans un univers qui n’est pas le sien (mais ressemble déjà aux mondes totalitaires d’après-guerre et pourrait devenir le sien), il fait réfléchir le lecteur sur le totalitarisme, la liberté… • Les exemples d’héroïsme que l’on trouve dans les romans d’aventures, les romans de chevalerie, etc. donnent au lecteur la possibilité d’acquérir des valeurs de courage et d’ambition qui façonneront sa réalité. B. Roman et ouverture à une réalité extérieure à soi • Cependant, certains romans, parce qu’ils sont plus réalistes, nous rapprochent nécessairement davantage du réel, du quotidien, et sont plus tournés vers la réflexion que vers l’aventure. On y trouvera moins de péripéties, moins d’exceptionnel. Les écrivains réalistes, en choisissant des personnages qui ne sont plus des héros mais des « hommes ordinaires », permettent au lecteur de se rapprocher de tels personnages. Le lecteur est alors presque contraint de se poser des questions. • L’expression ouvrir les yeux du lecteur signifie « ouvrir les yeux et la pensée sur un monde encore inconnu ». La métaphore permet de supposer qu’ils étaient fermés ou voyaient mal. Cela donne une fonction didactique au roman, une fonction essentielle, le roman permettant de faire découvrir le monde, la vie, d’évoluer, de grandir… Il s’agit de faire réfléchir le lecteur sur le monde, de faire voir, découvrir, révéler le réel… • On peut alors différencier des réalités extérieures à soi et des réalités intérieures, bien que les frontières ne soient pas toujours évidentes : – Certains auteurs, comme Hugo ou Zola, estiment que leur mission, leur devoir est de dénoncer la misère, l’injustice, la peine de mort, la guerre… – Erich Maria Remarque, dans À l’ouest rien de nouveau, et Roland Dorgelès, dans Les Croix de bois, ont tous deux voulu, à travers leurs romans, dénoncer les horreurs de la guerre et peindre la vie et les désillusions de toute une génération ; ils ont aussi cherché à faire revivre leurs camarades disparus. Pour le lecteur qui les lit, ils sont un instrument de connaissance et de dénonciation unique et irremplaçable ; et c’est d’autant plus intéressant qu’ils appartiennent à deux nations opposées et qu’ils peignent exactement les mêmes souffrances. Primo Levi, Élie Wiesel, Jorge Semprun ont révélé à leur tour l’horreur des camps de concentration. Leurs romans « mémoire » ouvrent les yeux sur la vie passée, l’histoire de notre monde. De même, La Confession d’un enfant du siècle de Musset est considéré comme l’un des ouvrages le plus utiles pour comprendre ce qu’a ressenti toute la génération romantique.
Une vie – 33
• La littérature est alors un instrument de connaissance, un « révélateur ». Elle dénonce des maux, que le roman nous fait voir de l’intérieur. En cela, il est un instrument de connaissance extrêmement précieux, permettant de comprendre la complexité du monde et des êtres. C. Roman et ouverture à une réalité intérieure à soi • Le roman offre de vivre d’autres expériences : il permet un élargissement des connaissances, de vivre plusieurs vies, dans différents espaces et dans d’autres temps… • Le roman aide aussi le lecteur à réfléchir sur toutes les grandes questions existentielles et métaphysiques. Les romans déjà cités sur la guerre ou la misère mettent aussi le lecteur devant la question du mal. • S’opère alors le principe du roman « miroir », du retour sur soi. La lecture d’un roman donne l’occasion de mieux se connaître soi-même ou de se reconnaître, l’auteur ayant su trouver les mots pour exprimer ce que le lecteur n’avait pas su dire. Il peut aider à répondre à la question « Qui suis-je ? » mais aussi à mieux connaître les autres, autrui dans sa différence. • Il fait réfléchir le lecteur sur le cœur humain dans son évolution (le roman d’apprentissage, par exemple). • Le roman permet aussi de s’interroger sur les sentiments comme l’amour, l’amitié : – Les Liaisons dangereuses, tout en divertissant et séduisant le lecteur, le met face à des questions angoissantes sur l’amour, le mal, l’orgueil, etc. ; – les textes du corpus mettent le lecteur face à l’ennui, au mal de vivre ; – La Peste de Camus, en plongeant le lecteur dans une ville envahie par le mal et la mort, le fait entrer en lui-même ; les questions que se posent les personnages comme Rieux, Tarrou, le prêtre Paneloux sont des questions existentielles et métaphysiques sur le sens de la vie, Dieu, la mort, le bonheur, l’engagement, la liberté, l’héroïsme… que l’homme se pose toujours.
Conclusion La littérature a donc un double pouvoir extraordinaire : elle développe l’imagination des lecteurs, enrichit leur univers, le peuple même, une fois la lecture terminée (l’imaginaire étant une faculté qu’on a besoin de développer dans l’existence), et elle les fait réfléchir. Proust écrit : « Tant que la lecture est pour nous l’initiatrice dont les clefs magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n’aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire […] ; la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c’est la littérature » (Sur la lecture).
Écriture d’invention Les élèves doivent respecter la forme épistolaire et l’époque. Le langage doit être soutenu et les deux lettres argumentées. Il faudra adapter le style de la réponse à celui de l’écrivain choisi : plus romantique, plus lyrique, s’il s’agit de George Sand ou de Musset ; plus retenu, plus sobre, s’il s’agit de Flaubert ou de Maupassant. On valorisera les copies des élèves qui auront su proposer une argumentation approfondie, illustrée par des exemples précis, dans la mesure où il s’agit de défendre un point de vue à la fois sur l’existence et sur la littérature.
C h a p i t r e V I I I ( p p . 1 3 8 à 1 4 9 )
◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 150-151)
Un texte violent et choquant u Cet extrait est une peinture d’une souffrance si aiguë qu’elle étonne Jeanne et la terrasse, car, auparavant, elle n’en avait jamais connu de telle. C’est ainsi qu’elle se compare aussitôt à Rosalie et la souffrance est au centre de cette comparaison : elle « pensait sans cesse à Rosalie qui n’avait point souffert, qui n’avait presque pas gémi, dont l’enfant, l’enfant bâtard, était sorti sans peine et sans tortures ». L’une des premières expressions qui apparaît alors évoque aussitôt le paroxysme de la souffrance physique : le mot « tortures », employé au pluriel, fait aussitôt penser à une souffrance longue, profonde, insistante, insupportable. La souffrance de l’accouchement étant par phases, avec des périodes d’accalmie entre
Réponses aux questions – 34
les différentes contractions, le texte est lui aussi par étapes, suivant les différents paragraphes. L’accouchement proprement dit occupe en effet 6 paragraphes jusqu’à la délivrance (« et sa souffrance s’apaisa »). Elle apparaît de façon régulière dans les paragraphes 1 et 3, puis occupe, au moment même de la délivrance, les paragraphes 5 et 6. Elle est représentée de façon générale par le terme de « crise » qualifiée elle-même de « violente », celle-ci englobant toute une palette de souffrances : on retrouve au paragraphe suivant l’expression d’une immense souffrance intérieure avec le verbe déchirer à l’imparfait (ce qui implique une certaine durée), le mot « entrailles », puis l’adverbe « cruellement » précédé de l’adverbe d’intensité « si ». La douleur est telle que Jeanne ne devient plus que souffrance, se réduit à elle : « toute idée s’éteignait en elle ». Le rythme de la phrase suivante, qui est la dernière phrase du troisième paragraphe, et la restriction accentuent cette idée : « Elle n’avait plus de force, de vie, de connaissance que pour souffrir. » La dernière phase de l’accouchement, la plus intense, est introduite par la conjonction de coordination « mais » et par l’expression « une convulsion effroyable », expression suivie par le mot « spasme » et de l’adverbe d’intensité « si » devant l’adjectif « cruel ». C’est quasiment une souffrance inhumaine qui s’empare de tout son être jusqu’à lui donner l’impression de mourir, comme s’il lui semblait qu’on ne pouvait survivre à une telle douleur : moment paradoxal, puisque Jeanne croit mourir à l’instant où elle donne la vie. v Le corps féminin est évoqué de façon métonymique et quasiment objectivé. Elle-même a l’impression d’être séparée de son corps. Les cris lui échappent, indépendamment de sa volonté : on lit au paragraphe 1 que « les cris involontaires [de Jeanne] jaillissaient entre ses dents serrées ». Ce n’est pas un corps, mais un « ventre », des « entrailles ». C’est pourquoi on a l’impression que les personnes qui s’occupent d’elle la traitent non pas comme une personne mais la chosifient en quelque sorte, comme le montre le choix du verbe manier (« La garde et le médecin étaient penchés sur elle, la maniaient »). w Le texte étant en focalisation interne, l’enfant est désigné tel que Jeanne le perçoit. Or, au début, il n’est pas un enfant, mais la cause de sa souffrance, puis un être informe : ainsi, il est d’abord évoqué comme « l’enfant inconnu qui la tuait », puis comme un « fardeau ». Au moment où elle accouche, comme elle ne l’a toujours pas vu, il est désigné par le pronom indéfini « quelque chose » ; le narrateur évoque alors ses perceptions auditives et l’enfant apparaît à travers ses cris (« ce bruit étouffé qu’elle avait entendu déjà la fit tressaillir ; puis ce petit cri douloureux, ce miaulement frêle d’enfant nouveau-né lui entra dans l’âme »). Ce sont donc des perceptions aveugles mais qui, déjà, la troublent, l’attendrissent, l’émeuvent ; les expressions et les verbes sont en gradation : « ce bruit étouffé, ce petit cri douloureux, ce miaulement frêle d’enfant nouveau-né […] la fit tressaillir, lui entra dans l’âme ». Les expressions qui désignent l’enfant sont de plus en plus précises, ce qui montre la progression des perceptions et des sentiments de Jeanne. Enfin, lorsque Jeanne voit celui qu’elle considère déjà comme « son enfant », il est désigné par des expressions péjoratives qui mettent en valeur le contraste entre la laideur du nouveau-né et l’amour de Jeanne : « Il n’avait pas de cheveux, pas d’ongles, étant venu trop tôt ; mais lorsqu’elle vit remuer cette larve, qu’elle la vit ouvrir la bouche, pousser ses vagissements, qu’elle toucha cet avorton fripé, grimaçant, vivant, elle fut inondée d’une joie irrésistible ». x L’enfantement n’est donc pas évoqué de façon traditionnelle ou attendue. Nous n’assistons pas au bonheur d’une mère en admiration devant l’enfant qu’elle vient de mettre au monde, ni à son émerveillement devant ce miracle toujours renouvelé qu’est une naissance. Le texte est réaliste, voire naturaliste, et Maupassant a voulu défaire ce mythe pour montrer la souffrance de Jeanne et son immense solitude, au point qu’elle en vient à maudire son mari, son enfant, Dieu Lui-même.
Le désespoir de Jeanne y Jusqu’à maintenant, Jeanne apparaissait comme une jeune femme plutôt douce et soumise et qui manifestait peu de révolte et de violence. Mais, ici, la souffrance la déroute, accentue son désarroi et met en valeur la réalité d’une situation malheureuse, lui rappelant son immense solitude et l’infidélité de Julien. Jeanne se montre amère et jalouse en se comparant à Rosalie (1er paragraphe), puis elle se révolte contre Dieu et le destin (2e paragraphe) avec une extrême violence. Elle maudit aussi Julien (4e paragraphe) et l’enfant (5e paragraphe). Plus tard, lorsqu’elle se met à aimer l’enfant avec passion, nous retrouverons celle que nous connaissons. U Jeanne ressent son propre corps comme étant étranger (cf. question 2) : elle-même a l’impression d’être séparée de son corps. Les cris lui échappent, indépendamment de sa volonté (« Et Jeanne, dont les cris involontaires jaillissaient entre ses dents serrées »), puis il lui semble « soudain que tout son ventre se
Une vie – 35
vid[e] brusquement » (6e paragraphe). Nous avons constaté aussi (cf. même question) que son corps est morcelé, n’est que souffrance (« dans tout son pauvre corps épuisé »). Son corps ne reprendra vie que lorsqu’elle commencera à aimer son enfant ; elle ressentira alors pour lui un amour où seront mêlés corps et âme (« Son cœur et sa chair se ranimaient, elle se sentait mère ! »). V Jeanne est jalouse de Rosalie (cf. question 1) parce qu’elle n’a pas souffert en accouchant. Le souvenir de cette absence de souffrance ne fait que renforcer une jalousie déjà existante, due à l’infidélité de Julien. Ainsi, Rosalie est désignée avec des termes qui mettent en valeur sa condition sociale, jugée par Jeanne comme étant inférieure à la sienne. Pourtant, Jeanne considérait Rosalie à la fois comme sa servante et comme sa sœur. Mais sa souffrance lui fait oublier ce dernier point : Rosalie n’est plus que « sa bonne », « cette fille étendue », « l’autre ». Le narrateur insiste à deux reprises sur le fait que la pensée de Rosalie est presque obsessionnelle : à l’expression adverbiale « sans cesse » répond l’adjectif « incessante » (« pensait sans cesse à Rosalie » ; « Dans son âme misérable et troublée, elle faisait entre elles une comparaison incessante »). La suite de la phrase (« qui n’avait point souffert, qui n’avait presque pas gémi, dont l’enfant, l’enfant bâtard, était sorti sans peine et sans tortures ») a un rythme particulier et très régulier, fait de parallélismes syntaxiques et de structures binaires. Le lecteur entre dans la pensée troublée de Jeanne et assiste à son cheminement, à sa progression. Sa jalousie est aussi liée à un sentiment terrible d’injustice, d’autant plus qu’elle estime avoir en quelque sorte plus de droits qu’elle, puisqu’elle porte en elle un enfant légitime, tandis que l’enfant de Rosalie n’est qu’un « bâtard ». C’est pour cette raison qu’elle en veut à Dieu qu’elle juge injuste (« elle maudissait Dieu, qu’elle avait cru juste autrefois ; elle s’indignait des préférences coupables du destin »). W De façon étonnante (cf. plus haut), Jeanne maudit Dieu et en veut aux prêtres. Sa souffrance est telle qu’elle se sent soudain abandonnée de tous et même maltraitée, d’autant plus que se mêlent en elle une souffrance physique au paroxysme et une immense souffrance morale (« Dans son âme misérable et troublée, elle faisait entre elles une comparaison incessante »). L’enfant n’étant pas encore né et Jeanne ignorant le bonheur d’être mère, toutes ces souffrances lui apparaissent comme absurdes et révoltantes : « elle maudissait Dieu, qu’elle avait cru juste autrefois ; elle s’indignait des préférences coupables du destin, et des criminels mensonges de ceux qui prêchent la droiture et le bien ». Encore une fois, nous lisons dans la pensée « troublée » de Jeanne qui oppose sa vision d’autrefois (« qu’elle avait cru juste autrefois ») à sa vision d’aujourd’hui et se révolte : Dieu, le destin, les prêtres sont devenus injustes, coupables et menteurs, puisqu’ils prêchent le contraire de ce qu’ils font (« et des criminels mensonges de ceux qui prêchent la droiture et le bien »). X La pensée de Rosalie et l’attitude de Julien lui permettent de voir ce dernier autrement : elle pense à lui au moment où sa douleur s’apaise. Elle est alors plus lucide et peut réfléchir (« Dans les minutes d’apaisement, elle ne pouvait détacher son œil de Julien »). Cette pensée provoque en elle une autre sorte de douleur mais non moins intense, comme le montrent la répétition du mot « douleur » et le verbe étreindre (« et une autre douleur, une douleur de l’âme l’étreignait »). Elle fait alors un parallèle entre les deux accouchements – celui de Rosalie et le sien – et analyse l’attitude de Julien comme étant la même. Le narrateur insiste sur cette similitude avec le verbe se rappeler et l’adjectif « même » (« se rappelant ce jour où sa bonne était tombée aux pieds de ce même lit »). De la même façon, au verbe se rappeler répond le verbe retrouver. Jeanne a en effet cette particularité : elle est douée d’une excellente mémoire (« elle retrouvait avec une mémoire sans ombres ») et se souvient exactement de ce qui s’est passé lors de l’accouchement de Rosalie, ce qui lui permet de comparer les deux scènes. Cette faculté ne l’aide pas mais la fait davantage souffrir tout au long du roman. Jeanne fait donc un parallèle constant entre elle et Rosalie et entre le Julien d’alors et celui d’aujourd’hui : « Elle retrouvait […] les gestes, les regards, les paroles de son mari devant cette fille étendue. » L’énumération au pluriel met en valeur sa capacité à tout retrouver. « Et maintenant elle lisait en lui, comme si ses pensées eussent été écrites dans ses mouvements » : le verbe lire (qui apparaît deux fois) est ici métaphorique et montre à quel point Jeanne est lucide et presque détachée. Julien n’est plus « Julien » mais « son mari » et un homme « égoïste ». On retrouve l’adjectif « même » en anaphore dans cette dernière phrase, le rythme, à nouveau ternaire, lui donnant de l’ampleur : « elle lisait le même ennui, la même indifférence pour elle que pour l’autre, le même insouci d’homme égoïste, que la paternité irrite ». Jeanne est ici clairvoyante et juge Julien avec la sévérité qu’il mérite ; tout le condamne en effet, et, notamment, ces termes en gradation : « ennui », « indifférence », « insouci », « irrite ». Le terme rare « insouci » souligne son indifférence.
Réponses aux questions – 36
at Jeanne est extrêmement seule dans ce passage, et le lecteur entre dans sa souffrance et dans sa solitude. Non seulement elle souffre seule (ce qui est existentiellement prévisible), mais encore rien ni personne ne peut la soulager moralement. Le texte est constitué d’une suite de paragraphes dont elle est le centre et qui donnent l’impression qu’elle est totalement seule. Elle est, en effet, entourée d’étrangers : la garde et le médecin qui, comme nous l’avons déjà vu, la « manient » comme un objet et Julien qui ne ressent qu’ennui.
La découverte de la maternité ak Lorsque Jeanne, enfin, accouche, tout va changer. Le narrateur indique très précisément le moment où cesse la douleur : « Et sa souffrance s’apaisa. » C’est le premier tournant du texte. Le deuxième tournant apparaît aux premiers cris de l’enfant avec l’expression « et bientôt » suivie de l’adverbe « puis » ; un nouveau « et » introduit un autre tournant : « et bientôt ce bruit étouffé qu’elle avait entendu déjà la fit tressaillir ; puis ce petit cri douloureux, ce miaulement frêle d’enfant nouveau-né lui entra dans l’âme, dans le cœur, dans tout son pauvre corps épuisé ; et elle voulut, d’un geste inconscient, tendre les bras. Ce fut en elle une traversée de joie » (cf. questions 3 et 12). al Jeanne perçoit l’enfant progressivement : il est d’abord évoqué non pas comme un enfant mais comme un « fardeau », puis comme étant tout à fait indéfini (« quelque chose »). Puis Jeanne entend l’enfant crier et est particulièrement attentive à ses cris ; l’enfant n’est toujours pas vu comme un enfant mais comme une série de cris (« ce bruit étouffé » qui devient un « cri douloureux, ce miaulement frêle d’enfant nouveau-né »). Lorsqu’elle voit l’enfant, le narrateur emploie des termes encore péjoratifs : il y a en effet une opposition entre celui que Jeanne appelle déjà « son enfant » et les termes de « larve », puis d’« avorton fripé, grimaçant, vivant ». L’opposition est en effet due au contraste entre l’intensité de l’amour qu’elle éprouve soudainement et l’enfant tel qu’il est évoqué ; l’emploi de la conjonction « mais » souligne ce paradoxe : « Elle voulut connaître son enfant ! Il n’avait pas de cheveux, pas d’ongles, étant venu trop tôt ; mais lorsqu’elle vit remuer cette larve, qu’elle la vit ouvrir la bouche, pousser ses vagissements, qu’elle toucha cet avorton fripé, grimaçant, vivant, elle fut inondée d’une joie irrésistible ». am Jeanne éprouve alors un bonheur immense qui fait contraste avec sa douleur passée. Le passage des lignes 3533 à 3542 propose une accumulation de termes appartenant au champ lexical de la joie : « une traversée de joie » ; « un bonheur nouveau » ; « délivrée, apaisée, heureuse, heureuse » ; « se ranimaient » ; « elle fut inondée d’une joie irrésistible » ; « elle était sauvée » ; « garantie contre tout désespoir ». La gradation « délivrée, apaisée, heureuse, heureuse » terminée par une répétition souligne l’idée d’une joie qui atteint rapidement son paroxysme. Une sorte de résurrection vient de s’opérer (« Son cœur et sa chair se ranimaient ») et le bonheur ressenti est « un bonheur nouveau », comme le montre l’hyperbole « comme elle ne l’avait jamais été ». La métaphore de l’éclosion souligne cette idée de nouvelle naissance : Jeanne renaît en même temps que cet enfant qui vient de naître. Les phrases rapides et constituées pour la plupart d’indépendantes juxtaposées permettent au lecteur de comprendre comment la pensée de Jeanne évolue et comment la joie en elle progresse et s’épanouit. L’expression « traversée de joie » montre à quel point cette joie l’envahit et la suite de la phrase nous conforte dans l’idée qu’elle la comble : « elle fut inondée d’une joie irrésistible ». an Tout l’extrait est organisé autour de la douleur et de la solitude de Jeanne. Or, soudain, lorsque l’enfant apparaît, tout s’inverse : Jeanne semble oublier tout ce qui vient de se passer ; son cœur semble neuf ; elle éprouve une joie immense qui la traverse, la transcende (cf. question précédente). ao Depuis son retour de voyage de noces, la vie de Jeanne a basculé : elle a découvert l’ennui, un ennui profond et d’autant plus difficile à combattre qu’il semble sans cause ; Julien l’a trompé avec Rosalie et ne se comporte pas comme elle l’imaginait ; son mariage est un échec et Jeanne se sent affreusement seule. Tout cela l’a tellement désespérée qu’elle a même désiré se suicider et est tombée gravement malade. La venue de cet enfant et la découverte de l’amour maternel lui procurent une joie à la fois immense et inattendue. Elle pense alors être sauvée de l’ennui et du désespoir et avoir trouvé un nouveau sens à sa vie. L’amour qu’elle ne ressent plus pour son mari est remplacé par ce nouvel amour et l’idée d’élever cet enfant lui donne une occasion inespérée de s’occuper et de tromper l’ennui des jours : « elle comprit qu’elle était sauvée ». La suite de la phrase en révèle le sens : « garantie de tout désespoir, qu’elle tenait là de quoi aimer à ne savoir plus faire autre chose ». De plus, la
Une vie – 37
maternité, pour elle, fait figure de religion. Jeanne va « adorer » cet enfant, lui vouant une sorte de culte. ap Ce passage est donc, comme nous venons de le voir, un jalon essentiel de la vie de Jeanne. Elle va pouvoir rêver à nouveau et tout le « processus » qui s’était déclenché pour l’amour conjugal va recommencer pour l’amour maternel. Ce que le lecteur voit naître dans ce passage, cette joie, cet amour seront vite excessifs et délétères. Elle ne saura pas élever cet enfant, et, malheureusement, ce bonheur espéré ne se réalisera pas. Paul la rendra malheureuse : ce nouveau malheur, cette nouvelle déception ne feront que s’ajouter aux autres.
◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 152 à 160)
Examen des textes u Ce texte est tellement différent des autres qu’il est difficile de le comparer avec eux. Cette scène paysanne est vue par un regard externe et composée d’une alternance de dialogues et de narration, tandis que, dans les autres extraits, le point de vue est soit interne, soit omniscient et place le lecteur dans l’intimité du personnage, que ce soit dans sa souffrance ou dans sa joie. Le registre de langue est ici familier et l’atmosphère plus que triviale, alors que les autres textes sont écrits dans un registre de langue soutenu et élégant, voire poétique, avec un grand nombre de comparaisons et de métaphores. « Et il était à crever de rire, tout nu dans son tablier, les bras, le visage, le corps entier barbouillé de fiente […]. Mais ce fut le comble, lorsque le vétérinaire, ayant posé le veau devant lui, voulut essuyer d’un revers de main la sueur qui lui coulait du front. Il se balafra d’une large traînée de bouse » : ici, les comparaisons et les métaphores sont, elles aussi, crues. Elles font de cette scène d’accouchement une scène quotidienne, pas plus émouvante qu’une mise bas animale : « tous se tordirent, l’accouchée suffoqua, pouffa avec des cris aigus de poule qui pond ». L’homme et la bête ne diffèrent pas. Zola, fidèle au naturalisme dont il est le chef de file, a voulu montrer la réalité d’une scène paysanne telle qu’elle est vécue et non telle qu’on l’imagine. Refusant toute idéalisation, tout embellissement du réel, il se veut le peintre d’une scène de vie. Pour Lise, accoucher n’est pas un événement qui va transcender sa vie mais un moment difficile et douloureux physiquement. L’atmosphère de « rigolade » générale lui fait vivre sa douleur autrement : « Oh ! là, là, que je souffre, ça me fend !… Non ! non ! ne me faites donc plus rire, je vas y rester ! » Dans les autres textes du corpus, tout ce qui peut choquer ou avoir trait au corps de façon objective ou crue est gommé (cf. lecture analytique et questions suivantes). Zola fait exactement le contraire : « Les rires ronflaient au fond de sa poitrine grasse, descendaient dans son ventre, où ils poussaient d’un souffle de tempête. Elle en était ballonnée, et la tête de l’enfant avait repris son jeu de pompe, comme un boulet près de partir » ; « la mère, secouée comme une outre dont la peau se dégonfle ». Ici, Lise accouche en même temps qu’une vache met bas. Il y a là plus qu’une comparaison entre la femme et l’animal, puisque le regard du narrateur, comme ceux des paysans qui assistent à la scène, vont de l’un à l’autre, à tel point que les deux « accouchements » tendent à se confondre. Tandis que les autres textes sont centrés sur la souffrance de la femme et sur la découverte inouïe de la joie de mettre au monde, celui-ci met l’accent sur l’incongruité de la scène et sur la joie de Lise, mais une joie grossière et sans nuance, qui n’est pas due à la naissance de l’enfant mais à l’atmosphère d’euphorie générale qui l’entoure. Dans les autres textes, le corps de la femme est souffrant et parfois morcelé, mais il reste un corps de femme. Dans celui-ci, le corps de Lise n’est plus un corps, mais « un trou béant » par lequel va sortir l’enfant. Nous avons donc une scène envisagée et réalisée par Zola comme étant totalement décalée par rapport aux autres. v Les textes de Balzac et de Le Clézio insistent d’autant plus sur la souffrance des femmes qu’ils décrivent le moment proprement dit de l’accouchement, où les contractions sont beaucoup plus fréquentes et plus douloureuses : « Quand la crise est venue […] la souffrance a éclaté » (texte B) ; « C’est le moment où les spasmes deviennent d’un seul coup violents, terribles » (texte E). Dans les deux textes, on trouve une grande abondance de termes appartenant au champ lexical de la souffrance et, plus précisément, d’une souffrance à son paroxysme : chez Balzac, Renée parle de « telles douleurs » et décrit une douleur qui va jusqu’à une torture (cf. l’analyse du mot « torture » chez Maupassant)
Réponses aux questions – 38
qualifiée d’« horrible » ; Le Clézio, de la même façon, qualifie la douleur de « violente », de « terrible », d’« extrême ». Renée (texte B) utilise aussi des hyperboles pour montrer à quel point toute cette souffrance est inimaginable ou indicible : « un anéantissement dont les effets ont été ceux d’un rêve » ; « Non, rien ne peut te peindre ce moment : il me semblait que le monde entier criait avec moi, que tout était douleur ou clameur ». Sa douleur est telle que son corps ne semble plus lui appartenir, comme si elle était coupée en deux : « Je me suis sentie être deux : une enveloppe tenaillée, déchirée, torturée ». Comme dans le texte de Maupassant, elle a l’impression qu’elle ne survivra pas à une telle souffrance (« une douleur, qui m’a fait croire à une mort immédiate, a éclaté. J’ai poussé des cris horribles, et j’ai trouvé des forces nouvelles contre de nouvelles douleurs »). Les deux femmes entendent aussi leurs propres cris comme s’ils étaient étrangers : « Cet affreux concert de clameurs » (texte B) ; « Parfois, entre ses dents serrées, un cri s’échappe malgré elle, étouffé par le bruit de la mer. C’est un cri de douleur et de détresse à la fois » (texte E). w Dans ces deux textes, la douleur des femmes est évoquée à travers de nombreuses métaphores. Nous avons déjà commenté dans la question 2 l’hyperbole « un anéantissement dont les effets ont été ceux d’un rêve ». Puis le personnage utilise la métaphore filée de la souffrance, qui devient une fleur, une rose rouge. L’image est très riche sémantiquement et symboliquement : la comparaison avec une couronne fait aussitôt penser à la passion du Christ et à la couronne d’épine (« Dans cet état bizarre, la souffrance a fleuri comme une couronne au-dessus de ma tête »). La rose, qui peut être connotée de façon positive, ne l’est pas ici : elle grandit, s’épanouit jusqu’à écraser Renée ; elle est rouge comme le sang (« La couleur rose de cette fleur sanglante était dans l’air. Je voyais tout rouge »). On trouve cette même symbolique des couleurs dans le texte de Le Clézio (texte E) : à plusieurs reprises la douleur est rouge (« et la douleur est semblable à la grande lumière rouge qui aveugle » ; « La couleur sanglante de la douleur est devant elle »). Au moment où Renée découvre son enfant, tout change, et pour montrer l’intensité et la perfection de son bonheur, elle le compare à l’entrée au paradis et utilise implicitement la symbolique de l’opposition classique entre les ténèbres et la lumière : « où je suis entrée comme dans un paradis » ; « Ces ténèbres ont été animées par une sensation dont les délices ont surpassé celles du premier cri de mon enfant ». Il s’agit alors pour elle d’une renaissance, d’une nouvelle éclosion de son « moi » à la lumière, comme un papillon qui sort de son cocon ou comme une fleur, connotée cette fois-ci de façon positive : « Mon cœur, mon âme, mon être, un moi inconnu a été réveillé dans sa coque souffrante et grise jusque-là, comme une fleur s’élance de sa graine au brillant appel du soleil. » Le texte de Le Clézio est encore plus métaphorique et poétique. Le point de vue n’étant en rien réaliste, les métaphores sont filées et traversent en quelque sorte le texte, atteignant de la même façon le ciel, la mer, la nature et la jeune femme qui accouche, seule, accrochée à un arbre. Ainsi, le narrateur décrit d’abord le ciel et une telle description prend aussitôt une triple dimension : esthétique, poétique et symbolique. Lalla va mettre au monde son enfant en même temps que le jour se lèvera. Ce sera une double aurore. Les images sont nombreuses : on retrouve la symbolique des couleurs et notamment du rouge ; symbolique qui est liée à celle du feu, lorsque le monde s’embrase. D’autres comparaisons permettent de préciser les perceptions et les sentiments : ainsi, les odeurs du sucre et de la sève lui semblent « familières » et, sous l’effort, les « tendons de ses bras [sont] durcis comme des cordes ». « Avec des gestes d’aveugle », elle « se laisse glisser en arrière ». x Ce texte est très différent des autres textes du corpus et très original, voire unique. Dans tous les textes, quel que soit le point de vue choisi (externe, interne, ou omniscient – cf. les autres questions), la scène est centrée sur la femme qui accouche, alors que celui de Colette met en scène deux autres personnages : sa mère et sa sœur, la narratrice. En outre, ce n’est pas un extrait d’un roman mais d’une autobiographie : Colette, devenue adulte, raconte ce qu’elle a vécu enfant et, plus exactement, la scène à laquelle elle a assisté en cachette. Les deux personnages se trouvent dans une situation exceptionnelle : la fille aînée de Sido, la mère de Colette, étant fâchée avec sa famille, accouche loin d’elle ; sa mère ne peut pas assister à son accouchement et, par conséquent, ni partager avec elle sa souffrance, ni tenter de la soulager. Nous ne percevons de l’accouchement que ce qu’en perçoivent les personnages, c’est-à-dire des cris. Colette choisit alors de nous décrire une scène qui l’a bouleversée : sa mère, descendue dans le jardin, guette les signes de l’accouchement de sa fille et va l’accompagner de façon symbolique ; physiquement, elle se trouve loin d’elle mais, dans son cœur et dans son corps, elle est auprès d’elle, vivant ce qu’elle vit, dans une magnifique empathie maternelle : elle va en quelque sorte accoucher avec elle, de loin, en refaisant et en vivant avec son corps les mouvements de la femme qui enfante (« Alors je vis ma mère […] »).
Une vie – 39
y Comme nous venons de le voir, les métaphores sont filées et traversent en quelque sorte le texte, atteignant de la même façon le ciel, la mer, la nature et la jeune femme qui accouche, seule, accrochée à un arbre. Certes, Lalla est seule mais la nature l’entoure et elle est tellement en fusion avec elle que l’accouchement redevient un acte totalement naturel et l’homme un être lié à la nature et pouvant être confondu avec elle. Le narrateur ne décrit jamais Lalla et ses gestes seuls, mais il va de la nature à elle, d’elle à la nature, sans qu’il y ait jamais rupture. L’un des éléments avec lequel elle est le plus liée est l’arbre auquel elle s’accroche ; elle fait corps avec lui : « l’arbre bouge et […] le corps se soulève » ; « À chaque extrême douleur, […] Lalla se suspend à la branche de l’arbre » ; « Elle tire sur la maîtresse branche » ; « Ses reins cognent contre le tronc du figuier, […] ses reins et son dos touchent les racines du figuier ». Elle s’imprègne de son odeur et de sa sève avec sensualité et plaisir : « À petites goulées, Lalla respire son odeur, l’odeur du sucre et de la sève, et c’est comme une odeur familière qui la rassure et l’apaise. » Non seulement son corps ne fait plus qu’un avec l’arbre, mais elle retrouve ce contact charnel avec d’autres éléments de la nature comme la rosée : « les gouttes de rosée continuent à pleuvoir sur ses mains, sur son visage, sur son corps ». La phrase, par son rythme ternaire et ses anaphores, donne une impression d’abondance et même de plénitude. Dans cette union constante avec la nature, les fourmis, qui sont décrites dans la phrase suivante, ne semblent pas la déranger. Au début du passage, le narrateur décrit longuement le ciel. Il n’évoque Lalla qu’après : elle fait partie du paysage. Il décrit d’abord la couleur rouge du ciel (cf. question 4). Plus l’accouchement avance, plus le ciel change. Le jour se lève en même temps que l’enfant naît. Le passage, en effet, s’achève ainsi : « elle entend le cri aigu de l’enfant qui commence à pleurer. Sur la plage, la lumière rouge est devenue orange, puis couleur d’or ». Cette transformation du ciel est inséparable de celle de la mer : « La mer devient plus sombre, presque violacée, tandis que, au sommet des vagues, s’allument les étincelles de pourpre, et que l’écume resplendit encore plus blanche. » Et le narrateur, avec lyrisme, en décrit la splendeur. C’est une succession de tableaux aux couleurs changeantes. Lalla est à la fois attentive, sensible à sa beauté et unie à elle : « Jamais Lalla n’a regardé avec autant de force l’arrivée du jour, les yeux dilatés, douloureux, le visage brûlé par la splendeur de la lumière » ; « la couleur sanglante de la douleur est devant elle, sur la mer, dans le ciel, dans l’écume de chaque vague qui déferle ». Le rythme des phrases et les répétitions accentuent cet effet d’osmose déjà constaté. À ces perceptions visuelles, olfactives et tactiles s’ajoutent des perceptions auditives : les cris de Lalla se mêlent au bruit de la mer (« un cri s’échappe malgré elle, étouffé par le bruit de la mer »).
Travaux d’écriture
Question préliminaire La façon dont les sentiments des mères pour leurs enfants apparaissent diffère suivant les textes. Le texte de Zola (texte C) étant en focalisation externe et Lise n’exprimant pas d’émotion à l’occasion de son accouchement (cf. question 1), il est difficile de savoir ce qu’elle ressent. Elle rit beaucoup et se plaint de souffrir tout en riant, désignant la cause de sa souffrance par le pronom démonstratif « ça ». Ce pronom, très vague, peut désigner soit l’accouchement, soit la douleur, soit l’enfant. Seules les paroles qu’elle prononce en apprenant que l’enfant est une fille montrent une déception qui va presque jusqu’au rejet de l’enfant : « Non, non, dit Lise, je n’en veux pas, je veux un garçon. » Dans le texte de Le Clézio (texte E), les sentiments pour l’enfant ne sont pas vraiment exprimés, l’enfant n’apparaissant qu’aux dernières lignes du texte et le narrateur ne mentionnant qu’une perception auditive : « L’air rentre enfin dans ses poumons, et […] elle entend le cri aigu de l’enfant ». Cependant, la description du ciel qui devient « couleur d’or » peut être interprétée métaphoriquement ou symboliquement (cf. questions 4 et 5) : « Sur la plage, la lumière rouge est devenue orange, puis couleur d’or. » Cette phrase, qui fait à elle seule un paragraphe et apparaît à la fois comme une conclusion et comme un commencement, évoque une telle beauté de la naissance du jour qu’elle contient en elle une sorte d’euphorie devant tant de splendeurs. Il est tout à fait possible, dans un texte où la femme est totalement en fusion avec le monde, le cosmos, d’interpréter cette phrase comme évoquant aussi le bonheur maternel. Les textes de Maupassant (texte A) et de Balzac (texte B) sont construits de la même façon : ils décrivent l’extrême douleur de la mère, puis son apaisement, et enfin la joie de la mère alors que l’enfant est encore très laid. Son arrivée est décrite chez Maupassant comme une explosion de joie (cf. questions 3 et 12 à 15 de la lecture analytique). De la même façon, Renée évoque l’arrivée de l’enfant comme une joie des plus intenses (cf. le relevé des images et des métaphores : « je suis entrée
Réponses aux questions – 40
comme dans un paradis »). Cependant, les deux auteurs soulignent le même paradoxe : les deux femmes sont surprises de l’aspect de l’enfant qu’elles trouvent laid, contrairement à ce qu’elles imaginaient. Ainsi Renée (texte B) s’exclame : « j’ai crié d’effroi. – Quel petit singe ! […] désolée de ne pas me sentir plus mère que cela. » Puis elle le désigne par l’expression « petit monstre » et souligne elle-même qu’elle ne s’est pas sentie mère aussitôt. Mais, à partir du moment où l’enfant prend le sein, la mère se sent envahie par la joie et un amour démesuré et instinctif : « voilà le fiat lux ! J’ai soudain été mère. Voilà le bonheur, la joie, une joie ineffable ». L’anaphore de « voilà » et de la forme emphatique met en valeur l’idée qu’il s’agit bien de la découverte d’un nouveau bonheur et d’une nouvelle façon d’aimer. Le texte de Colette (cf. question 4) est différent des autres, puisqu’il s’agit de la mère de celle qui accouche. Nous avons là, sans doute, l’une des scènes d’amour maternel la plus originale et la plus émouvante, d’autant plus que Sido est observée par l’une de ses filles : son impuissance désespérée, puis son inquiétude et son attente en sont les signes (« je la vis lever la tête, […] comme si elle espérait le [le mur] franchir. Puis elle alla et vint dans la courte allée […]. Sous la lumière […], aucun de ses gestes ne m’échappait. Immobile, la face vers le ciel, elle écoutait »). Plus tard, lorsqu’elle mime les gestes de la femme qui enfante, elle accomplit un acte d’amour silencieux, à la fois magnifique et inutile (cf. question 5). Le tableau représente une jeune femme à demi allongée, portant sur son ventre un nouveau-né. L’enfant dort, la tête sur la poitrine de sa mère. Le tableau offre une image particulièrement sereine de ce thème traditionnel en peinture. La mère a les yeux baissés sur son enfant qu’elle entoure de ses deux bras. Ce visage légèrement penché semble exprimer un ravissement, une joie profonde. La mère et l’enfant sont si parfaitement en harmonie l’un avec l’autre qu’ils semblent inséparables. Le fait qu’elle l’ait placé ainsi sur son ventre évoque pleinement la maternité. Un livre ouvert derrière elle montre qu’elle a sans doute abandonné sa lecture pour goûter ce moment de solitude et de plénitude avec son bébé. Jean-Louis Hamon, peintre du XIXe siècle, a été influencé par la peinture italienne. Ce visage ovale aux traits fins, doux et réguliers, encadré par des cheveux séparés en deux bandeaux par le milieu, cette attitude (yeux baissés sur l’enfant) rappellent très nettement les madones italiennes de Raphaël ou de Léonard de Vinci. Ce beau visage virginal aux traits si doux contribue à l’atmosphère paisible qui se dégage de l’ensemble. Il semble évident que l’amour, la quiétude et le bonheur sont les sentiments dominants.
Commentaire
Introduction Sido, la mère de Colette, est au centre de La Maison de Claudine : elle est le fil conducteur de ce récit autobiographique formé de petits chapitres qui semblent sans lien explicite les uns avec les autres. Le lien le plus fort est la présence constante de Sido et de l’enfance. Colette, qui vénérait sa mère, la présente comme un modèle maternel. Dans cet extrait, très original, l’amour de Sido s’exprime de façon unique. Observée par Colette enfant, depuis sa fenêtre et en pleine nuit, elle va se révéler par une série d’attitudes et de gestes, magnifiquement rendus par l’écriture précise et sensible de Colette.
1. Un récit rétrospectif à la 1re personne A. Un récit autobiographique • La maison de Claudine est un récit autobiographique : – Comme dans tous les récits autobiographiques, le texte est à la 1re personne et la focalisation est interne. Nous ne saurons et ne verrons que ce que la petite Colette a vu. Le lecteur doit se contenter d’une seule vision et de l’interprétation proposée par la narratrice. – Quand on lit un texte autobiographique, il faut partir du principe qu’il est possible qu’il y ait un décalage entre la perception enfantine et celle que l’adulte a reconstituée et retranscrite par l’écriture. Il est possible qu’elle n’ait compris qu’après coup le sens de ce qui se passait à ce moment-là. Nous avons donc ici la vision d’une petite fille, émue par les gestes de sa propre mère. Le texte est le résultat de cette vision et du travail de réécriture de l’écrivain. • Colette craignait qu’il fût impossible de faire revivre le passé par les mots, comme elle l’a écrit dans l’incipit de La Maison de Claudine. C’est pourquoi, soucieuse de reconstituer le passé tel qu’il était, elle situe précisément chaque personnage, mettant parfaitement tout cela en scène : – Elle est dans le noir, immobile, silencieuse, et domine la scène.
Une vie – 41
– Elle est vigilante, attentive. On est en présence sans doute d’une double volonté : la première est celle de la petite fille qui pressent qu’elle va assister à quelque chose d’exceptionnel, qui épie les moindres gestes de sa mère et est sensible à l’atmosphère de cette nuit dans tous ses détails, n’ayant que cela pour comprendre ; la seconde est celle de l’écrivain, qui, devenu adulte, tente de recréer par l’écriture une scène telle qu’elle a été vécue et essaie de la transmettre au lecteur, de la lui faire vivre. – Colette met donc en scène ce moment en précisant où elle se trouve et dans quelle atmosphère : « ma chambre, l’une des trois chambres qui donnaient sur le jardin d’En-Face ». Elle fera deux fois allusion à ce jardin. Il s’agit là d’un vocabulaire d’initié qu’elle reproduit, soucieuse de recréer une atmosphère ; ce « surnom » est sans doute très évocateur pour elle et les siens ; le lecteur comprend assez vite que le jardin ainsi appelé est celui qui se trouve en face de leur maison, tout près de celle de la grande sœur de Colette, Juliette, que l’auteur appelle « ma sœur aux longs cheveux » : il est ainsi introduit dans une atmosphère intime, un monde privé, personnel, partageant le même vocabulaire « codé » avec la famille de Colette. – De même, la maison de la grande sœur est qualifiée de « mystérieuse », c’est-à-dire avec un adjectif qui l’évoque telle que Colette la voyait : « la maison mystérieuse qui tenait clos tous ses volets ». Cette phrase a une très belle cadence, poétique, rendue par l’antéposition de l’adjectif « clos » et par la régularité de rythme : on pourrait séparer la phrase en deux octosyllabes, en faisant une diérèse sur « mystérieuse ». Sa beauté est aussi due à la précision des mots : aucun mot n’est inutile ; Colette a choisi le mot et les sonorités qui lui semblaient les plus justes (« au bout d’un jardin violacé de lune »). B. L’observatrice • La particularité de cette scène vient du fait qu’elle est observée par une enfant qui se cache. • La place de Colette est particulière en effet : elle est en hauteur, à la fenêtre, dans l’obscurité (« Ayant éteint ma lampe »). Elle domine donc la scène. • Comme nous l’avons dit précédemment, elle va précisément planter le décor : la rue, le jardin, le mur, et l’ensemble est vu d’une position surélevée. • La petite Colette a aussitôt senti qu’il se passait quelque chose d’exceptionnel (« Je compris vaguement et je gagnai, plus tôt que d’habitude, ma chambre »), mais l’adverbe « vaguement » précise qu’il s’agit plus d’une intuition que d’une certitude. • L’enfant est attentive : extrêmement sensible et émue, elle remarque tout, note tout (« j’ouvris ma fenêtre pour guetter », « j’écoutais », « lui parvint en même temps qu’à moi ») ; elle s’étonne des changements d’attitude maternels, les introduisant, les mettant en scène, comme le montre ici l’adverbe : « Alors je vis ma mère » ; elle est à l’affût du moindre geste (« aucun de ses gestes ne m’échappait »). C’est pourquoi on peut parler, pour ce passage, de « théâtralisation ». • La petite fille est émue et se cache : « Ayant éteint ma lampe, j’ouvris ma fenêtre pour guetter » ; « J’écoutais, comprimant mon cœur battant contre l’appui de la fenêtre ». Son émotion transparaît à travers le rythme de la phrase et la succession de dentales qui mettent en valeur les battements du cœur – une émotion qu’on retient. Elle a sans doute l’impression de transgresser un interdit, d’assister à une scène unique à laquelle elle n’a pas vraiment le droit d’assister, et a peur de se faire repérer. • Ainsi, rien ne va lui échapper et elle reproduit fidèlement les étapes de cette scène : dans les premières lignes, elle campe le décor. L’arrivée de sa mère et son changement d’attitude sont précédés à deux reprises par l’adverbe de temps puis. Les autres étapes sont signalées par un verbe de perception ou de mouvement au passé simple (« Je la vis lever la tête », « Un long cri aérien […] lui parvint », « Un second cri »). Sa réaction aux cris de sa fille est introduite par un autre adverbe qui annonce un changement plus important : « Alors je vis ma mère ». • Les actions sont rapides : il y a beaucoup de verbes au passé simple et les phrases sont à peine coordonnées les unes aux autres. Colette retranscrit sa propre émotion, sa propre attente, et ménage savamment celles du lecteur, rendant ce passage particulièrement vivant et intense. C. Une atmosphère nocturne Colette est ainsi soucieuse de recréer une atmosphère particulière parce qu’elle est à la fois nocturne, mystérieuse et tendue : – La lune donne un éclairage particulier, mis en valeur dans la phrase : « au bout d’un jardin violacé de lune, la maison mystérieuse qui tenait clos tous ses volets » ; puis elle est à nouveau mise en valeur par l’oxymore « lumière froide ». – C’est une nuit marquée par le silence (« La nuit villageoise imposait son silence ») et personnifiée ; l’on remarque la force du verbe imposer et l’imparfait qui marque la durée.
Réponses aux questions – 42
– La nuit, les bruits sont plus audibles et distincts, nettement détachés, et la petite Colette est attentive au moindre d’entre eux, à tout ce qui se passe, même ce qui peut sembler sans importance et qui, encore une fois, contribue à recréer une atmosphère : ce sont des bruits typiques de la campagne ; le peu de bruits est mis en valeur par la forme restrictive « je n’entendis que » ; chacun est unique et précis – d’où l’emploi des articles définis (« l’aboiement d’un chien, les griffes d’un chat »). – De la même façon, les perceptions visuelles sont particulières. L’arrivée de sa mère est introduite progressivement, suivant le regard de l’enfant : c’est d’abord une silhouette, aussitôt reconnue et mise en valeur entre tirets (« Puis une ombre en peignoir blanc – ma mère – traversa la rue, entra dans le jardin d’En-Face »). – L’expression « ombre en peignoir blanc » introduit un effet de contraste, dû à l’éclairage nocturne, le noir et le blanc s’opposant ; Colette fait de cette première apparition de sa mère une apparition presque fantomatique. – À ces perceptions visuelles s’ajoutent des perceptions olfactives : « cassa machinalement un petit rameau de laurier odorant qu’elle froissa ».
2. L’amour maternel A. Un mur infranchissable • En une seule phrase, l’auteur exprime le désarroi de sa mère : « Je la vis lever la tête, mesurer du regard le mur mitoyen comme si elle espérait le franchir. » Colette interprète son geste. Ainsi, le mur qui est ici un espace réel prend dans cette scène une dimension symbolique de séparation qu’on retrouvera avec « les distances et les clôtures ». • Colette, dans La Maison de Claudine, raconte la mésentente puis la rupture entre sa « sœur aux longs cheveux » et Sido. Elle explique, au début du chapitre, que cette rupture a laissé Colette et ses frères indifférents mais a énormément peiné leur mère. Elle parle à plusieurs reprises de ce jardin et de ce mur qui la séparent de sa fille. B. L’inquiétude et l’attente • L’inquiétude de Sido se manifeste par des gestes : son agitation est rendue ici par les verbes de mouvement au passé simple. La phrase est brève et rapide, rapidité accentuée par la juxtaposition : « Puis elle alla et vint dans la courte allée du milieu, cassa machinalement un petit rameau de laurier odorant qu’elle froissa. » L’adverbe « machinalement » montre l’anxiété de Sido. Colette note tous ces gestes qui pourraient sembler banals mais qui sont révélateurs. Les verbes « cassa » et « froissa » se répondent : même nombre de syllabes, mêmes sonorités finales. Le lecteur a presque l’impression d’entendre le bruit ténu du froissement de la feuille de laurier. • Dans son anxiété, elle va passer de l’extrême mobilité à l’immobilité, l’imparfait remplaçant le passé simple. Colette sait ménager l’attente du lecteur et fixer une image, celle d’une personne figée dans une attitude de grande tension, le visage tourné vers le ciel : « Immobile, la face vers le ciel, elle écoutait, elle attendait. » La phrase est courte, rapide, très ponctuée, ses quatre éléments étant juxtaposés. L’adjectif en tête de phrase est mis en valeur. Les deux verbes, juxtaposés et à l’imparfait, traduisent son attente et son inquiétude, une tension croissante : là encore ils ont le même nombre de syllabes et des sonorités proches, ce qui crée un lien entre eux et met en valeur la progression qu’ils expriment. • Ce sont en effet des bruits qu’elle guette, puisqu’elle ne peut rien voir : « Un cri long, aérien […]. Un second cri, […] et un troisième ». Débute ainsi toute une succession de cris et de souffrances, comme le marquent le rythme décroissant de ces phrases et les points de suspension. Colette les décrit avec précision, analysant leurs similitudes et leurs différences : le premier cri est évoqué comme « aérien, affaibli par les distances et les clôtures » et le deuxième comme « le début d’une mélodie, flotta[nt] dans l’air ». Colette insiste sur le fait que les cris qui lui parviennent semblent traverser l’espace « aérien », « flottant », et le silence de la nuit de façon continue, s’enchaînant les uns aux autres, persistant après avoir cessé (« soutenu par la même note »). Elle utilise des mots appartenant au champ lexical de la musique (« note », « mélodie »), les faisant ressembler à des variations musicales sur un même thème. C. Les gestes d’une mère • C’est à ces cris que la mère va réagir, puisqu’ils signalent que l’accouchement vient de commencer. Elle le fait avec son corps, accompagnant symboliquement sa fille : « et elle commença d’aider, de doubler […]. » • La dernière phrase est longue et cadencée, très ponctuée, imitant par son rythme et ses reprises de mots ou de modes verbaux (les infinitifs, les « et » et les « par ») le rythme de l’accouchement lui-
Une vie – 43
même, fait alternativement de poussées, d’arrêts et de respirations : « serrer à pleines mains ses propres flancs, et tourner sur elle-même, et battre la terre de ses pieds, et elle commença d’aider, de doubler, par un gémissement bas, par l’oscillation de son corps tourmenté et l’étreinte de ses bras inutiles, par toute sa douleur et sa force maternelles […]. » Les membres de phrases se répondent et montrent l’effort renouvelé de la mère qui reprend, solitaire, les mouvements de sa fille (« d’aider, de doubler » ; « par toute sa douleur et sa force maternelles, la douleur et la force de la fille ingrate »). Elle souffre (« gémissement », « corps tourmenté », « douleur ») avec elle et comme elle, signe de son amour maternel, si bien mis en valeur par ces deux membres de phrases qui, en se correspondant, mettent en parallèle, sans les opposer, la mère et la fille. • C’est en effet comme si elle accouchait elle-même et revivait son propre accouchement : les parties du corps qu’elle comprime (la poitrine et surtout les flancs) font songer à la féminité, à la fécondité. • Cette attitude est d’autant plus émouvante qu’elle est vaine, comme le montre la fin de la phrase : « la douleur et la force de la fille ingrate qui, si loin d’elle, enfantait ». L’éloignement de sa fille, accentué par l’emploi de l’adverbe d’intensité « si », est plus symbolique que réel (elle habite à côté). L’ingratitude de la fille ne fait que valoriser l’amour maternel, totalement donné, gratuit.
Conclusion Colette a su, dans ce texte très original, laisser un témoignage magnifique de la capacité d’aimer de Sido, cette mère qu’elle admirait et vénérait tant et à qui elle espérait ressembler. Dans l’œuvre de Colette, plus le temps a passé, plus sa mère a pris une place prépondérante, comme on le voit très bien dans ses deux œuvres autobiographiques La Maison de Claudine (1922) et La Naissance du jour (1928). Mais, comme la plupart des écrivains qui ont tenté de ressusciter le passé par l’écriture, elle craignait de ne pas y parvenir. Ce texte, pourtant, est le signe même de la capacité des écrivains à traduire par les mots ce qui pourrait sembler impossible.
Dissertation
Introduction Claude Roy écrit : « c’est dans les grands romans que l’humanité a déposé ses plus précieux trésors de sagesse et de sagacité, de poésie et de connaissance des cœurs […] et ce que ces histoires imaginaires nous donnent peut-être, c’est la véritable histoire de la vie réelle » (Défense de la littérature, Gallimard, 1968). Ainsi, l’on peut se demander pourquoi le roman peut sembler plus proche de la vie que les autres genres littéraires et quel instrument de connaissance il représente. Les moments essentiels que vivent les personnages romanesques nous sont-ils familiers ou bien étrangers, enfermés dans un monde trop romanesque pour être le nôtre ?
1. Roman et existence A. Roman et vraisemblance • Le roman est un genre littéraire très complexe par sa diversité. À la différence des autres genres littéraires, il dispose d’un espace et d’un temps très vastes ; il est aussi libre dans sa forme que dans le choix de ses sujets. • La longueur du roman va permettre au romancier d’installer son histoire dans une certaine durée et de narrer tout ou une partie de la vie des personnages. En outre, les romanciers tâchent de rendre cette vie la plus vraisemblable possible, et, en évoluant, le roman va se rapprocher de la réalité, donner l’illusion du réel. Le roman est donc le genre littéraire qui tente de reproduire la vie, de recréer des êtres avec des sentiments ou des préoccupations essentielles des hommes. • Les textes du corpus mettent en scène des femmes en train d’accoucher. Par des moyens différents (de focalisation ou de discours) utilisés par les auteurs (cf. questions déjà traitées), le lecteur peut se représenter les scènes, y croire, lire dans les pensées de ces femmes, vivre leur souffrance et leur joie. B. Le roman : un genre qui contient tous les autres • Marthe Robert, dans Roman des origines et Origines du roman (Grasset, 1972), insiste sur la liberté du roman et sur le fait qu’il emprunte à tous les autres genres littéraires. • Le romancier recrée alors un univers à part entière : en cela, le roman est le genre littéraire le plus proche du réel et le plus apte à transporter le lecteur dans son univers. Une telle conception implique des thèmes, des sujets de réflexion, des questions qui peuvent toucher ou intéresser le lecteur. Il n’est donc pas étonnant que les thèmes essentiels de la vie des hommes y soient traités.
Réponses aux questions – 44
C. Le romancier : un homme qui parle à d’autres hommes de l’existence humaine • S’installe alors une étonnante proximité entre les personnages et leur lecteur qui s’attache à eux et s’intéresse à ce qu’ils vivent. À tel point que certains personnages entrent dans nos vies et en font partie au même titre que des personnes réelles, nous marquant parfois davantage : « La mort de Lucien de Rubempré est le plus grand drame de ma vie », aurait dit Oscar Wilde. • Proust (dans Sur la lecture) s’attache aux personnages comme à de vrais êtres : « Ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu’aux gens de la vie, n’osant pas toujours avouer à quel point on les aimait, et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l’air de sourire de notre émotion, fermant le livre, avec une indifférence affectée ou un ennui feint ; ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais, on ne saurait plus rien d’eux. »
2. Les moments essentiels de l’existence humaine A. Quels sont les moments essentiels de l’existence humaine ? • Ce sont les moments où l’homme est placé en présence de la vérité et de la profondeur de l’existence et qui, dans une vie, provoquent un changement important, jusqu’à, parfois, la faire basculer : les scènes de rencontre, les scènes d’accouchement. Parmi ces moments, en effet, se trouvent nécessairement les débuts et les fins de vie. • Des moments qui mettent l’homme en danger ou à l’épreuve, des moments d’affrontement avec soi ou les autres, avec l’existence ou le monde : romans d’aventures, romans épiques, ou mettant en scène des héros… mais on peut en trouver aussi dans des romans plus réalistes. Ces moments-là mobilisent ses qualités, le révèlent à lui-même. • Des moments où l’homme doit faire les choix les plus importants. • Des moments où il fait l’expérience de la vie et progresse : romans d’apprentissage et autres. • Des moments qui lui apportent les plus grandes souffrances ou les plus grandes joies. B. Comment apparaissent-ils dans le roman ? • Les auteurs les mettent en valeur, puisque ce sont des moments dramatiques qui soit font avancer l’action, soit interviennent dans l’évolution d’un personnage : lorsque Frédéric Moreau rencontre Mme Arnoux sur le bateau au début de L’Éducation sentimentale, le lecteur comprend que la vie de Frédéric va en être bouleversée ; c’est un passage clé, et dans le roman et dans la vie du protagoniste ; de plus, cette scène porte en elle l’essentiel du roman. • Ce sont souvent des scènes soit pathétiques, soit intenses, puisqu’elles apportent des émotions plus fortes, que ce soit dans la souffrance ou dans la joie. Dans À l’ouest rien de nouveau d’Erich Maria Remarque, lorsque le narrateur, Paul Baümer, et Kat dégustent une oie, ils vivent un moment de paix (au cœur de la guerre), de bonheur et d’amitié d’une immense émotion. • Ce sont des passages traités comme de véritables scènes : le lecteur a alors l’illusion que la durée des événements racontés équivaut au temps de lecture et l’impression d’assister à la scène en temps réel. • Ces moments sont parfois mis en scène et théâtralisés (le roman empruntant aux autres genres littéraires), et ainsi mis en valeur, isolés du reste du récit. Dans La Promesse de l’aube, lorsque sa mère vient lui rendre visite à l’École de l’air et qu’il a honte d’elle, Romain Gary fait de ce moment essentiel du roman et de sa vie une véritable scène de tragi-comédie. Là encore, ce passage, dans lequel est mentionnée « la promesse faite à sa mère à l’aube de sa vie », porte en lui l’essentiel du récit. • De même, les scènes d’accouchement du corpus sont décrites de façon détaillée et semblent se dérouler en temps réel. • Mais ces moments ne seront pas les mêmes d’un roman à l’autre.
3. Des moments romanesques : essentiels et révélateurs A. Des moments grandioses Les romans épiques, héroïques ou les romans d’aventures vont privilégier des scènes grandioses ou exceptionnelles, où la vie est magnifiée. Le quotidien dans sa banalité est gommé : – Dans Yvain ou le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, tous les moments racontés sont des moments essentiels de sa vie, des moments palpitants pour le lecteur : combat contre d’autres chevaliers ou des monstres, sauvetage de jeunes filles en danger, errance dans la forêt après avoir sombré dans la folie… Ces exploits mettent en valeur le courage, les nombreuses vertus du héros qui, au fur et à mesure du roman et grâce à ses prouesses, devient un chevalier parfait. Ces romans
Une vie – 45
courtois, encore sous l’influence de l’épopée et soucieux de vanter l’attitude exemplaire de l’homme de Cour, proposent une vision exaltée de l’existence et de l’homme. Les gens de Cour, à qui étaient lus ces premiers romans, y retrouvaient l’idéal courtois fait d’élégance, de générosité, de loyauté, de hardiesse et de maîtrise de soi. – Le roman de Tristan et Iseut reste à part pour de nombreuses raisons. Il a été composé de manière différente, puisqu’il est le résultat de l’intervention de plusieurs trouvères. Et, surtout, Tristan représente à la fois le chevalier et l’amant idéal. Les moments racontés restent eux aussi des moments essentiels, mais ce ne sont pas tous des passages d’action ou d’aventure, soulignant la bravoure exceptionnelle de Tristan. Certains grands moments de la vie des personnages sont parfois tout simplement des moments où ils sont enfin ensemble, seuls et heureux, libres de s’aimer. On peut citer, parmi ces passages, ceux où ils se retrouvent dans un verger qui est l’image du paradis, leur amour étant trop parfait et trop pur pour ce monde. – Les romans d’aventures, plus récents, seront écrits sur le modèle des romans de chevalerie du XIIe siècle. Au XIXe siècle, Walter Scott, Alexandre Dumas, etc. proposent à leur tour, comme moments essentiels, des moments héroïques : poursuites, duels, exploits guerriers, échappées de prison, vengeances… B. Vers plus de simplicité et de réalisme Dans un même roman, il peut y avoir des moments essentiels qui sont des scènes d’exception, quand d’autres seront plus simples en apparence mais d’une immense importance pour le personnage. Le roman, en évoluant, va ainsi accorder une place plus importante à l’analyse psychologique et vouloir se rapprocher de plus en plus (avec le réalisme et le naturalisme) de la réalité : – Dans La Peste, le narrateur met l’accent sur la terrible scène de l’agonie de l’enfant, mais il isole aussi le bain de mer partagé par Rieux et Tarrou, moment pur de paix, de bonheur et d’amitié. – De même, dans L’Étranger, Meursault fera de la scène fondamentale du meurtre une scène à part, mais il désignera aussi comme essentiel le moment où, seul, dans sa prison, il songe à sa mère et la comprend. – On trouve les mêmes contrastes dans La Condition humaine : violence de l’incipit, grandeur de la scène où Katow sacrifie sa boule de cyanure, mais aussi discussion entre le père et le fils, drame intérieur de Clappique révélé dans cette scène tragi-comique où il fait des grimaces devant un miroir… – Et dans les romans de guerre comme À l’ouest rien de nouveau ou Les Croix de bois, les scènes typiques (ou topoï) peuvent sembler opposées, alors qu’elles décrivent le quotidien du soldat, rendant sa vie insupportable : les poux et les rats, mais aussi les chutes d’obus… – Enfin, la surprenante et dérisoire conclusion de L’Éducation sentimentale (« c’est là ce que nous avons eu de meilleur »), en dehors de ce qu’elle révèle du tempérament de Frédéric et du pessimisme de Flaubert, montre que les moments essentiels d’une vie ne sont pas nécessairement ceux auxquels on pourrait s’attendre. C. Un lecteur enrichi • Une telle variété de moments conduit le lecteur vers une véritable introspection, une réflexion (au sens de « retour sur soi ») sur la vie et son sens : qu’est-ce qui est important, essentiel ? quand le comprend-on ? peut-on le savoir ? qui suis-je ? • À ce titre, le roman se révèle comme un miroir, un extraordinaire et indispensable instrument d’enquête et de connaissance de soi, des autres, de l’existence. • En le faisant rêver, en lui faisant vivre par « procuration » des moments héroïques, le romancier permet au lecteur d’accéder à une autre vie. Non seulement il ajoute à sa propre vie d’autres moments, plus exaltants, mais il lui offre une autre vision, magnifiée, de l’homme, capable d’aller jusqu’au bout de son destin, capable de se dépasser… Il lui offre imaginaire et espérance : – lorsque Zola décrit la vie de Gervaise, il évoque à la fois les moments essentiels de la vie d’une ouvrière parisienne et ceux de tout être humain. Ceux-ci révèlent donc à la fois aux lecteurs une partie de la société et une partie d’eux-mêmes ; – lorsque, au chapitre VI d’Une vie, Jeanne, rentrant de voyage de noces, se rend compte de la future vacuité de son existence, ce moment essentiel dans la vie du personnage renvoie nécessairement le lecteur soit à sa propre mélancolie, soit à son inaptitude à comprendre de tels sentiments, soit encore à une réflexion sur l’existence et son sens.
Réponses aux questions – 46
Conclusion Le roman permet donc au lecteur d’évoluer, de progresser. Il permet de vivre plusieurs vies en une seule et d’en sortir grandi. La lecture peut faire aussi partie des moments essentiels de son existence, comme Proust l’écrit : « Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré » (Sur la lecture). Pour lui, en effet, le livre est un « ange qui s’envole aussitôt qu’il a ouvert les portes du jardin céleste ».
Écriture d’invention Pour traiter ce sujet, il est nécessaire de garder en mémoire la spécificité du texte d’origine : la scène est vue par la petite fille et racontée plus tard par la même personne devenue adulte. La mère est donc observée par une narratrice qui ne peut pas lire dans ses pensées mais seulement observer et interpréter ses gestes et attitudes. Or, ce point de vue va changer. On peut soit « gommer » la présence de l’enfant à sa fenêtre, soit l’exploiter, en imaginant que sa mère l’ait vue et soit consciente de sa présence. Les élèves doivent respecter l’écriture précise et sensible de Colette et passer d’un point de vue externe à un point de vue interne. Ils doivent aussi garder cette atmosphère très particulière d’une nuit villageoise et silencieuse de pleine lune. Il s’agit de lire à présent dans la pensée de Sido, de mettre en valeur sa souffrance (elle souffre de ne pas pouvoir être aux côtés de sa fille dans un des moments essentiels de sa vie…), son amour et son dévouement.
C h a p i t r e X ( p p . 1 8 5 à 2 0 6 )
◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 207 à 209)
Deux portraits antithétiques u Le narrateur entreprend de faire le portrait de l’abbé Tolbiac en gestes et en paroles, après une présentation du personnage extrêmement courte et efficace : « C’était un tout jeune prêtre maigre, fort petit, à la parole emphatique, et dont les yeux, cerclés de noir et caves, indiquaient une âme violente. » Il choisit donc une véritable mise en scène théâtrale, essentiellement dialoguée, avec des « didascalies » révélatrices : « faisait des gestes d’impatience, et devenait rouge », « d’un ton cassant ». Le fait de confronter le nouveau personnage à son prédécesseur qui lui est opposé en tout rend aussi le portrait plus efficace et vivant, en faisant ressortir ses caractéristiques par contraste. v Maupassant a clairement voulu opposer les deux personnages, en commençant par leur physique : on sait déjà que l’abbé Picot est gros, et ce détail est rappelé ici par la mention de sa « bedaine », tandis que le narrateur insiste plusieurs fois sur la petite taille et la maigreur de Tolbiac (« maigre, fort petit » ; « tout frêle et tout maigre » ; « frêle abbé » ; « petit prêtre »). Maupassant utilise ici le procédé traditionnel du portrait qui associe un trait physique à une caractéristique psychologique (selon la physiognomonie tant prisée par Balzac) : l’embonpoint dénote un certain amour de la vie (l’abbé Picot aime la nature qui l’entoure, « la mer », « les petites vallées en entonnoir », et il prise), de la « rondeur » dans le caractère (indulgence, patience) ; au contraire, la maigreur de l’abbé Tolbiac révèle « son mépris du monde et des sensualités », la raideur de son tempérament (« rageur », « impatience », « austérité intraitable », « fanatisme rigide »), et sa petite taille peut expliquer par contraste son orgueil et sa volonté de dominer. Le narrateur applique d’ailleurs directement cette méthode du portrait en décryptant les traits du visage de Tolbiac « dont les yeux, cerclés de noir et caves, indiquaient une âme violente ». Il pousse également la précision jusqu’à doter les deux abbés d’un vêtement tout aussi révélateur : « une soutane neuve qui ne portait encore que huit jours de taches » de l’abbé Picot s’oppose à « la soutane usée déjà, mais propre » de Tolbiac, comme le laisser-aller ou l’indifférence aux normes sociales s’oppose à la rigueur et à la conscience de soi. w Le narrateur se sert du discours direct pour opposer une fois de plus ces deux personnages : – par les « didascalies » : les interventions, très courtes, de l’abbé Tolbiac sont systématiquement précédées d’une indication dépréciative (« brusquement », « d’un ton cassant », « avec rudesse ») ; au contraire, la mise en scène de l’abbé Picot souligne son humour et sa bonhomie (« L’abbé Picot le regarda de biais, comme il faisait en ses moments de gaieté » ; « le vieux curé sourit en humant sa prise ») ;
Une vie – 47
– par le type de phrases : les interventions du vieux curé sont longues, pleines d’émotions (interjections, répétitions) et de sentiments personnels (« ça me coûte » ; « je l’aimais, moi ») ; les phrases de l’abbé Tolbiac sont très courtes, catégoriques et impersonnelles (« il faudra », « il est inutile ») ; – par le vocabulaire et le registre de langue : l’abbé Picot s’exprime de façon conforme à son tempérament bonhomme et à son âge qui lui permet distance et humour ; il emploie un langage plutôt familier, avec de nombreuses apostrophes ou interjections (« l’abbé », « voyez-vous », « ma foi », « tant pis », « voilà tout »), ce qui correspond au « naturel » que Jeanne apprécie en lui ; il fait preuve d’un humour qui doit paraître choquant et presque blasphématoire au jeune abbé en évoquant « Notre-Dame du Gros-Ventre » (d’où sans doute la « rougeur » de ce dernier) ; son expression n’est jamais catégorique mais faite de nuances, montrant son indulgence et sa sagesse pratique (« ne vaut point grand-chose », « pas plus de religion qu’il ne faut », « n’ont guère de conduite », « je tâche », « vous pouvez ») ; au contraire, le jeune prêtre s’exprime de façon absolue, sans laisser place à la nuance ni à la discussion (« il faudra que tout cela change », « nous pensons différemment » – et dans la suite du texte : « nous devons », « il faut », « toujours »). x L’abbé Picot est désigné de façon simple et très prosaïque (« le vieux curé »), et parfois même familière (« le bonhomme », « le vieux »). Ces périphrases insistent sur son âge qui paraît synonyme d’« indulgence » et de « tolérance », en opposition avec l’« inexpérience juvénile et sauvage » de l’abbé Tolbiac. Cette familiarité entraîne la sympathie du lecteur, une sorte de proximité avec le personnage. Les façons de désigner l’abbé Tolbiac sont plus complexes : le narrateur insiste sur sa jeunesse (« enfant rageur » ; « cet enfant, ministre du ciel »), mais en la connotant toujours négativement par le fanatisme et l’intransigeance ; ce paradoxe de la fragilité enfantine associée à la violence rend le personnage inquiétant. Sa petite taille est plusieurs fois mentionnée (« le petit prêtre », « ce frêle abbé intègre et dominateur »), toujours liée à des aspects négatifs de violence et d’orgueil. La périphrase finale (« cet enfant, ministre du ciel ») est très intéressante, car elle associe cette fois son jeune âge avec le pouvoir que lui donne sa fonction. De plus, quelle distance entre le « bonhomme » et le « ministre du ciel » ! L’abbé Picot apparaît comme « humain, trop humain », alors que le narrateur fait tout pour éloigner le lecteur de l’abbé Tolbiac, présenté comme inaccessible, inquiétant, voire dangereux. y L’abbé Picot regarde son successeur avec une indulgence amusée (« moments de gaîté », « sourit ») et met son intransigeance sur le compte de la jeunesse (« l’âge vous calmera »). Il lui parle avec la liberté et la familiarité que lui autorise son âge en l’appelant « l’abbé ». On ne sent pas chez lui de mépris, mais plutôt la volonté de lui faire part de son expérience et de tempérer son intransigeance qui lui paraît excessive. Peut-être veut-il lui éviter aussi trop de déconvenues (« Mariez-les, l’abbé, ne vous occupez pas d’autre chose ») ? Cette gentillesse désabusée et clairvoyante du vieil homme met d’autant plus en valeur la mesquinerie fanatique du jeune curé. En effet, il apparaît plein de morgue, comme le soulignent les « didascalies » du narrateur (« brusquement », « cassant », « rudesse »), sans aucun respect pour son interlocuteur plus âgé ; il ne semble éprouver que du mépris pour les conseils du vieux curé, en répondant avec insolence : « nous verrons bien ». Il insiste avec lourdeur sur leurs différences : « il faudra que tout cela change », « nous pensons différemment » – ce qui implique de sa part un jugement implicite sur ce qu’il pense être un échec de l’abbé Picot. Une fois de plus, le narrateur montre indirectement mais clairement où vont ses sympathies, en laissant cependant le lecteur juger lui-même sur les faits et les paroles.
Éloge et blâme U Pour ouvrir et clore la scène de présentation, Maupassant utilise la focalisation interne du point de vue de Jeanne (« Jeanne ressentit une vraie tristesse »/« Jeanne qui faillit pleurer ») : par empathie avec l’héroïne, le lecteur éprouve aussitôt de la sympathie pour le vieux curé. Au contraire, tout le dialogue est présenté en focalisation externe : cette fois, c’est au lecteur de juger sur pièces. La deuxième partie du texte utilise encore le point de vue de Jeanne : le lecteur perçoit Tolbiac tel que Jeanne croit qu’il est et en fonction de l’influence qu’il a sur elle (« elle subit l’influence », « il lui plaisait », « il faisait vibrer en elle », « donnaient à Jeanne l’impression », « elle se laissait séduire »). Mais le narrateur ne peut s’empêcher de reprendre son point de vue omniscient, lors de la dernière phrase, en émettant un jugement à la fois négatif et ambigu sur le personnage (« le fanatisme rigide de cet enfant, ministre du ciel »).
Réponses aux questions – 48
Donc, l’abbé Picot, qui est déjà bien connu du lecteur, a droit ici au point de vue bienveillant de Jeanne. En revanche, l’abbé Tolbiac reste beaucoup plus distant, plus mystérieux, car le lecteur n’a jamais accès à son intériorité et parce qu’il parle peu. Le fait d’utiliser le point de vue de Jeanne à son propos dans la seconde partie de l’extrait souligne alors son côté dangereux, par la façon dont il s’empare de la conscience de l’héroïne. V L’abbé Picot est réaliste et a une longue expérience de la prêtrise, ce qui lui donne une vision assez désabusée du rôle de l’Église. Il est lucide sur le manque de foi et de vertu de ses paroissiens (« n’ont guère de conduite » ; « on est croyant, mais tête de chien ») – et sans doute sur le déclin de l’Église – ; il sait que le prêtre ne peut que composer avec cette réalité et non la transformer (« pour empêcher ces choses-là, il faudrait enchaîner vos paroissiens » ; « Vous ne les empêcherez pas de fauter »). Il a renoncé à tout absolu et tout dogmatisme sur le plan moral et « se contentait du peu qu’elle pouvait lui donner et ne la gourmandait jamais ». L’Église pour lui doit être un simple soutien auprès de ses fidèles et essayer de « limiter les dégâts », en protégeant les plus faibles, c’est-à-dire les femmes et la famille (noyau fondateur de l’Église, de l’État, de la morale…) : « vous pouvez aller trouver le garçon et l’empêcher d’abandonner la mère. Mariez-les » ; on a vu d’ailleurs qu’il a le même rôle de conciliation et de maintien du mariage (même au prix d’une totale hypocrisie) dans le cas de Jeanne. L’abbé Tolbiac a une conception totalement opposée : lui se situe dans l’absolu doctrinaire et se croit capable de modifier la nature humaine (« Avec moi, il faudra que tout cela change ») ; pour lui, l’Église impose des devoirs stricts qu’il faut respecter (« ne point manquer l’office du dimanche, et […] communier à toutes les fêtes ») ; sa « parole dure » et « sévère » est d’ailleurs émaillée de verbes d’obligation (« il faudra », « nous devons », « il faut »). Mais, surtout, il conçoit l’Église en termes de pouvoir, ce qui paraît totalement absent de l’esprit du vieil abbé (qui d’ailleurs ne se réjouit même pas de son « avancement ») ; le champ lexical du pouvoir est bien présent dans la seconde partie de l’extrait (« prenant possession d’un royaume », « la tête du pays », « gouverner », « puissants et respectés », « craindra et obéira », « dominateur »). Le narrateur use à son propos d’une comparaison comique par son côté hyperbolique : le petit abbé devient « un prince prenant possession de son royaume », alors qu’il n’est que le curé d’un misérable bourg du pays de Caux ! Ce qui est plus grave, sans doute, c’est que l’abbé Tolbiac croit encore au système de l’Ancien Régime, fondé sur les trois ordres : « L’église et le château se donnant la main, la chaumière nous craindra et nous obéira » ; victime de son inexpérience et de son fanatisme étroit et aveugle, il semble n’avoir aucune conscience de l’évolution de la société et de la mutation qu’elle va imposer à l’Église ; ce décalage par rapport à la réalité sociale est d’ailleurs marqué par la comparaison avec les « martyrs », faisant allusion à une pratique religieuse bien éloignée de la Normandie du XIXe siècle dans le temps ou dans l’espace ! Pour l’abbé Tolbiac donc, le prêtre ne doit pas être un soutien ni un réconfort auprès de ses ouailles, mais un despote qui impose sa « volonté inflexible » et son « exemple à suivre » et n’aspire qu’à être craint et obéi. Aucune générosité en lui, aucune bienveillance, aucune attention à l’autre, puisqu’il n’éprouve que « dégoût des préoccupations humaines ». W Il est intéressant de noter que les termes les plus péjoratifs (« âme violente », « rageur », « rudesse », « dure », « fanatisme rigide ») sont des jugements du narrateur et qu’ils insistent sur la violence et la dureté de l’abbé Tolbiac. Par l’intermédiaire du point de vue interne, Maupassant emploie des expressions plus ambiguës, dans la mesure où elles reflètent l’attirance de Jeanne et peuvent ne pas être forcément négatives quand il s’agit d’un prêtre rigoureux : « Son austérité intraitable, son mépris du monde et des sensualités, son dégoût des préoccupations humaines, son amour de Dieu, son inexpérience juvénile et sauvage, sa parole dure, sa volonté inflexible » ; ce sont plutôt l’accumulation de ces tendances et leur extrémisme qui provoquent le blâme. X Nous avons vu, dans la question 6, comment le point de vue interne de Jeanne donnait une vision positive du vieux curé, à la fois par le jugement direct qu’elle porte sur lui (« elle l’aimait parce qu’il était joyeux et naturel ») et l’émotion sincère qu’elle ressent à son départ (« vraie tristesse », « faillit pleurer »). Pour l’abbé Tolbiac, le procédé est plus complexe : le narrateur montre d’abord comment l’action du jeune prêtre est à la fois forte et insidieuse, en employant systématiquement des formules passives à propos de Jeanne (« subit l’influence », « il faisait vibrer en elle », « elle se laissait séduire » – ce dernier terme étant particulièrement ambigu dans le cas de l’abbé Tolbiac). Mais, surtout, le narrateur déprécie d’emblée le jugement que l’héroïne peut porter sur le nouveau curé en le motivant par « cette foi rêveuse » ou « la corde de poésie religieuse », c’est-à-dire cette sensiblerie coupée de la réalité qu’il exècre et dont il a déjà souligné les ravages dans la vie de Jeanne.
Une vie – 49
at Cet extrait est le seul passage du roman où les deux prêtres sont confrontés l’un à l’autre : désormais, c’est l’abbé Tolbiac qui va s’emparer de la conscience de Jeanne, et on n’entendra plus parler de l’abbé Picot. La présentation magistrale de l’abbé Tolbiac que nous fait ici Maupassant, en l’opposant en tous points au vieux curé, nous renseigne sur son intention. Ce dédoublement du prêtre rend sa critique de l’Église encore plus féroce : si l’abbé Picot conserve pour lui sa bonhomie, son caractère « joyeux et naturel », il se révèle dans toute la première partie bien médiocre et incapable d’une quelconque élévation spirituelle (comme l’abbé Bournisien dans Madame Bovary, inapte à comprendre les tourments d’Emma et à la sauver du suicide). Avec l’arrivée de l’abbé Tolbiac, Maupassant crée une progression en nous montrant qu’il y a bien pire et que finalement le vieil abbé est positif par rapport à son successeur, puisque lui, au moins, dans son impuissance désabusée, n’est pas dangereux ! Le « fanatisme rigide » de l’abbé Tolbiac ouvre pour Jeanne une ère encore pire que ce qu’elle a vécu jusque-là, puisqu’elle va sombrer dans la violence sanglante du meurtre de Julien, que préfigure le massacre de la portée de Mirza opéré justement par le jeune abbé. Si l’Église abrite des médiocres comme l’abbé Picot, qui garde néanmoins des qualités humaines, elle peut engendrer aussi des monstres comme l’abbé Tolbiac, qui, par frustration, fanatisme et rejet de la réalité humaine, va jusqu’à détruire les autres. De plus, son échec va s’avérer encore plus cuisant, comme le lui prédit d’ailleurs son prédécesseur (« vous éloignerez de l’Église vos derniers fidèles »), puisqu’il va même détourner Jeanne de l’Église.
La religion de Jeanne ak Comme toujours, Jeanne voit tout à travers le prisme de son passé et elle est liée à l’abbé Picot par « tous ses souvenirs de jeune femme ». Il représente le passé qu’elle idéalise à travers les deux personnages qui ont servi ou servent de support à ses illusions, c’est-à-dire son mari et son fils, et sa mère, emblème de sa jeunesse heureuse. Peut-être symbolise-t-il aussi une sorte de continuité humaine au milieu des cahots de sa destinée, de la perte de ses illusions ? Toujours est-il qu’elle vit son départ comme un deuil de plus, une nouvelle séparation d’avec son passé. al Maupassant dote son héroïne d’un type de foi absolument en accord avec son tempérament, en parlant de « foi rêveuse » : celle-ci ne repose pas sur des « convictions » qui seraient étayées par une réflexion (Maupassant dira plus loin que Jeanne aimait « divaguer mystiquement ») ni sur une pratique qui l’engagerait davantage (elle ne va pas régulièrement aux offices), mais sur la sensibilité et l’imagination ; elle aime l’abbé Picot parce qu’il est lié à son passé et avec Tolbiac elle sent « vibrer en elle la corde de poésie religieuse ». Le narrateur accompagne par deux fois ces jugements d’une remarque générale sur les femmes (« que garde toujours une femme », « que toutes les femmes ont dans l’âme ») : on y retrouve bien l’opinion de l’époque qui fait des femmes des sortes d’enfants, livrées entièrement à leur affectivité, dominées par une sensiblerie et une imagination débordantes, et incapables de distance réflexive et critique – ce qui les soumet facilement à toutes les influences, comme on le verra dans la question suivante. L’autre caractéristique de la foi de Jeanne, tout aussi liée à son tempérament, est sa passivité : le terme « habitude » revient deux fois, concernant sa pratique religieuse. Comme dans le reste du roman, elle n’est pas vraiment maîtresse de ses choix, mais se laisse emporter par une sorte de pente naturelle ou diriger par les autres (ici le couvent, puis l’abbé Tolbiac), ce que le narrateur marque nettement dans le vocabulaire (« elle ne voulut point », « subit l’influence », « se laissait séduire »). am Jeanne est d’abord sensible au mysticisme de l’abbé Tolbiac, qui correspond parfaitement à sa tendance à fuir la réalité dans le monde de l’imaginaire. Elle est attirée aussi par son exaltation et son caractère excessif (« intraitable », « sauvage », « inflexible ») qui rejoignent son goût pour l’idéalisation et l’absolu. L’abbé Tolbiac « tombe bien » dans la vie de Jeanne qui, blessée par toutes les lâchetés, par la « fange universelle » qu’elle a découverte autour d’elle (trahison de Mme de Fourville, adultère de sa mère), ressent « une sorte d’isolement de sa conscience juste au milieu de toutes ces consciences défaillantes » (l. 4089-4090) : par une erreur de jugement dont elle est malheureusement coutumière, elle croit rencontrer en lui quelqu’un qui lui ressemble, et sa « répugnance qui devenait haineuse, de cette sale bestialité » (l. 4109-4110), trouve un écho dans le « mépris du monde et des sensualités » professé par l’abbé Tolbiac. Ce dernier devient pour elle l’occasion de projeter ses fantasmes d’absolu et d’héroïsme, et elle voit en lui un « martyr ». On peut remarquer d’ailleurs que, contrairement à l’abbé
Réponses aux questions – 50
Picot, solidement ancré dans la médiocrité campagnarde et quotidienne, l’abbé Tolbiac donne lieu à tous les fantasmes : le baron y voit un inquisiteur et les paysans le redoutent comme un exorciste. an On peut remarquer que, lors de la confrontation entre les deux prêtres, Jeanne, toute à sa tristesse et à son regret du départ de l’abbé Picot, ne semble pas porter attention à son successeur. Et même, la première visite de celui-ci paraît indisposer l’héroïne, pour qui les questions de pouvoir temporel, de gouvernement de paroisse et d’alliance de l’église et du château n’ont aucun intérêt (elle aura d’ailleurs la même attitude plus tard avec la marquise de Coutelier au chapitre XI). Habituée à l’indulgence tolérante du vieux curé, elle est surprise par l’attitude du nouveau, « inquiet et sévère ». Mais, comme toujours, incapable de garder une distance juste avec les autres, elle va tomber complètement sous la coupe de l’abbé Tolbiac et se laisser « séduire » (comme elle l’a fait avec Julien dans un autre registre). Ce n’est qu’après qu’elle découvrira sa violence démente (la scène de Mirza), son intolérance fanatique (le refus des obsèques de son père) et sa cruauté avec elle à propos des frasques de son fils. Elle finira donc par le rejeter et dire à la marquise de Coutelier, en faisant preuve pour une fois de conviction : « Dieu est partout, Madame. Quant à moi qui crois, du fond du cœur, à sa bonté, je ne le sens plus présent quand certains prêtres se trouvent entre lui et moi. »
◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 210 à 217)
Examen des textes u On a vu, dans la lecture analytique, que Maupassant se servait d’une mise en scène théâtrale pour opposer les personnages, en donnant beaucoup d’importance au discours direct et à quelques « didascalies » très suggestives. Le portrait physique proprement dit est donc réduit à peu de détails, et le narrateur intervient peu pour donner son jugement ; c’est au lecteur de tirer les leçons de la scène. Balzac se montre plus dirigiste et met le lecteur face à un véritable double portrait, sans aucun recours au discours direct. Les deux personnages sont vus par un observateur extérieur mais attentif (« l’examiner avec attention »), sans que l’on ait accès à leur intériorité, si ce n’est par des supputations (« Plusieurs personnes avaient pu d’abord le croire »/« mais celles qui prétendaient le mieux connaître avaient fini par détruire cette opinion en le montrant ») ; le portrait se limite donc aux caractéristiques extérieures mais très détaillées des deux abbés (« figure », « teint », « expression », « yeux », « cheveux », « traits »). Ce portrait est clairement présenté en opposition, comme l’indique la première phrase (« Il était impossible de rencontrer deux figures qui offrissent autant de contrastes qu’en présentaient celles de ces deux abbés ») : chaque phrase est centrée sur un des deux personnages et reliée à la précédente par des termes marquant l’opposition (3 fois « tandis que », « au contraire », « mais »). Le narrateur construit avec beaucoup de rigueur l’opposition : – la silhouette et le tempérament (« grand et sec » ≠ « grassouillet » ; « bilieux » ≠ « sans fiel ») ; – la physionomie (« ronde et rougeaude » ≠ « longue et creusée » ; « bonhomie sans idées » ≠ « expression pleine d’ironie ou de dédain ») ; – la manière d’être (« calme parfait » ≠ « tout expansion » ; « paupières presque toujours abaissées » ≠ « tout franchise » ; « sombre physionomie », « ne riait jamais » ≠ « s’amusait d’une bagatelle » ; « longs jeûnes » ≠ « aimait les bons morceaux ») ; – l’impression générale qu’ils provoquent (« sentiment de terreur » ≠ « sourire doux ») ; – la démarche (« marchait d’un pas solennel » ≠ « circulait sans gravité » ; « monumental, digne de la statuaire » ≠ « rouler sur lui-même »). Comme Maupassant, mais à une seule reprise, Balzac utilise une périphrase pour les opposer : « le haut chanoine » ≠ « le bon vicaire ». Le texte de Balzac obéit donc à une démarche plus explicite dans l’antithèse, organisée clairement et point par point par le narrateur, mais laisse cependant une zone d’ombre autour du personnage de Troubert (comme le fait aussi Maupassant pour l’abbé Tolbiac), en se servant des jugements extérieurs opposés qu’il suscite. v Le narrateur construit cette scène de façon extrêmement efficace, pour provoquer la réaction du lecteur. Dans le premier paragraphe, il insiste sur le côté « charmant » et naturel de la scène : des enfants, désignés familièrement par « galopins » ; les « petits » évoqués par le terme affectueux de « petit toutou » ; la chienne « qui les léchait avec tendresse ». C’est presque une scène de genre, un tableau
Une vie – 51
campagnard, qui suscite la « joie » et l’amusement (« C’était un jeu pour eux »). Le deuxième paragraphe, qui bascule immédiatement dans la violence et l’horreur, provoque donc un contraste saisissant et d’autant plus choquant. Le troisième paragraphe constitue le châtiment, sans que le narrateur ait besoin d’intervenir dans la condamnation. Et le quatrième constitue une sorte de retour au calme dans la stupeur et la consternation, avec un jugement final. Le narrateur est également fort habile et percutant dans la confrontation des « personnages » : d’un côté, des enfants joyeux, symboles d’innocence (« un jeu naturel où rien d’impur n’entrait »), des petits chiots dont il souligne sans cesse la fragilité (« petit toutou » ; « nouveau-nés piaulants, aveugles et lourds »), une chienne particulièrement vulnérable puisqu’elle est attachée et « endolorie » ; de l’autre, l’abbé Tolbiac seul, qui fait fuir tout le monde, les enfants et Jeanne, et qui va oser frapper des enfants et tuer une bête innocente en train de donner la vie. Dans le deuxième paragraphe, le narrateur emploie des expressions très fortes pour décrire la violence de l’abbé : « de toute sa force », « à tour de bras ». Et il use systématiquement de termes désignant un état proche de la folie, de la démence pour qualifier son état : « fureur » (au sens latin de « folie furieuse »), « frénésie », « forcené », de même que l’expression « la tête perdue » ; l’homme de Dieu apparaît ici paradoxalement possédé par une force diabolique ! Dans cette scène typiquement naturaliste, c’est l’horreur crue qui va choquer directement le lecteur (« gémissait affreusement », « le corps saignant », « la bête éventrée »). Maupassant se sert aussi habilement des autres personnages, et en premier lieu du baron (le plus anti-religieux des personnages) qui joue le rôle de la justice immanente : en faisant sauter le tricorne de Tolbiac, il semble lui ôter son statut religieux et, en le jetant sur la route, il l’exclut de la communauté humaine, en fait un monstre, un « anti-physique », comme il le dit ailleurs ; sa colère et son indignation incarnent celles du lecteur. Jeanne, comme d’habitude, est dans la réaction sentimentale, les pleurs et la compassion (ce qui suscite aussi la pitié du lecteur). Les paysans jouent presque le rôle du chœur antique de la tragédie : spectateurs impuissants, ils portent le jugement final en renvoyant eux aussi l’abbé Tolbiac à la bestialité (« sauvage »). Finalement, toute la scène contribue à couper l’abbé de toute humanité, pour en faire une bête féroce. w Le texte de Maupassant critique essentiellement la frustration maladive de l’abbé Tolbiac, qui l’amène à détester les manifestations naturelles de la vie – en particulier la sexualité –, et son dangereux fanatisme, qui mène à la violence. L’abbé Troubert de Balzac peut faire penser à l’abbé Tolbiac par son austérité et son apparent refus du monde et de ses joies (« le voile que de graves méditations jettent sur les traits », « fatigué par de trop longs jeûnes ») ; tous deux semblent en tout cas bien loin des vertus évangéliques de douceur, de compassion ou d’amour du prochain… Au contraire, ils inspirent horreur pour Tolbiac et « terreur » pour Troubert. On verra dans la suite du roman de Balzac que la première hypothèse concernant le chanoine était la vraie, puisqu’il se révélera en effet « absorbé par une haute et profonde ambition », qui l’amènera à faire preuve d’une terrible cruauté à l’égard du pauvre Birotteau. Celui-ci (un peu comme l’abbé Picot dans Une vie) est critiqué pour sa médiocrité proche de la bêtise (« bonhomie sans idées ») et son absence totale d’élévation spirituelle. On rejoint ici la critique des célibataires chez Balzac : à moins d’être sauvés par une totale abnégation (comme Mlle Salomon dans Le Curé de Tours), ils deviennent tous monomaniaques, victimes d’une idée fixe qui peut rester inoffensive, comme le désir de Birotteau d’occuper le logement douillet de son prédécesseur, ou devenir dangereuse et destructrice, comme l’ambition de Troubert. x Le narrateur ne procède pas à un éloge direct du personnage de l’évêque, mais va passer essentiellement par l’intermédiaire de Jean Valjean, qui réagit et s’exprime à chaque acte ou parole de l’évêque. Ainsi le narrateur décrit-il les expressions de son visage : « s’empreignit de stupéfaction, de doute, de joie, et devint extraordinaire » ; « le visage de l’homme s’illuminait » ; il lui prête surtout un langage fait de surprise et d’émerveillement (interjections, questions, exclamations) qui montre son émotion devant l’accueil qu’il reçoit. C’est par les paroles de Valjean que passe l’éloge direct, avec les mots les plus simples : « dignes gens », « brave homme », « brave homme de prêtre », « Vous êtes humain », « C’est bien bon un bon prêtre », « vous êtes bon ». Au lecteur aussi de porter son propre jugement à partir de ce que fait et dit Mgr Myriel : l’accueil qu’il réserve à ce forçat dans sa propre maison (et non dans l’écurie) et à sa table, en sortant pour lui faire honneur toute son argenterie (avec le risque de se la faire voler, ce que la suite confirmera…), en s’adressant à lui avec un total respect (il l’appelle « Monsieur » et le vouvoie). Car ce que veut montrer Hugo à travers le personnage de l’évêque, c’est l’adéquation parfaite entre ses actes et ses paroles et les
Réponses aux questions – 52
valeurs qu’il doit défendre : si Mgr Myriel invoque Jésus-Christ et appelle Jean Valjean « mon frère », ce ne sont pas des paroles creuses ou hypocrites, car il le traite vraiment comme son égal et applique les principes évangéliques de partage et d’amour du prochain. y Ce n’est pas l’abbé qui est ici l’objet de la critique ; au contraire, le narrateur semble même éprouver pour lui une certaine compassion. Celle-ci est sensible par les phrases qui lui sont consacrées, qui deviennent de plus en plus longues et lyriques avec leurs répétitions (« devant un mystère ineffable auquel il n’avait jamais pensé, un mystère auguste et saint, l’incarnation d’une âme nouvelle, le grand mystère de la vie qui commence »). Le prêtre n’est jamais ridicule ni malsain (cf. « très chaste »), et le narrateur montre très bien la fascination de plus en plus forte qu’il éprouve devant ce bébé : « ne sachant comment le tenir », « regardant fixement », « Il le considérait », « il contemplait l’enfant », « il restait les yeux fixés sur cette figure rose et bouffie » ; l’émotion du personnage grandit à mesure que le contact avec le petit enfant se fait plus proche : « il semblait surpris », « avec une tendresse éveillée au fond de lui », « il restait ému », « lui mettait les larmes aux yeux », « sanglotait ». Si le narrateur l’isole au milieu de la foule en liesse, ce n’est pas pour le condamner, mais pour suggérer au contraire qu’il est le seul à comprendre et à vivre le sens profond de l’événement ; et les plaisanteries grossières dont il est l’objet suscitent aussi notre compassion. Ce qui est condamné, ce n’est donc pas l’homme lui-même, mais le système dont il est victime, c’est-à-dire l’Église qui oblige ses prêtres à refuser ce qui fait la vie même (« le grand mystère de la vie qui commence, de l’amour qui s’éveille, de la race qui se continue, de l’humanité qui marche toujours ») et donc à vivre en marge des autres hommes, dans une frustration qui les rend profondément malheureux.
Travaux d’écriture
Question préliminaire Dans ces cinq extraits, l’éloge ou le blâme ne sont quasiment jamais exprimés de façon directe par le narrateur livrant son jugement (on peut juste relever le dernier paragraphe du texte A, en particulier l’expression « fanatisme rigide », ou les termes qualifiant la « fureur » du prêtre dans le texte B). Le narrateur peut alors procéder de façon indirecte et implicite, par la narration elle-même qui laisse le lecteur libre de produire son propre jugement en se fondant sur les actes et les paroles des personnages : c’est le cas des trois textes de Maupassant (en particulier le texte B – cf. question 2) et de celui de Victor Hugo (texte D) ; on peut toutefois noter que la narration n’est jamais objective mais toujours dirigée, orientée par un narrateur habile, même s’il reste dissimulé. Les extraits A et D ont recours au discours direct, qui fait s’exprimer les personnages et permet au lecteur de juger : ainsi, le discours tolérant et familier de l’abbé Picot s’oppose au « ton cassant » et au vocabulaire dominateur de l’abbé Tolbiac (texte A) ; les paroles de Mgr Myriel révèlent un homme plein de bienveillance et nourri du message évangélique (texte D). Tous ces textes utilisent, d’une façon ou d’une autre, l’opposition pour mettre en lumière les contrastes et faciliter ainsi éloge et blâme. Dans le texte A, les deux abbés représentent deux faces (positive/ négative) du prêtre ; dans le texte B, le narrateur oppose la folie fanatique du prêtre à l’innocence des animaux et des enfants ; Balzac (texte C) propose un portrait antithétique des deux prêtres, les défauts de l’un faisant ressortir ceux de l’autre ; Hugo (texte D) présente le forçat et l’évêque comme la face obscure et la face lumineuse de l’être humain, tout en montrant comment Mgr Myriel se détache par sa bonté de l’égoïsme des autres habitants de la ville. Enfin, dans le dernier texte, Maupassant isole l’abbé pour mieux suggérer l’intensité et la pureté de son émotion au milieu des paillardises et des vulgarités. Maupassant (textes A et B) ainsi que Victor Hugo (texte D) se servent des personnages pour exprimer éloge et blâme : le choix du point de vue interne de Jeanne (texte A) oriente positivement le jugement du lecteur sur l’abbé Picot par le recours à l’émotion, mais souligne au contraire le danger insidieux que représente l’abbé Tolbiac pour son esprit exalté et facilement manipulable ; dans le texte B, Jeanne, son père et les paysans incarnent trois réactions (compassion, colère indignée et incompréhension réprobatrice) qui influent sur celles du lecteur (cf. question 2) ; enfin, Hugo fait passer un éloge direct et insistant de l’évêque par les paroles et les attitudes de Valjean (cf. question 4). Le texte de Balzac (texte C) offre un procédé différent en se limitant au point de vue externe et en
Une vie – 53
utilisant des opinions différentes pour suggérer le caractère mystérieux et inquiétant de Troubert (cf. question 3). On peut remarquer enfin que les textes B, D et E sollicitent fortement l’émotion du lecteur dans la construction de son jugement : horreur et indignation devant l’acte sauvage de Tolbiac, admiration devant la bonté de l’évêque, sympathie pleine de compassion pour le prêtre du Baptême.
Commentaire
Introduction Balzac est passé maître dans la création de personnages, dont il brosse magistralement des portraits suggestifs qui restent dans les mémoires. On voit son talent à l’œuvre dans cet extrait du Curé de Tours, où il bâtit avec rigueur le portrait antithétique du chanoine Troubert et du vicaire Birotteau, élevant ces deux obscurs abbés de province au rang de types romanesques. Nous verrons comment cet auteur présente au lecteur ce double portrait et l’invite à le déchiffrer.
1. Un portrait antithétique A. Une construction rigoureuse a) Un double portrait • Annoncé par la première phrase : « deux figures » / « deux abbés ». • Chacun des deux personnages a droit à une phrase ou à un morceau de phrase, puis est opposé à l’autre (à noter que Balzac consacre nettement plus de place à Troubert, car Birotteau est déjà largement connu du lecteur). • Emploi de termes d’opposition : « contrastes », « tandis que » (3 fois), « au contraire », « mais ». b) La progression du texte • Le narrateur construit avec beaucoup de rigueur l’opposition, en prenant point par point des éléments du portrait : – la silhouette et le tempérament : « grand et sec », « bilieux » ≠ « grassouillet » ; – la physionomie et ce qu’elle révèle : « figure », « idées », « expression », « sentiments » ; – la manière d’être : attitudes et réactions ; – l’impression générale qu’ils provoquent chez ceux qui les voient : « à la première vue », « à ceux qui le voyaient » ; – la démarche. • Conclusion sur une ressemblance paradoxale. B. Deux personnages strictement opposés a) Une opposition à la La Bruyère • Balzac s’amuse à créer véritablement un « couple » de personnages (comme Giton et Phédon, le riche gras et le pauvre maigre) : – leurs noms semblent fonctionner en chiasme ; – ils représentent deux « tempéraments » dans le système des humeurs : le « bilieux » ≠ le sanguin (« rougeaude », « sans fiel »). • Le narrateur les désigne par deux périphrases : « le haut chanoine » ≠ « le bon vicaire ». • Le langage employé par le narrateur pour les évoquer n’est pas le même : beaucoup plus familier pour Birotteau (« familièrement », « grassouillet », « rougeaude », « trottait »), il s’élève jusqu’à la métaphore pour Troubert (évocation des voûtes et des statues de la cathédrale). • Le narrateur va donc les opposer selon une sorte de typologie. b) Le rond • Birotteau est tout au long du texte caractérisé par la rondeur : – dans son physique : « grassouillet », « ronde » ; – dans sa démarche : « circulait », « rouler sur lui-même » ; – dans le vocabulaire : Balzac semble s’amuser à multiplier les allitérations en ou ou en o (évoquant toujours la rondeur dans leur écriture et leur prononciation) à propos du personnage : déjà dans son nom, puis « ronde et rougeaude », « bonhomie », « tout », « sourire doux », « rouler », « tournure », « vouer ». • Cette rondeur physique connote le bon vivant (« aimait les bons morceaux »). • Elle évoque la rondeur psychologique d’un personnage sans aspérité, dont on a vite « fait le tour » !
Réponses aux questions – 54
c) La ligne • Troubert est caractérisé par la ligne : – dans son physique : « grand et sec », « longue », « rides profondes », « plis de son visage », « le haut chanoine », « plis de sa soutane » ; – dans les images qui l’accompagnent : « sa figure cambrée était en harmonie avec les voussures jaunes de la cathédrale », « les plis de sa soutane avaient quelque chose de monumental, digne de la statuaire » – il semble ne faire qu’un avec la structure élancée de la cathédrale ou la rigidité des statues. • Cette rectitude de la ligne va de pair avec la hauteur et la profondeur, soulignées plusieurs fois : « rides profondes », « haute et profonde ambition », « le haut chanoine » ; alors que Birotteau, dans sa rondeur, semble toujours au ras du sol, Troubert s’élève au-dessus des autres et semble les dominer autant que les voûtes de la cathédrale. • Elle connote l’austérité (« fatigué par de trop longs jeûnes ») et la primauté accordée à l’intellectuel aux dépens du matériel (« graves méditations »).
2. Un portrait à déchiffrer A. Le choix du point de vue externe a) La « physiognomonie » • Balzac se limite ici au point de vue externe : on ne connaît des personnages que ce que pourrait en voir (ou en déduire) un observateur extérieur (leur « figure », « physionomie », « air », « tournure »). Le narrateur se refuse ici à émettre un jugement omniscient et définitif sur eux, du moins en ce qui concerne Troubert. • Mais l’extérieur permet de révéler l’intériorité, comme c’est le cas avec la théorie des humeurs dont nous avons parlé dans la première partie et qui associe une constitution physique avec un tempérament psychologique. Pour cela, il faut « examiner avec attention » l’extérieur du personnage pour y « découvrir » ce qui se cache derrière les apparences. Le narrateur le fait d’emblée à propos de Birotteau, qui ne semble pas avoir grand-chose à cacher : « la figure de Birotteau peignait une bonhomie sans idées ». De même, les « paupières presque toujours abaissées » de Troubert sont le signe du « voile que de graves méditations jettent sur les traits ». b) Des interprétations contradictoires Balzac complique singulièrement ce jeu du déchiffrage, puisque le personnage semble, par sa réserve, ne pas laisser prise à l’interprétation ; c’est alors que le narrateur a recours à des jugements contradictoires : certains croient voir derrière la façade imperturbable du chanoine « une haute et profonde ambition », et d’autres refusent d’y voir quoi que ce soit, si ce n’est un personnage « hébété » ou « fatigué ». Et le narrateur se garde bien de trancher à ce moment du récit. B. Le vide et le plein a) Birotteau : un personnage vide • La rondeur de Birotteau ne se révèle finalement pleine que de vide ! Le personnage n’a rien à cacher, et sa surface le révèle tout entier : « tout expansion, tout franchise » (noter la répétition de « tout » qui montre l’extrême simplicité du personnage). • Il est réduit à des préoccupations superficielles : « bons morceaux », « bagatelle ». • Il paraît proche d’un enfant, voire d’un animal : « s’amusait », « trottait ». • Il est constitué de manques, comme le souligne la répétition de « sans » : « sans idées », « sans fiel ni malice », « sans gravité ». • Sans profondeur, sans intelligence de la situation, sans poids (malgré son embonpoint !), il sera emporté comme un fétu de paille par l’ambition de Troubert. • Voici le tableau qu’en fait Balzac à la fin du roman : « Ce curé frappé par l’archevêque était pâle et maigre. Le chagrin, empreint dans tous ses traits, décomposait entièrement ce visage qui jadis était si doucement gai. La maladie jetait sur ses yeux, naïvement animés autrefois par les plaisirs de la bonne chère et dénués d’idées pesantes, un voile qui simulait une pensée. Ce n’était plus que le squelette du Birotteau qui roulait, un an auparavant, si vide mais si content, à travers le Cloître. » Par une sorte de cruelle ironie, Birotteau a perdu la seule caractéristique qui était vraiment à lui – son embonpoint – et se retrouve identique à Troubert, mais toujours comme une sorte d’enveloppe vidée de toute force de vie. b) Troubert : un personnage complexe • Contrairement à Birotteau chez qui le caractère est immédiatement déchiffrable, Troubert apparaît comme dissimulé :
Une vie – 55
– le personnage semble masquer volontairement idées et sentiments (« calme parfait », « Il parlait rarement et ne riait jamais ») ; – la moindre manifestation d’émotion est fugace (« en certains moments », « Quand il lui arrivait d’être agréablement ému ») et aussitôt dissimulée (« un sourire faible qui se perdait dans les plis de son visage ») ; on peut remarquer cette image des « plis » qui revient deux fois, comme si son visage servait, comme sa soutane, à dissimuler ce qu’il est réellement ; – « ses paupières presque toujours abaissées » sont un signe du « voile » qu’il veut conserver face aux autres ; – la couleur jaune qui le caractérise avec insistance (« teint jaune », « yeux orangés », « cheveux roux », « harmonie avec les voussures jaunes de la cathédrale ») est traditionnellement celle de Judas, du traître… • Contrairement à la « bonhomie » sans malice de Birotteau, ce qui transparaît par moments de Troubert en fait un personnage inquiétant : – « une expression pleine d’ironie ou de dédain » ; – un regard « clair et perçant » ; – son attitude générale (« pas solennel », « œil sévère ») ; – il suscite la crainte (« sentiment de terreur involontaire », « il excitait le respect », « donnant lieu de le redouter »). • Contrairement à Birotteau, tout d’une pièce dans la médiocrité, Troubert apparaît comme un être paradoxal : – Faut-il le croire vide comme Birotteau (« hébété ») ou plein d’ambition ? – Où se situe finalement sa vraie nature ? Est-il animé par le temporel ou le spirituel ? Est-il vraiment calme ou dévoré de passion secrète ? – Le narrateur pousse le paradoxe à l’extrême dans la dernière phrase et brouille encore plus les pistes en l’associant à Birotteau et en lui attribuant les termes « insignifiant » et « simple » qui semblent contredire tout le portrait…
Conclusion Ce double portrait nous montre comment Balzac sait jouer des ressources du point de vue externe en obligeant le lecteur à interpréter les signes et les images. Distillant les informations, recourant à la contradiction et au paradoxe, le narrateur entretient le suspense en créant un personnage ambigu. Le romancier sait aussi, en opposant ces deux obscurs prêtres de Tours, les transformer en héros dont l’affrontement inégal prendra une dimension exemplaire.
Dissertation
Introduction Le genre narratif (roman, nouvelle, conte…) a été longtemps décrié pour ses excès d’affabulation qui paraissaient le réduire à l’évocation d’un univers purement imaginaire et sans prise sur la réalité. Pourtant, à partir du XVIIIe siècle, il a été souvent utilisé par les écrivains pour faire passer leurs idées ou leur vision du monde. Nous verrons donc quels sont les atouts et les limites du genre narratif pour défendre efficacement ses opinions.
1. Un genre qui accroche le lecteur A. Plaisir de l’imaginaire • La fiction narrative peut déplacer le lecteur dans l’espace ou le temps : – dans l’espace : Diderot dans Jacques le Fataliste ou Voltaire dans Candide se servent du motif du voyage pour multiplier expériences et rencontres ; Balzac et Zola essaient de donner un panorama de la société française en multipliant les villes ou régions qui servent de cadre à leurs romans ; – dans le temps : les romans du XIXe siècle qui se veulent ancrés dans la réalité de leur époque représentent un « dépaysement » temporel stimulant pour les lecteurs de notre époque (la vie de Jeanne dans Une vie est bien éloignée de celle des femmes de maintenant) ; la science-fiction cultive ce décalage (Le Meilleur des Mondes d’Huxley, 1984 d’Orwell – écrit en 1948 – permettent de pousser à l’extrême certaines tendances de notre société, tout en emmenant le lecteur dans un autre temps) ; le conte de fées (Perrault) choisit l’irréalité et le merveilleux.
Réponses aux questions – 56
• La fiction peut ainsi préserver la susceptibilité du lecteur et ne pas l’attaquer de front : Orwell pensait d’abord intituler son roman 1949, mais son éditeur a refusé pour ne pas choquer les lecteurs. Montesquieu, dans les Lettres persanes, passe par le biais des Persans pour critiquer la France. B. Effets de dramatisation a) L’intrigue • La narration donne envie de lire jusqu’au bout : conflits, aventures, évolution d’une destinée (Jeanne va-t-elle un jour être heureuse ?)… • Les auteurs jouent avec le suspense : Une vie, paru en feuilleton, sait ménager l’attente du lecteur. • La nouvelle est souvent un « concentré » de romanesque, où tous les détails sont significatifs, et maintient le suspense jusqu’à la « chute ». • Le genre narratif est, la plupart du temps, construit sur des « scènes » dramatiques ou efficaces : la confrontation de l’évêque et du bagnard dans Les Misérables, la mort de Mirza dans Une vie… b) L’émotion • C’est une des grandes forces du genre narratif, qui permet à la fois d’accrocher le lecteur et de le faire réagir, de l’impliquer dans la fiction. • Le genre narratif peut jouer de toutes les émotions : l’horreur et l’indignation (texte B), l’admiration (texte D), la compassion (texte E), la révolte devant la misère dans les romans de Zola, le dégoût devant certaines pratiques sociales chez Balzac (l’écrasement du faible Birotteau par le puissant Troubert), la peur dans les nouvelles fantastiques de Maupassant, etc. C. Incarnation • Grâce à la fiction, les idées ne sont pas abstraites mais incarnées, elles prennent l’épaisseur d’un personnage, d’une situation : – défauts humains identifiés par les personnages des Contes de Perrault (la curiosité dans « Barbe-Bleue »…) ou par des personnages fortement typés dans le roman (abbé Tolbiac dans Une vie, les deux abbés dans Le Curé de Tours…) ; – philosophie de Voltaire vécue par ses personnages (Candide, l’Ingénu) et leur destinée ; – revendications portées par des personnages directement concernés (Jean Valjean réclamant la justice et l’humanité). • Effet d’authenticité par le réalisme d’une situation que le lecteur contemporain peut connaître : la vie de Jeanne est ancrée dans la réalité de son temps (type d’éducation liée à un milieu social, appauvrissement de la noblesse, condition de la femme). • Phénomène d’identification : le lecteur imagine les personnages de fiction comme des personnes réelles, leur donne un visage, une voix. Grâce à l’émotion suscitée, il vit leur destin avec eux et ne les oublie plus.
2. Une argumentation efficace A. Plus accessible • Tout en jouant sur l’illusion, la fiction renvoie au concret, à l’expérience du lecteur (on connaît les animaux de La Fontaine !). • C’est une démonstration par l’exemple, une pensée en acte, donc plus facile à saisir que la réflexion abstraite : la scène du massacre de la chienne (texte B) est plus claire qu’une explication abstraite sur les effets du fanatisme et de la frustration. • La complexité et la longueur d’un roman permettent une vision claire et complète du problème : Balzac pose toujours le cadre socio-historique de son roman, explique les antécédents de ses personnages, etc. ; Zola explique la déchéance de Gervaise jusqu’au bout. B. Une démonstration efficace a) Dans le choix de l’intrigue • L’auteur joue sur la fiction pour choisir une situation représentative, dont il peut isoler des éléments caractéristiques : l’avalanche de catastrophes qui s’abattent sur Candide, confronté à tous les malheurs du monde, ou sur Jeanne, qui accumule les échecs à cause de son inadaptation à la réalité ; Zola et Balzac expérimentent tous les milieux sociaux. • Le réalisme et l’ancrage dans le réel donnent un poids d’authenticité à l’opinion défendue : la peinture de l’alcoolisme comme fléau social dans L’Assommoir de Zola s’appuie sur les Carnets d’enquête de celui-ci.
Une vie – 57
• Le recours à la fiction permet aussi de se débarrasser des bornes de la réalité pour pousser l’expérience à l’extrême : c’est le cas du conte ou de la science-fiction (ou anticipation) ; c’est aussi le cas dans La Peste, où Camus imagine une ville close sur elle-même et confrontée à l’épidémie. b) Dans le choix des personnages • Même principe : la fiction permet le grossissement des traits (l’hypersensibilité de Jeanne), les stéréotypes (l’abbé Tolbiac), le jeu des oppositions (les deux abbés chez Balzac, Valjean/Javert dans Les Misérables). • Le personnage peut devenir clairement le porte-parole de l’auteur par les mots mais aussi les attitudes et les actes : le docteur Rieux dans La Peste de Camus. • Au contraire, le personnage devient une cible de la satire, en incarnant ce que l’auteur veut critiquer : les nobles « momifiés » dans leur passé dans Une vie. • Ou encore le personnage est victime d’un phénomène social que l’auteur veut dénoncer : l’abbé du Baptême de Maupassant est malheureux du fait de la frustration découlant du célibat imposé par l’Église. C. Une argumentation plus « participative » • C’est au lecteur de trouver le sens qui ne lui est pas toujours donné explicitement : identifier les personnages ou phénomènes politiques visés dans La Ferme des animaux d’Orwell ; l’interprétation peut varier selon les époques (Orwell dénonce le stalinisme, mais on peut y voir toute sorte de totalitarisme). • Travail de déchiffrage de la part du lecteur : repérer quel fait de société français dévoile le regard faussement naïf des Persans de Montesquieu, analyser les causes des échecs de Jeanne… • Jeu sur les points de vue : dans le cas des points de vue interne et externe, le travail du lecteur est plus grand, car le jugement ne lui est pas donné directement par le narrateur, c’est à lui de le construire. • Par l’identification, le lecteur intériorise la cause défendue et s’y implique davantage (révolte devant l’injustice sociale dans Germinal de Zola, Les Misérables d’Hugo), car le lecteur « vit » la dure réalité des héros de l’histoire.
3. Les limites de l’argumentation narrative A. Les limites dans le choix des sujets • Le genre narratif se prête particulièrement aux sujets traitant de l’humain et permet de faire passer analyses et convictions dans les domaines psychologique, sociologique, historique. • Mais la réflexion plus théorique peut difficilement passer par la narration ou la fiction : la philosophie théorique, les sciences plus abstraites ou qui ne traitent pas de l’humain. • La métaphysique, qui, comme son nom l’indique, se situe au-delà de la réalité tangible, semble échapper au genre narratif. Du moins, le fantastique peut y donner accès, mais davantage sur les plans de l’expérience et de l’émotion que de la réflexion. B. Les dangers • L’œuvre peut se trouver trop limitée à son époque et au sujet précis qu’elle veut démontrer et ne plus intéresser les générations futures : certains développements de Balzac sur la société de son temps intéressent les historiens mais paraissent indigestes à beaucoup de lecteurs. • Une œuvre trop démonstrative peut perdre son caractère littéraire : c’est ce que l’on a reproché au naturalisme de Zola qui n’a finalement pas duré longtemps. • Si Zola est encore beaucoup lu aujourd’hui, c’est davantage en vertu de ses qualités de romancier que du contenu de ses thèses sur l’hérédité !
Conclusion Le recours au genre narratif pour défendre une opinion présente finalement l’avantage de frapper l’esprit du lecteur, de l’impliquer dans la cause défendue et surtout de l’amener à réfléchir par lui-même. Le cinéma saura également utiliser ces mêmes caractéristiques, avec le poids des images en plus…
Écriture d’invention On valorisera la pertinence des élèves dans le choix des personnages qui doivent être bien représentatifs d’un statut ou d’un type : par exemple, le professeur démagogique opposé au professeur
Réponses aux questions – 58
très rigoureux, l’ambitieux hypocrite ou écrasant, l’élève effacé ou « grande gueule »… Les élèves devront utiliser les ressources du portrait à la manière de Balzac, en partant de l’extérieur pour révéler l’intérieur. Ils pourront opposer éloge et blâme ou ne se servir que d’un seul registre, mais devront en varier les procédés (en particulier, le jeu des points de vue).
C h a p i t r e X I ( p p . 2 1 8 à 2 3 9 )
◆�Lecture analytique de l’extrait (pp. 240-241)
Une scène de reconnaissance u Jeanne vient de se réveiller et se trouve donc dans un état confus (« trouble d’esprit du réveil »). De plus, elle a subi un grand choc au moment de l’enterrement de Tante Lison, ce qui accentue encore l’agitation et la confusion de son esprit (« le sommeil fiévreux qui suit les grands malheurs »). Ce choc psychologique et son accablement physique et moral (Maupassant indique quelques lignes avant notre extrait : « elle tomba dans un sommeil d’épuisement, accablée de fatigue et de souffrance ») expliquent qu’elle ne se souvienne plus clairement de ce qui s’est passé (« Elle se rappelait cela confusément », « le souvenir obscur de la dernière journée »). Son esprit semble fonctionner encore à vide, fiévreusement, de façon obsessionnelle (« obstinément » ; « cette obsession l’agitait, l’énervait »), ce que le narrateur transcrit par l’accumulation de questions sans réponse. Cette sorte d’état second de Jeanne rend la scène encore plus dramatique en retardant le moment de la reconnaissance. v Le narrateur nous montre très clairement les étapes de la reconnaissance dans la conscience de Jeanne : – la première question qu’elle se pose (« Qui était cette femme ? ») trouve un élément de réponse (« Il lui semblait pourtant qu’elle avait vu cette figure ») ; – ce semblant de réponse fait naître d’autres questions, plus précises (« Mais quand ? Mais où ? ») ; – la réponse s’affirme, puisqu’on arrive à une certitude : « Certes elle avait vu ce visage ! » (« semblait » ≠ « certes ») ; – la question « Quand et où ? » se repose alors (« Était-ce autrefois ? Était-ce récemment ? ») ; – la réponse à cette question apporte un premier élément d’identification : « C’était la femme qui l’avait relevée au cimetière, puis couchée » ; – de nouveau, la réponse appelle encore plus de questions, de plus en plus précises : « Mais l’avait-elle rencontrée ailleurs, à une autre époque de sa vie ? Ou bien la croyait-elle reconnaître seulement dans le souvenir obscur de la dernière journée ? Et puis comment était-elle là, dans sa chambre ? Pourquoi ? » ; – il faudra que Rosalie emploie son langage d’autrefois (« maîtresse », « mamz’elle Jeanne ») pour que tout le jour se fasse. Il est intéressant d’observer comment le narrateur traduit avec rigueur le retour progressif à la conscience et à la réalité qui s’opère dans l’esprit de Jeanne, chaque question résolue en faisant naître d’autres, de plus en plus précises et concrètes. w Le texte passe d’« une femme » à « cette femme » et « la femme » (employé 4 fois), puis, jusqu’à la reconnaissance, nous trouvons « cette figure », « la dormeuse », « l’inconnue ». Le narrateur multiplie les termes vagues, sans caractérisation, pour prolonger le suspense. Et ce sera Jeanne elle-même qui la nommera, en réponse à sa propre interpellation : « Rosalie, ma fille. » x Jeanne, tout d’abord, se penche pour mieux voir le visage de la femme inconnue, puis se lève « doucement pour regarder de plus près la dormeuse, et elle s’approch[e] sur la pointe des pieds ». Rosalie alors se redresse et elles se trouvent très proches, sans qu’elles se touchent encore vraiment (« si près que leurs poitrines se frôlaient »). Enfin, Rosalie prend l’initiative d’un contact beaucoup plus étroit en la prenant dans ses bras et en l’embrassant, « presque couchée sur Jeanne ». Le narrateur a bâti le dernier paragraphe comme une réponse de Jeanne aux gestes de Rosalie : « ouvrant les bras »/« lui jetant les bras autour du cou », « la saisit »/« l’étreignit », « l’embrassant »/« la baisant ». Et la dernière phrase multiplie les termes évoquant l’union : « toutes les deux », « étroitement », « mêlant », « ne pouvant plus desserrer leurs bras ». L’extrait obéit donc à une belle progression : le rapprochement dans l’espace qui est le fait de Jeanne provoque l’initiative de Rosalie. L’union entre les deux devient de plus en plus forte, jusqu’à une
Une vie – 59
communion totale qui s’opère à travers les gestes des bras et les larmes. Le narrateur suggère ainsi avec un sens très fort de l’émotion dramatique le lien intense qui existe entre ces deux femmes par-delà les années et le parallélisme qui unit leur destin, traduit ici par la réciprocité de leurs réactions. y Cette scène se déroule d’abord « en temps réel » : le temps de l’écriture coïncide avec celui de l’action, et on suit exactement la progression des gestes des deux personnages, ce qui renforce le suspense. Le décor est posé en termes précis (cheminée, fauteuil, lit), avec l’éclairage (« la lueur tremblotante de la mèche »), et le narrateur note avec exactitude les déplacements des personnages presque comme pourrait le faire un metteur en scène (« Elles se trouvaient face à face, si près que leurs poitrines se frôlaient ») ; des « didascalies » précises accompagnent la gestuelle (« se leva doucement », « s’approcha sur la pointe des pieds », « la reposait doucement »). Enfin, la dernière partie de la scène se compose essentiellement d’un dialogue. Maupassant a voulu ainsi insister sur le côté dramatique de cette scène, en la « donnant à voir » le plus précisément possible à son lecteur, pour en souligner l’émotion. En mêlant dans sa narration cet aspect théâtral et le point de vue interne de Jeanne, il renforce le pathétique.
Un portrait U Maupassant a choisi d’éclairer cette scène par une « lueur tremblotante » : du point de vue dramatique, cet éclairage indistinct va retarder la reconnaissance de Rosalie par Jeanne et motiver le déplacement de celle-ci pour observer la femme de plus près. Mais c’est aussi l’occasion pour le narrateur de donner une grande intimité aux retrouvailles entre les deux femmes : le calme de la nuit, le petit cercle de lumière douce qui les réunit contrastent avec le tourbillon d’épreuves et de deuils successifs qui ont anéanti Jeanne et font pour elle de ce moment une pause consolante et réconfortante. Cette scène nocturne permet de consacrer à Rosalie, toujours évoquée ailleurs dans l’action, un beau portrait de femme endormie. V Ce sont la paix et l’abandon essentiellement qui se dégagent de ce portrait de Rosalie : son corps est complètement relâché dans le sommeil (« paisiblement », « la tête inclinée », « le bonnet tombé », « ses larges mains pendaient ») ; le narrateur a choisi de décrire Rosalie endormie précisément pour renforcer encore cette impression de sécurité, de calme, de refuge qu’elle va susciter chez Jeanne. Le sommeil de la servante met aussi en valeur sa force tranquille (« forte » ; « carrée, puissante » ; « larges mains »). On peut se demander si ce sommeil n’est pas une sorte d’image de son attitude devant la vie, confiance simple et forte, abandon sans questions ni angoisse, tout à l’opposé du « sommeil fiévreux » de Jeanne, fait de rêves inassouvis qui se transforment en cauchemars… L’âge l’a mûrie (« ses cheveux grisonnaient ») mais sans la vieillir prématurément, puisqu’elle conserve sa force et son teint coloré, contrairement à Jeanne, devenue une « femme à cheveux blancs, maigre et fanée » (quelques lignes après notre extrait). W La force de Rosalie se retrouve dans la façon dont elle porte Jeanne « avec la force d’un homme » ; sa simplicité réaliste rejaillit dans son langage, direct, grondeur et plein d’autorité (« grommela », « Voulez-vous bien vous r’coucher ! »). Mais ses gestes sont doux et paisibles, jamais brutaux (« elle la reposait doucement », « l’embrassant ») ; toute son attitude va conforter l’impression de sécurité qui se dégageait de son portrait : elle ouvre ses bras comme un refuge, « enlève » Jeanne comme si elle la sauvait du malheur, se couche sur elle comme pour la protéger. X Le physique de Rosalie, sa carrure et ses « larges mains » évoquent une travailleuse ; elle porte le bonnet des femmes de la campagne. Le discours direct reproduit la « parlure » normande (« v’là », « d’bout », etc.) et ses expressions populaires (« à c’t’heure »). Enfin, sa façon de s’adresser à Jeanne en l’appelant « maîtresse » et « mamz’elle Jeanne », comme vingt-quatre ans auparavant, connote la servante.
Servante et maîtresse at Jeanne et Rosalie conservent l’une et l’autre l’appellation conforme à leur ancien statut : « mamz’elle Jeanne » et « maîtresse » pour l’une, et le simple prénom et « ma fille » pour l’autre. Mais le temps a passé, les deux femmes ont évolué, et gestes et attitudes outrepassent largement ce statut. C’est Rosalie qui prend l’initiative d’abord en paroles, en s’adressant avec autorité à Jeanne, en la
Réponses aux questions – 60
réprimandant et même en lui donnant des ordres qui n’admettent pas de réplique (« Voulez-vous bien vous r’coucher ! ») ; de même, elle prend sa maîtresse dans les bras sans lui en demander la permission, alors que celle-ci, contrairement à la scène du cimetière qui précède, est parfaitement consciente. Mais, surtout, elle s’autorise, en pleurant et en l’embrassant, une démonstration d’affection que la réserve d’une servante (qui n’a pas à exprimer ses sentiments) n’aurait pas dû lui permettre ; Jeanne également répond aussitôt à l’émotion et à l’affection de Rosalie en oubliant complètement toute distance hiérarchique. La dernière phrase de l’extrait insistant sur leurs bras et leurs larmes montre qu’elles laissent s’exprimer toute leur affectivité en passant par-dessus les barrières sociales : ce sont deux femmes qui pleurent dans les bras l’une de l’autre. ak Rosalie joue essentiellement le rôle d’une mère, en la prenant dans ses bras, en la faisant se recoucher pour qu’elle n’attrape pas froid (dans les lignes qui suivent, on la verra même la border dans son lit) et en l’embrassant comme ferait une mère avec un enfant malade. Mais le narrateur souligne aussi qu’elle a des côtés masculins (« carrée, puissante » ; « force d’un homme »), ce qui peut lui donner le statut d’un père, d’un frère, c’est-à-dire de l’autorité et du soutien masculins dont, dans l’esprit de l’époque, une femme a toujours besoin : ici, elle prend l’initiative, donne des ordres, et, plus tard, elle gérera les biens de Jeanne – fonction typiquement masculine. al Leurs larmes expriment évidemment leur émotion de se retrouver après tant d’années et manifestent leur affection et leur tendresse mutuelles. On peut imaginer aussi que Rosalie est bouleversée de retrouver sa maîtresse dans cet état de délabrement physique et moral et de fragilité absolue. Des moments douloureux leur reviennent à la mémoire (l’adultère de Julien, la tentation du suicide pour Jeanne, le départ de Rosalie), et le narrateur notera quelques lignes plus loin que Jeanne était « toute vibrante de vieux souvenirs surgis en son âme ». Pour l’héroïne, si attachée au passé, la présence à ses côtés de Rosalie semble effacer vingt-quatre ans de sa vie et tous les deuils qu’elle a connus. De plus, une part de culpabilité se mêle sans doute à leur émotion. am Cette union est mise en valeur par le mouvement de l’une vers l’autre (cf. question 4), la réciprocité de leurs réactions et surtout par les larmes qui se mêlent. Ces larmes qui coulent en abondance chez les deux femmes révèlent leur proximité, malgré les différences de leur tempérament ; Rosalie, comme Jeanne, pleure beaucoup dans le roman (« comme une source » avant la nuit de noces, « dans la posture qu’on prête aux Madeleines » pendant la confrontation avec Jeanne). Enfin, la dernière phrase a pour sujet les deux femmes, indistinctement, et l’accumulation des participes qui s’y rattachent ne fait que souligner leur union (« enlacées », « mêlant », « ne pouvant plus desserrer »). an La scène est émouvante d’abord par sa progression et l’effet de surprise : le narrateur ménage le suspense avec les questions successives de Jeanne, puis, dans les deux derniers paragraphes, laisse la sensibilité s’exprimer sans réserve ; celle-ci semble submerger brutalement Rosalie (« l’embrassant éperdument »), sans que le lecteur y soit préparé par sa première phrase au discours direct, plutôt brusque. On sent bien que l’émotion des deux femmes ne peut passer que par les gestes, car elles ne semblent pas capables d’articuler autre chose que leurs noms, en « balbutiant ». Ces retrouvailles émeuvent également le lecteur, car elles peignent une émotion qui n’est entachée d’aucun sous-entendu, d’aucune faille (comme c’est souvent le cas dans le roman, même lors de la mort de la baronne, où le chagrin si profond et sincère de Jeanne vient se heurter à la découverte de l’adultère de sa mère). Ici, les deux femmes expriment leur tendresse sans arrière-pensées, en effaçant d’un seul coup tout le passé : il est révélateur que Rosalie revienne à l’appellation « Mamz’elle Jeanne », comme si elle voulait gommer tout le désastre du mariage de Jeanne et de l’adultère de Julien ; de même, les seuls mots qui viennent à l’esprit de Jeanne sont « ma fille », alors qu’elle s’adresse maintenant à une femme mûre. Enfin, cette page montre avec émotion l’effacement de toute distance entre ces deux femmes aux statuts opposés, qui se retrouvent ici égales et proches comme deux sœurs (n’oublions pas qu’elles sont sœurs de lait) ; c’est un moment de douceur pour Jeanne qui semble enfin avoir trouvé quelqu’un qui va l’aider à sortir de la solitude mortelle dans laquelle elle est tombée. ao Il est intéressant de revenir à la première apparition de Rosalie dans le roman : « une grande fille de chambre forte et bien découplée comme un gars. C’était une Normande du pays de Caux, qui paraissait au moins vingt ans, bien qu’elle en eût au plus dix-huit. On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la sœur de lait de Jeanne. Elle s’appelait Rosalie. Sa principale fonction consistait d’ailleurs à guider les pas de sa maîtresse » (p. 12). On voit déjà ici sa proximité avec Jeanne, puisque, sœur de lait de sa
Une vie – 61
maîtresse, elle est « comme une seconde fille » ; le texte mentionne la force qui émane de sa carrure, et on peut remarquer que sa fonction est déjà de soutenir et guider sa maîtresse, soutien physique quand il s’agit de la baronne, mais aussi moral quand il s’agira de Jeanne. Si certaines caractéristiques de Rosalie sont déjà présentes dans les premières pages, la servante a fait bien du chemin quand on la retrouve dans notre extrait : celle qui est souvent nommée « la petite bonne », victime sanglotante et apeurée de Julien, troquée comme une marchandise à un paysan, s’est transformée en maîtresse femme, prenant les initiatives aussi bien sur le plan pratique qu’affectif. Cette scène annonce en quelques traits l’ascendant et l’autorité qu’elle va prendre sur sa maîtresse, le rôle de protection qu’elle jouera auprès d’elle et la relation de tendresse un peu bourrue de sa part qui s’installe entre elles.
◆�Lectures croisées et travaux d’écriture (pp. 242 à 252)
Examen des textes et de l’image u On peut rapprocher les textes B et D où l’on voit la servante s’agenouiller devant sa maîtresse et celle-ci refuser ce lien hiérarchique de soumission pour demander à son tour pardon et ainsi instaurer une relation d’égalité : « la reine était aussi tombée à genoux devant elle, et toutes deux, embrassées, se pâmèrent longuement » ; dans un mouvement inverse, la comtesse (texte D) relève Suzanne et l’embrasse. Les textes de Maupassant et de Flaubert (textes A et E) sont également très comparables : les scènes se déroulent dans un contexte de deuil, et les femmes vont se retrouver égales dans la douleur ; l’émotion passe d’abord par l’étreinte, et les deux auteurs emploient la même expression, mais, chez Flaubert, c’est la maîtresse qui prend l’initiative (« la maîtresse ouvrit ses bras »), alors que, chez Maupassant, c’est Rosalie (« ouvrant les bras »). Le geste est réciproque dans les deux cas et l’autre personnage y répond aussitôt (« la servante s’y jeta »/« lui jetant les deux bras au cou »), et de nouveau les auteurs emploient le même verbe : étreindre. Leur tendresse mutuelle s’exprime également dans les larmes partagées (« Leurs yeux se fixèrent l’une sur l’autre, s’emplirent de larmes »/« mêlant leurs pleurs ») et dans le baiser, que l’on trouvait déjà dans les deux premiers textes. v Brangien et Œnone sont prêtes à aller jusqu’à la mort pour leur maîtresse, car chacune dépend entièrement d’elle, selon le statut ancien de la servante : Brangien n’est pas libre (« enfant, ravie par des pirates, j’ai été vendue à sa mère et vouée à la servir ») et Œnone, en tant que nourrice, a aussi dû quitter toute sa vie antérieure pour se mettre au service de Phèdre (« Songez-vous qu’en naissant mes bras vous ont reçue ? / Mon pays, mes enfants, pour vous j’ai tout quitté »). Brangien a déjà offert sa virginité à Iseut pour la sauver et accepte sans discussion l’ordre de mort de sa maîtresse, qui a de toute façon tout pouvoir sur elle (« puisqu’elle veut que je meure, dites-lui que je lui mande salut et amour »), et Œnone préférerait se tuer plutôt que de voir elle-même sa maîtresse mourir sans pouvoir rien faire (« Mon âme chez les morts descendra la première »). Cet extrême dévouement se retrouve aussi, des siècles plus tard, chez Félicité (texte E) qui a également renoncé à toute vie personnelle pour se consacrer à la famille de sa maîtresse qui a ainsi remplacé la sienne. Mme Aubain devient donc le centre exclusif de son existence, comme le montre Flaubert avec deux expressions très fortes : « un dévouement bestial et une vénération religieuse ». De même, Rosalie (texte A) quitte sa maison pour venir, de sa propre initiative, s’occuper de sa maîtresse, et cela sans aucune contrepartie financière. Il est vrai que son statut est différent puisqu’elle n’est plus servante et qu’elle, au contraire des autres, a fait sa vie, s’est mariée, a eu un enfant et a acquis du bien. Enfin, Suzanne (texte C) est prête à rentrer dans le plan de sa maîtresse qui veut punir son mari, au risque de déplaire à Figaro qui ne sera pas au courant. w Iseut commence par « ma chère servante » qui souligne encore le lien hiérarchique, mais tempéré par l’adjectif « chère », introduisant cette fois un lien affectif. Viennent ensuite « ma seule amie », « ma chère compagne, la douce, la fidèle, la belle », qui suppriment toute idée de dépendance et instaurent entre les deux femmes une relation d’égalité et d’affection (« amie », « compagne »). Iseut fait même l’éloge de Brangien comme d’une dame (« la belle »). Elle se rend compte du lien humain profond qui l’attache à Brangien, bien au-delà de la relation maîtresse/servante, et qui la lui rend si « chère » : en effet, dans
Réponses aux questions – 62
cette Cour étrangère où Iseut est en position particulièrement menacée du fait de son adultère, Brangien représente bien sa « seule amie ». x Phèdre semble d’abord se défier de sa confidente et ne pas lui accorder assez de confiance pour lui faire son aveu (« Je t’en ai dit assez »). Il faut justement que celle-ci lui rappelle sa « foi » et sa « fidélité », qu’elle lui fasse une sorte de chantage au suicide et qu’elle la supplie instamment pour que Phèdre accepte de lui parler. Et son ordre « lève-toi » suggère qu’elle a désormais jugé Œnone digne de l’écouter et donc qu’elle la place à égalité avec elle, et non plus comme une subordonnée à ses pieds. Beaumarchais nous fait assister à un double revirement de la Comtesse : au refus de Suzanne, elle abandonne le tutoiement de la complicité, pour une soudaine distance qui montre sa méfiance vis-à-vis de sa camériste, et se montre même extrêmement dure avec elle, l’accusant directement de duperie (« vous me trompez »), de vénalité et d’infidélité pour la rejeter (« laissez-moi »). Mais, devant le bouleversement de Suzanne, elle revient brusquement à elle (« Hé mais… je ne sais ce que je dis ! ») et rétablit aussitôt la relation de confiance entre elles, d’abord par le geste de la relever, puis en reprenant le tutoiement et en l’appelant affectueusement « mon cœur ». Pour se faire pardonner, elle accuse sa propre étourderie qui l’a portée à juger trop vite (« C’est que je ne suis qu’une étourdie ») et scelle la réconciliation et l’estime retrouvée de part et d’autre par un baiser. y Les causes et les manifestations de la complicité entre maîtresse et servante sont évidemment très différentes entre les deux textes : chez Beaumarchais, il s’agit d’une comédie où les femmes s’allient pour berner le mari volage ; c’est donc la solidarité féminine qui agit, pour se venger de l’homme qui leur a fait du tort à toutes deux. La complicité entre Suzanne et la Comtesse se manifeste alors dans la manigance et le jeu rusé, ce qui provoque même le rire entre elles ou la connivence amusée dans la connaissance de la psychologie masculine (« Crains-tu qu’il ne t’entende pas ? »). Le texte de Flaubert se déroule dans un contexte fort différent puisqu’il s’agit du deuil : les deux femmes communient dans le souvenir de Virginie, qu’elles ont chérie toutes les deux et dont elles parlent entre elles. Dans cette scène, c’est à travers une tâche matérielle effectuée ensemble qu’elles vont pouvoir exprimer leur émotion, et le « petit chapeau de peluche » constitue l’objet qui cristallise leur union en permettant à Félicité de manifester son attachement à Virginie (« Félicité le réclama pour elle-même »). La complicité entre les deux femmes passe donc d’abord dans les paroles du souvenir, puis dans le regard (« Leurs yeux se fixèrent l’une sur l’autre »), enfin dans les larmes et l’étreinte.
Travaux d’écriture
Question préliminaire Il existe d’abord entre servante et maîtresse un lien de dépendance, d’autant plus fort que l’on remonte dans le temps : la vie de Brangien est entièrement entre les mains d’Iseut, de même que pour Œnone (cette dépendance est davantage d’ordre moral, et la nourrice se suicidera quand Phèdre la reniera) ; le mariage de Suzanne dépend de la volonté de la Comtesse ; Félicité n’a pas d’autre foyer que celui des Aubain. Enfin, tout est fait dans le tableau de Vermeer pour souligner la différence de statut : richesse ou humilité du vêtement, couleurs chatoyantes ou sombres, lumière et ombre, et jeu des positions (debout pour la servante et assise pour la maîtresse). Mais on peut remarquer que les servantes transforment cette dépendance ou cette soumission en dévouement librement consenti : Brangien ne se révolte pas contre l’ordre d’Iseut, Œnone a tout quitté pour Phèdre et lui est attachée au-delà de sa propre vie, Suzanne accepte de rentrer dans le plan de la Comtesse, et Félicité éprouve une « vénération religieuse » pour Mme Aubain. Le cas de Rosalie est encore plus remarquable puisqu’elle choisit délibérément de quitter sa vie indépendante pour venir s’occuper de Jeanne. C’est justement ce dévouement qui va permettre d’instaurer entre ces femmes des liens autres que hiérarchiques. On peut parler d’abord de « complicité », de « connivence » entre elles, qui leur permettent de dépasser les différences sociales (cf. question 5) : elles peuvent être liées par les souvenirs, souvent douloureux, comme c’est le cas pour Rosalie et Jeanne, et Félicité et Mme Aubain. Chez Beaumarchais, cette connivence est plus ludique et permet – pour un temps seulement – d’effacer les différences, puisque Suzanne et la Comtesse vont échanger leur costume et leur rôle, poussées par la solidarité féminine.
Une vie – 63
La force du lien vient également de la confiance accordée et d’une sorte d’intimité partagée : Brangien est la seule dépositaire du secret d’Iseut et y a même pris sa part ; Œnone, au nom de sa fidélité, veut connaître le mal qui ronge Phèdre et celle-ci la jugera digne d’en recevoir l’aveu ; la Comtesse a confié ses déboires conjugaux à Suzanne qui a osé, de son côté, lui rapporter les manœuvres du Comte ; Jeanne et Rosalie savent que leurs fils ont le même père ; Félicité et Mme Aubain partagent l’intimité des souvenirs de Virginie ; enfin, dans le tableau de Vermeer, la servante qui apporte la lettre pénètre dans l’intimité de sa maîtresse et son léger sourire semble montrer qu’elle est au courant de beaucoup de choses… Cette confiance mutuelle rend alors réciproque la dépendance relevée au départ : d’une certaine façon, la maîtresse dépend de la fidélité et de la loyauté de la servante (c’est très net dans le cas d’Iseut et de Phèdre, dans une moindre mesure dans le cas de la Comtesse) ; Maupassant (texte A) va le plus loin dans ce sens, puisque c’est Rosalie qui prend en main la destinée de Jeanne. Les barrières hiérarchiques s’effondrent quand le sentiment va oser s’exprimer : c’est le cas très nettement pour Iseut, qui remet en question son statut de maîtresse et l’ordre qu’elle a donné, en « se maudiss[ant] elle-même » et en s’agenouillant devant sa servante. Et on retrouve ce même effacement de la hiérarchie quand les maîtresses embrassent leur servante (textes A, B, D et E), ce qui est expressément souligné par Flaubert : « dans un baiser qui les égalisait ». Il faut souvent une émotion très forte (en lien avec la mort et le deuil, qui eux aussi égalisent les humains…) pour permettre à leur affection de s’exprimer au-delà de la distance qui les sépare, et c’est ce qu’expriment les larmes dans les textes A, B et E.
Commentaire
Introduction Avec Un cœur simple, Flaubert choisit un titre programmatique : une simple servante, au cœur simple comme dans les Béatitudes, une histoire simple narrée simplement mais qui laisse d’autant mieux surgir l’émotion. C’est ce que nous verrons dans cet extrait racontant avec une grande économie de moyens littéraires une petite scène riche d’humanité.
1. La recherche de la simplicité A. La banalité du quotidien • La situation du fils aîné est présentée très rapidement au début de l’extrait en trois courtes phrases à l’imparfait de répétition, qui suggèrent qu’il n’y a pas d’issue possible (« il en refaisait d’autres ») : rien de romanesque donc, pas de tension dramatique ; les deux femmes ne peuvent agir, sont réduites à l’impuissance et aux « soupirs ». • Le narrateur semble leur refuser toute tension vers l’avenir, toute volonté de changement, qui sont pourtant le propre des héros romanesques du XIXe siècle : elles vivent dans le souvenir d’une morte. Cf. l’irréel du passé (« lui aurait plu », « eût dit ») qui suggère qu’elles ne vivent plus vraiment dans la réalité, qu’elles sont en dehors de la marche du monde. • Leurs occupations (le tricot et le rouet) semblent incarner la monotonie de leur vie, aux journées sans cesse recommencées comme les rangs de tricot qui s’ajoutent les uns aux autres ou le rouet qui tourne inlassablement. Ces occupations sont présentées d’ailleurs sans but précis, sans objet, sans résultat (« se promenaient », « causaient »). • Tous les verbes d’action du début du texte sont à l’imparfait (« poussait », « tournait », « se promenaient », « causaient ») – répétition temporelle renforcée par l’adverbe « toujours ». B. Le goût du détail • Cette simplicité est encore soulignée par l’importance que donne Flaubert aux détails concrets, qui ancrent la scène dans la réalité : – le narrateur précise toujours les lieux de la scène (« près de la fenêtre », « dans la cuisine », « le long de l’espalier », « dans la chambre à deux lits ») ; – il énumère les objets ayant appartenu à Virginie (cf. les deux énumérations du paragraphe 3), qui n’ont rien d’extraordinaire (« poupée » ; « cerceaux » ; « cuvette » ; « les jupons, les bas, les mouchoirs »). • Au-delà du souci de réalisme, il s’agit aussi d’exprimer le deuil, le chagrin de la perte de l’enfant, qui se concrétise ici sur ses « petites affaires ». Virginie s’incarne à travers elles – d’où la précision des « plis formés par les mouvements du corps » – ; aucun détail n’est jamais gratuit chez Flaubert.
Réponses aux questions – 64
• C’est d’ailleurs par l’intermédiaire du « petit chapeau de peluche » que l’émotion des deux femmes va trouver un exutoire et que leur tendresse mutuelle s’exprimera. C. Le recours à la litote Flaubert décrit une scène extrêmement émouvante puisqu’elle a trait au deuil et à la tendresse entre les deux femmes ; mais il refuse l’épanchement ou le pathos et cultive la retenue : – l’inquiétude de la mère pour son fils n’est signifiée que par le terme « soupirs ». Le narrateur précise d’ailleurs que « Mme Aubain n’ét[ait] pas d’une nature expansive » ; – les deux seuls termes évoquant le chagrin sont « larmes » et « douleur » ; – le narrateur suggère le deuil « en passant », par des phrases très courtes, à travers des attitudes qu’il faut d’une certaine façon déchiffrer (« Mme Aubain les inspectait le moins souvent possible »). – de même, la douleur de l’absence et celle du temps qui efface tout sont exprimées par deux petites phrases, presque comme des incises (« et des papillons s’envolèrent de l’armoire », « mais il était tout mangé de vermine ») ; – l’émotion entre les deux femmes ne s’exprime jamais au discours direct, mais uniquement par leurs gestes et attitudes, décrits une fois de plus de façon très sobre, simplement par des verbes (« Leurs yeux se fixèrent l’une sur l’autre, s’emplirent de larmes ; enfin la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s’y jeta »).
2. Un moment d’exception A. Magnifier le quotidien Tout l’art de Flaubert est justement de « magnifier » ce quotidien, de lui donner tout son poids de vie. a) Un moment de grâce • « Un jour d’été » se détache enfin de la monotonie des journées (+ passage au passé simple). • Le narrateur fait en sorte de mettre en valeur ce moment (« C’était la première fois de leur vie » + « désormais » qui institue cette scène comme un tournant dans la vie des deux femmes). • Le narrateur précise l’atmosphère de ce jour au milieu du texte, avec un vocabulaire et une syntaxe encore extrêmement simples : « L’air était chaud et bleu, un merle gazouillait, tout semblait vivre dans une douceur profonde » ; cette phrase donne une impression de temps suspendu (imparfait) ; sa « douceur » s’oppose à la « douleur » ; toutes les sensations évoquent la vie au lieu de la mort, comme si la nature allait aider les deux femmes à surmonter le chagrin mortifère pour s’ouvrir à une autre source de vie, toute simple, celle de la tendresse partagée. b) Les « pauvres objets » Ces objets, qualifiés de « pauvres » ou de « petites affaires », dont on a vu précédemment qu’ils étaient marqués par la banalité, vont être aussi transformés en quelques mots et chargés d’émotion : – le soleil fait renaître en eux (malgré les mites) le souvenir de Virginie, comme si elle était toujours vivante (« Le soleil éclairait ces pauvres objets, en faisait voir les taches, et des plis formés par les mouvements du corps ») ; – de même, le chapeau, bien qu’il soit « tout mangé de vermine », garde toute sa valeur pour Félicité qui « le réclam[e] pour elle-même ». B. La communion entre servante et maîtresse a) Une communion progressive • Le début du texte montre encore une certaine distance entre les deux femmes, indiquée par le lieu propre à chacune (« près de la fenêtre »/« dans la cuisine »). • Mais le narrateur souligne cependant une communication entre elles, qui semble annuler cette distance, même si elle ne passe pas encore par les mots (« les soupirs que poussait Mme Aubain […] arrivaient à Félicité »). • Puis, dans le paragraphe 2, elles sont réunies dans le même lieu et dans la même occupation (« Elles se promenaient ensemble le long de l’espalier ; et causaient toujours de Virginie »). Dans la suite du texte, les verbes sont généralement au pluriel (« elles retirèrent », « étendirent », « retrouvèrent », « s’étreignirent »). De même, le narrateur emploie l’adjectif possessif de la 3e personne du pluriel (« leurs yeux », « leur douleur », « leur vie »). b) Un moment d’émotion • C’est l’émotion qui va permettre aux deux femmes d’aller au-delà des barrières sociales : Félicité, poussée par son affection et son chagrin, ose prendre l’initiative et réclamer le chapeau « pour elle-même ».
Une vie – 65
• À partir de ce moment, le narrateur crée une subtile gradation pour montrer l’union progressive entre elles deux et il use de différents procédés pour montrer la réciprocité de leurs sentiments : – la communion s’instaure à travers l’échange des regards, souligné par les pronoms réciproques (« Leurs yeux se fixèrent l’une sur l’autre ») ; – puis la phrase suivante établit un parallélisme parfait entre les deux femmes, à travers le même nombre de syllabes et une sorte de rime intérieure (« la maîtresse ouvrit ses bras, la servante s’y jeta ») ; – enfin, la dernière phrase du paragraphe s’ouvre et s’achève sur deux termes évoquant la communion (« s’étreignirent »/« égalisait ») ; – dans le paragraphe suivant, cette réciprocité se prolonge dans le cœur de Félicité, qui voit dans cette émotion de sa maîtresse un « bienfait » dont elle est « reconnaissante ». c) Un cœur simple Si cet échange si intime et profond a pu avoir lieu entre servante et maîtresse, c’est essentiellement dû à Félicité, dont Flaubert souligne ici à la fois les qualités de cœur et la simplicité : – le narrateur emploie pour qualifier Félicité à la fin du passage un vocabulaire du sentiment fait de termes forts (« reconnaissante », « chérit », « vénération ») ; la phrase conclusive de l’extrait, encore une fois lumineuse de simplicité, ne fait que conforter ce que le passage a montré du personnage : « la bonté de son cœur » ; – c’est la simplicité de la servante qui permet à son émotion de s’exprimer et qui explique ce recours aux termes forts, alors que l’extrait est marqué par la retenue. La simplicité de Félicité est telle que ses sentiments sont marqués par l’excès et la naïveté (« dévouement bestial », « vénération religieuse ») ; la comparaison avec les animaux n’a ici rien de péjoratif, mais ajoute au contraire à l’émotion du texte – on retrouve d’ailleurs cette même assimilation dans le portrait de la servante Catherine Leroux dans Madame Bovary : « Dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité. »
Conclusion Cet extrait de Flaubert illustre parfaitement son écriture faite de retenue, de suggestion, et son refus de toute boursouflure littéraire. C’est cette ascèse dans le style qu’il a transmise à Maupassant et qui fait de ce sobre récit une scène si pleine d’émotion…
Dissertation
Introduction La tradition romanesque a pendant longtemps choisi comme héros des êtres d’exception ; mais, essentiellement à partir du XIXe siècle, les romanciers, voulant se dégager des excès romanesques, ont préféré des héros plus médiocres, voire insignifiants. Ainsi Zola a-t-il pu écrire : « Le premier homme qui passe est un héros suffisant. Fouillez en lui et vous trouverez certainement un drame simple qui met en jeu tous les rouages des sentiments et des passions. » Nous verrons quelles sont les raisons qui ont provoqué cette évolution du héros, puis en quoi le lecteur peut s’intéresser au « premier homme qui passe ».
1. L’évolution du roman : du héros au « premier homme qui passe » A. Du héros héroïque… Depuis les origines du roman (roman antique, puis médiéval), les héros sont doués de qualités exceptionnelles et accomplissent des actions hors du commun. a) Qu’ont-ils d’exceptionnel ? • Des qualités physiques : extrême beauté de Callirhoé (Chairéas et Callirhoé de Chariton, premier roman grec conservé, datant du IIe siècle de notre ère), d’Iseut, de la princesse de Clèves, etc. ; force physique des héros de Chrétien de Troyes ; charme et élégance du duc de Nemours, des héros de Stendhal… • Des qualités morales : vertus chevaleresques de Lancelot, etc. ; courage, bonté, fidélité des héros de Victor Hugo… • Des êtres d’exception car ils portent certaines caractéristiques à l’extrême : les personnages des Liaisons dangereuses sont des modèles de libertinage. • Des destins exceptionnels : ces héros sont confrontés à des situations, des épreuves qui les mettent en valeur (personnages historiques de Dumas, aventuriers de Jules Verne, amoureux passionnés de Stendhal…).
Réponses aux questions – 66
b) Pourquoi le lecteur s’attache-t-il à eux ? • Rêve et évasion : ils nous permettent de sortir du quotidien et de la banalité. • Admiration devant le courage, la vertu, la générosité… • Phénomène d’identification : désir de leur ressembler, de vivre les mêmes aventures ou les mêmes passions. Ces héros deviennent des modèles, des repères. • Plaisir de l’idéalisation, d’une vision de l’homme magnifiée. Ces héros porteurs de valeurs ou d’idéaux forts donnent des raisons d’espérer dans le monde et l’homme. • Ils nous font réfléchir, nous poussent à nous poser des questions graves parce que certains se trouvent devant des choix impossibles, dans des situations tragiques… B. … au « premier homme qui passe » Les romanciers réalistes puis naturalistes décident de prendre des hommes ordinaires comme héros de leurs romans. a) Refus du romanesque • Refus de l’idéalisation, de l’extraordinaire (Zola écrit que, « fatalement, le romancier tue le héros, s’il n’accepte que le train ordinaire de l’existence commune ») : – le personnage n’a plus de qualité marquante (Gervaise est jolie, mais elle boite) ; – il manque d’énergie (cf. Jeanne dans Une vie, Meursault dans L’Étranger de Camus) ; – il peut être médiocre, vil (Bel-Ami de Maupassant), stupide (Le Curé de Tours de Balzac), etc. • Refus d’une intrigue invraisemblable et même des effets dramatiques : les personnages attendent plutôt qu’ils n’agissent (cf. Mme Bovary, Frédéric Moreau, ou le héros du Désert des Tartares de Buzzati…). Le personnage n’est plus confronté à des situations extraordinaires mais banales (cf. le choix du titre Une vie ou Un cœur simple, la volonté de Flaubert d’écrire un « livre sur rien »). b) Volonté de montrer la réalité telle qu’elle est • Les romanciers veulent montrer tous les types sociaux (cf. la volonté de Balzac de « faire concurrence à l’état civil »), donc aussi bien les petits, les obscurs, que les puissants ou les riches. Cf. le personnage de l’employé de bureau, symbole de la vie médiocre et étriquée, chez Gogol (Le Manteau). • Héros confrontés à l’échec : Emma se suicide, Gervaise finit dans un trou sous l’escalier, Jeanne ou Frédéric Moreau ratent leur vie.
2. Un « héros suffisant » ? En quoi le « premier homme qui passe » peut-il être un « héros suffisant » ? Pourquoi et comment le lecteur peut-il s’intéresser et même s’attacher à de tels personnages ? A. Le romancier peut « magnifier » ces personnages • C’est le sens de la seconde partie de la phrase de Zola : « Fouillez en lui et vous trouverez certainement un drame simple qui met en jeu tous les rouages des sentiments et des passions » ; les passions humaines (amour, ambition, jalousie…) sont les mêmes, quel que soit le statut social du personnage, et peuvent se vivre de la même façon dans les situations les plus obscures. • Balzac excelle à trouver des passions extrêmes chez les plus humbles de ses héros : le père Goriot devient un « Christ de la paternité », l’abbé Troubert (dans Le Curé de Tours) « Sixte-Quint réduit aux proportions de l’évêché ». • L’ordinaire n’exclut ni le pathétique, ni le tragique : les héros de Mauriac font partie de la bourgeoisie de province la plus conventionnelle et développent des haines, des jalousies, des rancœurs qui peuvent aller jusqu’au meurtre (Thérèse Desqueyroux). • C’est le propre d’un romancier de savoir donner grandeur, dignité, émotion à des personnages qui ne sortent pas du commun : – les personnages de La Peste de Camus (le docteur Rieux et Grand, l’employé de mairie) sont présentés comme des hommes ordinaires et Rieux insiste sur ce point : il veut faire son métier d’homme ; – dans L’Élégance des veuves, Alice Ferney montre la noblesse du destin de toutes ces femmes confrontées au deuil, au veuvage, à la mort de leurs enfants… B. Ils sont humains, plus proches et émouvants • Ils sont humains et ne possèdent pas, comme les héros, des qualités qui les placent au-dessus du reste de l’humanité ; ils touchent le lecteur qui se sent proche d’eux.
Une vie – 67
• Il y a moins de distance avec eux qu’avec les vrais héros, êtres d’exception : ce sont des hommes dans lesquels le lecteur se reconnaît ou pour lesquels il peut éprouver de la sympathie ou de la compassion, parce qu’ils ont les mêmes angoisses, les mêmes désirs que lui… • Le lecteur peut y reconnaître sa propre « banalité », mais aussi l’intérêt qu’elle peut susciter : les héros d’Anna Gavalda sont souvent des « cassés » de la vie, des laissés-pour-compte qui ont connu l’échec, mais qui se révèlent aussi pleins de richesses. • Ces héros cherchent à vivre, à être heureux et parfois avec courage, et même avec vertu : Gervaise se bat longtemps avant d’abandonner ; le père Goriot est d’une bonté, d’un dévouement exemplaires… C. Ils permettent de se poser des questions • Ils sont tirés du monde réel et apparaissent souvent meurtris par l’existence ou la société : les personnages de Zola interrogent le lecteur sur les conditions de travail, le statut des ouvriers, la protection sociale… • Le fait qu’ils nous ressemblent nous permet de nous confronter à travers eux aux questions ou problèmes de l’existence, qu’ils soient existentiels, métaphysiques, matériels : le cas de Meursault est ici exemplaire.
Conclusion La phrase de Zola met finalement en avant le génie du romancier qui doit savoir faire de tout homme un « héros suffisant ». Par la magie de la littérature, la médiocrité et la banalité peuvent se trouver transfigurées et porteuses de sens. Ainsi, on n’oublie pas plus le père Goriot ou Meursault que Tristan…
Écriture d’invention Les élèves ont toute liberté pour imaginer le type de relation ou de connivence entre les deux femmes et le contenu de la lettre. On valorisera les copies de ceux qui auront su exploiter au mieux les ressources du genre romanesque, en particulier la focalisation et l’insertion du dialogue. Il serait intéressant également que le dialogue utilise divers registres de langue pour mettre en valeur la différence de statut entre servante et maîtresse, mais permette aussi de faire sentir les relations qui existent entre elles.
Compléments aux lectures d’images – 68
C O M P L É M E N T S A U X L E C T U R E S D ’ I M A G E S
◆ Albert Fourié, Un repas de noces, à Yport (page 5) Le tableau Un commentaire très intéressant de ce tableau et du rapport à la photographie, dont l’art se développe au XIXe siècle, vous est proposé sur le site du musée des Beaux-Arts de Rouen : http://www.rouen-musees.com/Musee-des-Beaux-Arts/Les-collections/Le-salon-Un-Repas-de-Noces-a-Yport-49.htm. Un travail comparatif entre ce tableau et l’extrait du repas de noce dans Une vie (traitement du sujet, tant des points de vue de la situation décrite que de la technique adoptée) pourrait être envisagé.
◆ Comparaison des frontispices (pages 8 et 27) Rapport avec le texte Le dessin de La Vie Populaire illustre, comme l’indique le sous-titre, la rêverie nocturne de Jeanne devant sa fenêtre lors de son retour aux Peuples (chapitre I). Cette illustration insiste sur le caractère rêveur et romantique de Jeanne : elle est représentée en position complètement alanguie, le regard dans le vague et la bouche entrouverte ; elle voit se matérialiser ses rêves romantiques de façon très conventionnelle, à travers un petit Cupidon (symbole de l’Amour – et aussi de son fils ?) et un beau jeune homme brun ! La pleine lune renforce encore les clichés et suggère aussi, de même que l’aperçu du parc par la fenêtre, l’amour de Jeanne pour la nature. Sur la page de titre de l’édition Ollendorf, le dessin évoque les promenades en amoureux de Jeanne et Julien (chap. III), avec la barque du père Lastique (p. 51 : « Ils s’assirent, la tête à l’abri et les pieds dans la chaleur. Ils regardaient toute cette vie grouillante et petite qu’un rayon fait apparaître ; et Jeanne attendrie répétait : “Comme on est bien ! que c’est bon la campagne ! Il y a des moments où je voudrais être mouche ou papillon pour me cacher dans les fleurs.” ») ou lors de « la radieuse saison des fiançailles » (chap. IV). Cette illustration centre l’intérêt sur les relations entre Jeanne et Julien et semble suggérer qu’elles ne vont pas correspondre aux rêves de la jeune fille : si les deux personnages sont bien assis l’un à côté de l’autre, leurs regards ne se croisent pas ; le jeune homme paraît avoir des vues précises sur la jeune fille qui se détourne. Le choix d’un cadre naturel montre là aussi l’importance de la nature dans l’œuvre.
Travaux proposés – À quels moments de l’œuvre font allusion ces deux gravures ? – Sur quels aspects du roman insistent ces deux illustrations ? – Si vous deviez concevoir une illustration de couverture de ce livre, quel moment de l’œuvre choisiriez-vous ? Justifiez votre choix. – Réalisez une couverture d’Une vie à partir de reproductions, de montages photographiques ou de vos propres dessins.
◆ Photos du film (pages 46, 74 et 285) La réalisatrice, les comédiens et l’œuvre Ces photos sont extraites du téléfilm d’Élisabeth Rappeneau (2005), avec Barbara Schulz (Jeanne), Boris Terral (Julien), Marie Denarnaud (Rosalie), Catherine Jacob (Adélaïde), Wladimir Yordanoff (le baron), Florence Darel (la comtesse de Fourville), Nicole Gueden (Tante Lison). Le scénario est une adaptation du roman de Maupassant par Colo Tavernier et Élisabeth Rappeneau et a été primé au Festival (de télévision) de Monte-Carlo. Jeanne, ici très brune à la peau mate et plutôt menue, ne correspond pas du tout au personnage, blonde aux yeux bleus : « Elle semblait un portrait de Véronèse avec ses cheveux d’un blond luisant qu’on aurait dit avoir déteint sur sa chair, une chair d’aristocrate à peine nuancée de rose, ombrée d’un léger duvet, d’une sorte de velours pâle qu’on apercevait un peu quand le soleil la caressait. Ses yeux étaient bleus, de ce bleu opaque qu’ont ceux des bonshommes en faïence de Hollande. [...] Elle était grande, mûre de poitrine, ondoyante de la
Une vie – 69
taille » (p. 11). C’est un peu dommage dans la mesure où Maupassant a pris soin d’opposer Jeanne et Julien, la blonde et le brun… L’acteur qui incarne Julien ressemble beaucoup plus au personnage du roman : « grand jeune homme élégant [...]. Il possédait une de ces figures heureuses dont rêvent les femmes et qui sont désagréables à tous les hommes. Ses cheveux noirs et frisés ombraient son front lisse et bruni ; et deux grands sourcils réguliers comme s’ils eussent été artificiels rendaient profonds et tendres ses yeux sombres dont le blanc semblait un peu teinté de bleu. Ses cils serrés et longs prêtaient à son regard cette éloquence passionnée qui trouble dans les salons la belle dame hautaine, et fait se retourner la fille en bonnet qui porte un panier par les rues. Le charme langoureux de cet œil faisait croire à la profondeur de la pensée et donnait de l’importance aux moindres paroles. La barbe drue, luisante et fine, cachait une mâchoire un peu trop forte » (pp. 43-44). À part la barbe, on retrouve bien chez cet acteur les « cheveux noirs et frisés », les « yeux sombres », l’élégance et le charme du personnage. Les parents de Jeanne dans le téléfilm paraissent bien choisis : l’acteur qui incarne le baron a le côté aristocratique et bienveillant du personnage, mais la baronne est beaucoup moins « énorme » que dans le roman ! Enfin, dans la comtesse de Fourville du téléfilm, on retrouve la « jeune femme pâle, jolie, avec une figure douloureuse, des yeux exaltés, et des cheveux d’un blond mat comme s’ils n’avaient jamais été caressés d’un rayon de soleil » (chap. VIII, p. 139).
Rapport avec le texte – Page 46 : il s’agit d’un dîner où Julien est invité aux Peuples (chap. III). – Page 74 : il s’agit de la sortie de l’église, lors du mariage (chap. IV). – Page 285 : cette visite de Jeanne et Julien chez les Fourville ne correspond à aucune scène précise du roman (dans celle du chapitre IX, Jeanne vient sans son bébé). Le regard entre Julien et Gilberte est éloquent, mais Jeanne paraît concentrée sur son enfant.
Travaux proposés – Identifiez la scène illustrée par chacune des trois photographies. En quoi cette adaptation cinématographique est-elle fidèle au texte et à quels détails pouvez-vous voir les libertés prises par les scénaristes ? – Les acteurs vous semblent-ils bien correspondre aux personnages du roman ?
◆ Caricature de Maupassant (page 306) Le portrait-charge La caricature travaille sur la disproportion : ici, la tête de l’auteur est grossie, mais ses traits ne sont pas déformés et restent fidèles à l’original (cf. la photo de Nadar, p. 4). Les objets sont détournés de leur usage premier : la somme des œuvres de Maupassant semble servir de balancier ou de contrepoids ; quant aux deux gros volumes de Balzac et Flaubert, ils pourraient faire penser à la proue d’un bateau (allusion à la passion de l’auteur pour la navigation ?). Les deux auteurs sont en tout cas choisis avec justesse, puisque Maupassant se pose en héritier du réalisme balzacien et en disciple de son maître Flaubert.
Travail proposé – Relevez les procédés de la caricature.
Bibliographie complémentaire – 70
B I B L I O G R A P H I E C O M P L É M E N T A I R E
– Hervé Alvado, Maupassant ou l’Amour réaliste, La Pensée universelle, 1980. – Colette Becker, Lire le réalisme et le naturalisme, coll. « Lettres Sup. », Nathan, 2000. – Pierre Cogny, Maupassant, peintre de son temps, Larousse, 1975. – Louis Forestier (sous la dir. de), Maupassant et l’Écriture, Actes du colloque de Fécamp (21-23 mai 1993), Nathan, 1993. – Annie Goldmann, Rêves d’amour perdu. Les Femmes dans le roman du XIXe, Denöel-Gonthier, 1984. – Henri Mitterrand, Le Regard et le Signe, PUF, 1987 (« Clinique du mariage : Une vie », pp.159-167). – Guy Sagnes, L’Ennui dans la littérature française de Flaubert à Laforgue (1848-1884), Armand Colin, 1969.




















































































![Guy de Maupassant [Cuentos]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55721221497959fc0b9016b5/guy-de-maupassant-cuentos.jpg)